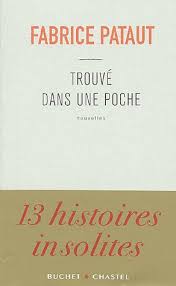Apostille du mareyeur

En retour sur Les Huitres et autres contes, une préface inédite à la version portugaise d’As ostras e outros contos,
par Fabrice Pataut
Chaque nouvelle de ce volume porte, avec plus ou moins de distance et d’ironie selon les cas, la marque de l’exil, son mélange d’espoir et de morosité, ses impasses et ses obstinations. Ce n’est pas tant qu’aucune n’a été écrite sur l’instant, là où son action se déroule : « Le Rhin » au bord du Rhin, « Le banquet »et « Les gants » dans la campagne normande. Ce n’est pas non plus que l’une ou l’autre aurait été conçue là où le narrateur n’est pas, sur les lieux que son histoire évoque : en Australie pour « Barbara de neuf à quarante ans », en Mongolie pour « Ulan Bator ». C’est plutôt que toutes, dans le temps qui leur est imparti — une courte page pour « Énigme dans le désert », à peine quelques lignes de plus pour « Machez, ma chère, ma chair chère »— introduisent dans l’esprit du lecteur le sentiment qu’il est en réalité plus déraciné qu’il ne l’avait soupçonné au départ, qu’il est peut-être même aliéné par la vie de bureau (« L’homme dont la jambe fait des torsades autour du pied de son bureau ») ou, pire, par la déception amoureuse, au point de sacrifier à cette délectation morose : récrire l’histoire (« Allers-retours hésitants sur le pont Alexandre III »). Chacune le dépose sur un terrain neuf et peu familier et l’abandonne tout en haut d’une pente abrupte, mal assuré et circonspect, aussi naïf que Machenka dans « Coupelle », aussi jaloux que le narrateur d’« Éloge d’Emmanuel », sans bagage et fort de déceptions empruntées à autrui.
João Carlos Alvim a eu l’idée de sortir ces nouvelles du tiroir parisien où elles s’étaient endormies — depuis bientôt quinze ans pour certaines — et Clarisse Tavares a su les réinventer dans la langue de Camões et de Pessoa. Je les relis aujourd’hui plus volontiers dans l’idiome portugais que dans leur français d’origine. Je ne comprends pas tout, évidemment, mon portugais étant remarquablement imparfait, mais je me réjouis qu’elles aient enfin quitté leurs vêtements d’hiver et qu’elles soient désormais douces et fondantes comme des pastéis de nata, volubiles et chuintantes malgré leur pessimisme.
C’est pour moi un grand plaisir, à la fois comique et domestique, de les voir prendre leurs marques à Lisbonne, d’autant plus revigorant que je n’aurais pu l’imaginer il y a un an, quand le Portugal n’était encore qu’un nom sur une carte, Lisbonne la chambre de Pessoa et Sintra la prison de Morand. Aucune n’est née à Lisbonne et ce sont bien sûr les conquis plutôt que les conquérants qui s’expriment ici : les Argentins dans« Habeas Corpus »et « Sangre de toro », les Russes de New York dans « Coupelle». Je pensais les avoir apprivoisés, et voici maintenant à l’œuvre sous mon nez l’un des mystères les plus impénétrables de la traduction.
Tous mes protagonistes m’échappent et s’affranchissent. Je ne lirai plus « Histoire de la clef »comme je l’avais lue jusqu’à présent. Ce père résigné qui attend de voir son enfant — un homme sans identité remarquable, qui aurait bien pu se trouver là ou ailleurs sans rien changer à sa nonchalance, qui me laissait à mon libre arbitre pas plus tard que le mois passé — me conduit à présent dans la ville du Tage et ressasse, à Mouraria ou peut-être dans le Quartier Haut, la fin d’un empire et le début d’une conquête.
J’ai pensé un moment classer ces nouvelles selon la manière dont chacune aborde le motif de l’exil : par le biais du retour prodigue, auquel cas les déboires de Barbara auraient cotoyé le retour au bercail de « L’her-bier, d’abord, puis le bateau »; ou au contraire sous l’angle de la dispersion pure et simple, auquel cas « Machines » aurait probablement ouvert la voie à l’éparpillement d’« Invitation à un découpage ». J’ai finalement laissé les différents aspects de la fuite et de la destitution, qui sont tout autant l’œuvre du temps qui se dérobe que celui de l’espace qui se déroule, ou peut-être même l’œuvre d’un seul être hybride mi-horloge mi-tapis, s’éparpiller d’eux-mêmes, de façon qu’on retrouve également par intermittences plutôt que d’un seul coup le Paris de carton-pâte qui m’a servi d’antidote à mon retour des États-Unis : celui des« Huîtres »pour commencer, puis, à quelque distance de là, celui de « Monsieur Loiseleur » et de «Julien ». Les nouvelles qui sont le plus françaises, qui doivent le plus à la France, sont également celles que j’ai eu le plus de difficultés à écrire, qui ont le plus résisté : «(La taillle de) La bouche des poissons », «Petit bouquet de manières noires », « Visites », « Diaboliques», sans parler de « Vents », cette apologie amère du jardin du Luxembourg, haut lieu du classicisme, hommage horticole à Jean Racine.
Et puis il y a les Anglais : le Colin de « Trouvé dans une poche», subrepticement aperçu dans un bus, et le chat savant de « Tobermory détective (à la Saki)», les Italiens en proie à la politique («Elena (ferito nell’onore »)), les Chinois ancestraux et chinoisants (« L’histoire du cercueil de verre ») et les Espagnols ténébreux («Cinq portraits de Lol », où Dolores apparaît pour la première fois, un personnage auquel je tiens sans vergogne, une extraordinaire femme d’intérieur, toute entière à son linge et à ses cigarettes, dont on lira peut-être un jour l’histoire). Tous sont réunis dans mon musée portatif, dociles comme l’oncle des « Rasages successifs » et aussi intraitables que les enfants terribles de «Cérémonies». Si ce recueil est réussi, s’il accomplit jamais son effet, c’est en rendant au lecteur l’intimité qu’il lui a fait perdre le temps de quelques pages, comme sous la direction de quelque grosse dame hongroise, à la manière d’« Invi-tation à un recollage ». Comme quoi je suis finalement plus aimable qu’il n’y paraît au premier abord.
Non seulement aimable, mais même vaincu par ma prétention et ma naïveté, ce qui ne manquera pas de satisfaire le lecteur épris de justice, car j’ai joué, le temps de ces trente-quatre nouvelles, avec l’idée du déplacement des individus et des populations, comme un enfant de riche avec des jouets d’enfant pauvre et on m’a rattrapé à mon propre jeu d’une manière finalement attendue et méritée.
J’étais assez content, l’autre jour, d’avoir trouvé un morceau de faux Portugal au royaume de l’artifice — rues sinueuses, échoppes carrelées, vin vert, l’inévitable morue, autant de poncifs pris en étau entre deux échangeurs d’autoroutes à Los Angeles — pour m’installer à mon aise et écrire cette préface, satisfait du jeu ancien du départ et du retour. Et puis j’ai dû prendre une journée de recul avant de revenir me relire à la terrasse que j’avais choisie, une journée que j’ai perdue à circuler à quelque distance de là dans mon ancien quartier. C’est à cette occasion que je passai par hasard devant une boutique de fourrures, quelque part entre les avenues Fairfax et La Cienega, dans le carré délimité par Wilshire et la troisième rue, non loin de l’endroit où j’ai écrit autrefois la plupart de ces textes. Quelque chose, à l’intérieur, a attiré mon attention : un mouvement ou un reflet. Un enfant d’une dizaine d’années venait tout juste de se lever du fauteuil dans lequel il avait dû s’assoupir une heure plus tôt. Ses yeux étaient encore gonflés de sommeil. Il m’a fait un petit signe de la main en s’approchant de la vitrine. Je suis resté un moment à regarder avec étonnement le papier kraft froissé et jauni qui recouvrait les présentoirs, la plante grasse poussiéreuse, les modèles désuets de manteaux et d’étoles, curieusement orangés derrière la feuille de plastique teintée qui les protégeait du soleil. Il a continué à s’approcher d’un pas incertain. Ses petites lunettes rondes et son sourire narquois le faisaient étrangement ressembler à Isaac Babel sur les photos noir et blanc des années vingt, et je me suis mis à regretter de ne pas l’avoir fait remarqué dans «Les fourreurs». J’aurais pu y penser plus tôt, m’approprier ce détail comme je me suis approprié les autres, faire un pas de plus hors de moi-même avec une déconcertante facilité, prétendre être un autre afin d’éviter d’avoir à rendre des comptes. C’est maintenant une tâche pour l’avenir : revenir à cet endroit, m’asseoir où il s’est assis, boire encore un peu de son sang doux et sucré et raconter la suite. Je veux dire par là : prêcher le faux pour savoir le vrai.
Portuguese Bend. Los Angeles, Californie, Avril 2000
(LES HUÎTRES ET AUTRES CONTES)
(Traduction portugaise de Clarisse Tavares) Livros do Brasil, Lisbonne, 2000
LES EXILÉS
Entretien avec Inês Cunha Direito à propos de
As Ostras e Outros Contos
Note.« Les exilés » est la traduction française d’un entretien avec la journaliste Inês Cunha Direito, paru en janvier 2001 sous le titre « Exílios » dans la revue lisboète O Independente à l’occasion de la publication du recueil de nouvelles As Ostras e Outros Contos, traduit du français par Clarice Tavares (Livros do Brasil, coleção « Miniatura nova », 2000).
La parution du volume avait donné lieu à une signature à la librairie Buchholz, présentée par Carlos Pinto Coelho, et à un entretien télévisé avec António Carlos Carvalho pour l’émission Acontece de la Rádio e Televisão de Portugal.
Écrits aux États-Unisen langue française et publiés au Portugal, les contes de Fabrice Pataut sont le meilleur exemple de déracinement. Nous pouvons maintenant les lire en portugais. Comme le dit l’auteur, « je me réjouis qu’ils aient enfin quitté leurs vêtements d’hiver et qu’ils soient désormais doux et fondants comme des pastéis de nata, volubiles et chuintants malgré leur pessimisme ».
As Ostras e Outros Contosrassemble 34 textes multinationaux qui parlent d’exil. Ils nous conduisent dans des pays variés et nous font rencontrer des personnages d’origines diverses. Ce sont des histoires anglaises, chinoises, italiennes, argentines ou espagnoles, qui ont rarement une fin au sens prope.Philosophe, spécialiste en logique, philosophie des mathématiques et philosophie du langage, Fabrice Pataut explique en peu de mots comment, depuis la parution de cette traduction, il redécouvre ces textes et quels sont les liens qui les unissent.
Inês Cunha Direito
Inês Cunha Direito – La préface nous apprend qu’il s’agit d’un livre sur l’exil. Mais le livre, lui aussi, est exilé ; publié au Portugal et non pas en France, son pays d’origine. Pourquoi ?
Fabrice Pataut: – Certaines de ces nouvelles, quatre ou cinq d’entre elles, ont été publiées par de petites maisons d’édition indépendantes, parfois sous la forme de beaux livres illustrés. La plupart étaient inédites. Il n’y a à cela aucune raison particulière, sinon qu’elles n’ont retenu en France l’attention de personne. La réponse habituelle d’un éditeur pour motiver son refus est que les volumes de nouvelles ne se vendent pas. Je ne crois pas que cela soit vrai. De très nombreux lecteurs sont amateurs de nouvelles. Mais peu importe la vérité. Je dois leur publication en langue portugaise à João Carlos Alvim, éditeur chez Livros do Brasil, qui les a lues en français, les a appréciées et a tenu à les publier ici, au Portugal.
– Vous dites dans la préface que la traduction leur donne une nouvelle vie et que vous préférez maintenant les lire en portugais.
– Je ne maîtrise pas le portugais, mais je peux néanmoins les relire avec beaucoup de plaisir dans cette langue, bien qu’elle me soit étrangère. Le portugais leur donne une nouvelle vie. Traduire, c’est réécrire. Il y a une sorte d’effet de distorsion lorsqu’on se relit dans une autre langue, et plus particulièrement dans une langue qu’on ne maîtrise pas mais qui reste par certains côtés proche de sa langue maternelle.
– Les nouvelles racontent-elles différents types d’exils?
– Oui. Elles parlent de gens qui sont en quelque sorte en transit, ou bien qui se trouvent d’une manière ou d’une autre déplacés, hors de leur pays d’origine, là où il n’était pas prévu qu’il soient. Je ne vivais pas en France quand je les ai écrites, mais aux États-Unis. Bien qu’elles l’aient été en français, il m’aurait été très difficile de situer leur action en France, d’en faire des nouvelles françaises. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi.
– Il semble qu’il manque quelque chose à presque tous les personnages. Pourquoi ? Qu’ont-ils tous en commun
– J’ai pu transmettre cette idée ou ce sentiment, mais c’est sans m’en rendre compte, sans en avoir eu l’intention. Il y a peut-être des motivations personnelles — profondes, comme on dit — mais ce n’est pas très intéressant. De manière plus littéraire, et c’est cela qui compte, il y a l’influence d’autres écrivains pour qui le manque dont vous parlez compte probablement. C’est une possibilité. Julio Cortázar est unauteur que je lis et relis sans cesse et qui exerce ici une influence importante, tout comme d’autres écrivains argentins, notamment Macedonio Fernández. Du côté portugais, je dois bien sûr indiquer Miguel Torga, un remaquable écrivain de nouvelles.
– Dans certaine nouvelles, par exemple dans « Vents », il semble que vous expérimentiez différentes façons de dire les choses, que vous vouliez jouer avec l’écriture.
– Ce n’est pas du tout intentionnel, bien que l’idée du jeu me plaise beaucoup. L’idée de cette nouvelle était plutôt de créer une ambiance, une atmosphère dans laquelle les personnages circulent, quoique sans aucune liberté. La « clé » est un autre exemple.
– Quelle est l’histoire que vous préférez?
– Peut-être bien « Les fourreurs ». C’est l’histoire d’un enfant qui s’endort dans un magasin, au milieu des fourrures, loin de ses amis, loin de sa famille. J’aime l’enfance, et plus encore l’histoire d’une enfance libérée de ses attaches. Les relations qu’entretiennent ces vieux fourreurs avec l’enfant qu’ils accueillent, pour une raison qui nous reste d’ailleurs inconnue, est une relation amoureuse. J’aime beaucoup cette situation, cet enfant, cette nostalgie.
– Y a-t-il quelque chose qui unit tous ces textes ? Et si oui, quoi ?
– Pour peu qu’il y ait une idée générale, elle doit tenir dans la distance extrême entre les personnages et les lieux où ils vivent. C’est le cas des Russes de New York dans « Coupelle », et aussi de la femme qui va jusqu’en Argentine pour boire du sang de taureau dans « Sangre de toro ». Pensez également à « L’histoire du cercueil de verre ». Il faut la lire comme une fausse histoire chinoise traditionnelle. Elle possède une vérité qui lui est propre ; en même temps, c’est un pur mensonge.
Note. Les nouvelles dont il est question dans la préface et l’entretien ont été publiées dans une version française un peu différente de celle qui a servi à la traductrice, d’abord dans le recueil Trouvé dans une poche (Buchet/Chastel, Paris, 2005, Prix de la nouvelle de l’Académie française) et ensuite dans Le Cas Perenfeld (Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2014).