Le franc-tireur intempestif
Entretien avec René-Victor Pilhes,
par JLK
René-Victor Pilhes représente par excellence le type de l’écrivain franc-tireur, qui poursuit une œuvre pleinement habitée et originale à l’écart des arènes médiatiques, mais en relation étroite avec les convulsions de l’époque. Dès son premier livre (La rhubarbe. Seuil 1965, Prix Médicis), la critique et les jurés littéraire, de même que le public, reconnurent ce talent si singulièrement hirsute, si peu «français» au sens de la fine distillation estampillée Mesure & Clarté, ou alors issu d’une autre France que celle de Monsieur Teste, dont les entrailles fument et les yeux regorgent de visions magiques, fortement enracinée et sexuée. Le Loum (Seuil, 1969) cristallise la partie qu’on pourrait dire psychanalytique de l’œuvre, dans une extravagante fable romanesque où apparaît une première fois le mystérieux pic phallique donnant son nom au livre, et que nous retrouvons dans La faux (Albin Michel, 1993), où l’auteur ramène, à sa terre d’origine de Haute-Ariège, un fascinant chevalier de la finance frappé dans sa chair par un cancer inguérissable.
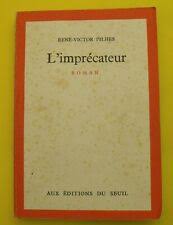
Après ses ouvrages d’exorcisme personnel, René-Victor Pilhes a signé d’autres romans non moins saisissants qui exploraient les soubassements de la société contemporaine. Rappelons notamment la fresque lézardée de L’imprécateur (Seuil, 1974, Prix Fémina), l’«hénaurme» satire des milieux de télévision de La médiatrice (Albin Michel, 1989) ou encore la méditation romanesque sur un tabou contemporain, dans L’Hitlérien (Albin Michel 1988), où l’auteur, figurant un exemple de discours néo-antisémite, mettait en lumière une spirale de haine qui n’a pas manqué de l’atteindre à son tour.
Totalement engagé dans son œuvre, dont il parle à la fois avec le légitime orgueil du créateur et la modestie du probe artisan, l’écrivain à l’accent chantant du Sud-Ouest nous a entretenu avec passion de son travail.

– Depuis quand écrivez- vous ?
– J’ ai écrit mon premier livre à vingt-cinq ans. Le livre n’était pas bon, mais il n’ en procédait pas moins d’ un ébranlement profond, traitant de la guerre d’ A lgérie. J’ ai passé là-bas vingt-huit mois de ma jeunesse et me prépare depuis longtemps à en reprendre le récit. Mais je me défends de raconter une histoire d’escadron, aussi est-ce loin d’être simple…
– Quelle est la genèse de La faux ? Et, plus généralement, comment vos livres viennent- ils au jour ?
– Mes livres naissent toujours d’ un grand trouble. Je ne peux guère écrire «sur» des sujets, même très intéressants, qui ne m’ aient profondément ébranlés. De mon premier roman paru, La Rhubarbe, un critique estima que c’ était «une geste fantastique et burlesque de la bâtardise». Le Loum, ensuite, qui en patois ariégois signifie lumière, est l’histoire d’un duel sans concession entre une mère et son fils, la narration de l’ascension d’un pic ayant une forme phallique par une femme qui a près de quatre- vingt dix ans et son vénérable rejeton qui en a passé soixante-cinq. Je suis moi-même un enfant adultérin. Je n’ ai pas été reconnu par mon père, et c’ est ma grand-mère qui m’a élevé. Je n’ai connu ma mère que lorsqu’elle venait, belle Parisienne, en vacances au mois d’ août. V ouc comprendrez que j’ avais en moi une profonde blessure.
– Quel rapport entretenez- vous avec la psychanalyse ?
– Aucun.
– Méfiance à l’égard de la concurrence ?
– (Riant) Peut-être. Mais à ce propos, je me rappelle que, lorsque parut Le Loum, Jacqueline Piatier, qui lui consacra le plus long article de sa carrière, avait pris les conseils d’un analyste pour mieux démêler l’ enchevêtrement de ce livre terrible.

– Après Le Loum, vous avez passé de la catharsis subjective à un point de vue sur le monde plus «objectif». Dans quelles circonstances ce tournant s’ est-il accompli ?
– Eh bien, à la fin des années 60, j’ ai connu un ébranlement d’une autre nature. Pour gagner ma vie, à l’époque, je travaillais dans une agence de publicité. Mêlé aux sphères directoriales de Publicis, je me trouvais à un poste d’observation très privilégié sur ce qu’on appelle le monde des affaires, puisqu’une agence traite avec de nombreuses entreprises privées ou publiques. J’ai donc vu à l’œuvre l’élite de la guerre économique en gestation. J’ai éprouvé le sentiment que quelque chose de très déliquescent travaillait cette société, dont l’apparence libérale entrave tout jugement, alors qu’il semble aller de soi qu’ on stigmatise une société totalitaire. J’ai alors pensé qu’au lieu d’une dictature obscurantiste, c’était une sorte de paganisme déchaîné qui foulait au pied les règles et les lois de la société. (Je précise que je suis laïc et que j’ai donné des instructions pour qu’on tienne les prêtres à distance de ma dépouille). En l’ occurrence, le trouble m’est venu lorsque, poussant l’ analyse, j’ ai eu l’ idée de prendre au mot cette notion de guerre économique. L ’ écrivain que je suis s’est donc mis en branle sur l’ idée que guerre économique et guerre ordinaire n’étaient pas si différentes que ça, comme on le voit d’ ailleurs aujourd’hui. Pendant cinq ans, la nuit – car le jour j’avais à gagner ma vie –, j’ai travaillé à un livre dont le projet était de ramener à plus de modestie cette seigneurie de l’argent. Pour ce faire, j’ai inventé une série de phénomènes qu’on ignore dans les écoles de management: des choses incroyables, irrationnelles, des forces obscures et immaîtrisées qui se lançaient à l’ assaut d’ une gigantesque entreprise, admirablement rodée et policée, dont tous les employés baignaient dans la félicité. Tel était L’Imprécateur qui a connu un succès international, a été traduit en vingt-huit langues et diffusé de façon telle que cela m’ a permis d’ abandonner mon travail alimentaire et de ne plus me consacrer qu’à mes livres.
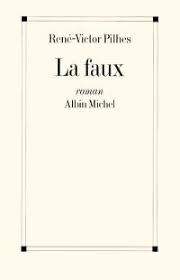
– Or venons-en, maintenant, à la genèse de La Faux...
– En ce qui concerne ce dernier roman, le trouble puissant qui a mis en branle mon imagi- nation est lié, je pense, à la mort. Malgré l’âge que j’ai, où l’on commence à voir ses amis disparaître, il ne me serait jamais venu à l’ esprit d’ écrire «sur» la mort. Le départ du livre, je l’ai personnellement vécu il y a quelques années, dans mon pays de Haute- Ariège, quand une pulsion formidable s’est emparée de moi. J’avais à me débarrasser de quelques orties et autres mauvaises herbes. Bon. Rien que de banal, me direz-vous. Je me suis donc procuré une faux moderne, c’est- à-dire légère et sans talon. Or celle-ci ne m’ a pas satisfait. J’ ai ressenti le besoin de retrouver une faux ancienne. J’en ai trouvé une énorme, fort difficile à manier, aussi ai-je requis les conseils de paysans du lieu, qui m’ ont enseigné leur art, m’ assistant même sur le terrain. Alors je me suis mis à faucher, tout un été durant, avec une sorte de jubilation inexplicable, une espèce d’ ardeur morbide. Imaginez la stupeur des gens de mon village natal ! Or précisément, ce fut cette stupeur qui me donna l’idée d’ écrire un roman, plus que la pensée de la mort elle-même. Sur quoi m’est apparu le personnage central, mythique et tout-puis- sant, frappé d’ un cancer mortel et qui va provoquer lui aussi la stupeur de son village d’ origine en y venant faucher pour de tout autres motifs que les miens…
– N’ y a-t-il pas aussi, dans cette fascination pour le geste ancestral du faucheur, une recherche nullement morbide de la filiation ?
– Vous avez raison: le thème de la filiation est essentiel pour le personnage, et d’ailleurs inscrite dans son nom de Faucheur- Quitus. Ses racines paysannes sont désignées par là même. Et ce n’est pas par hasard non plus que le personnage est très grand. Car ses ancêtres aussi étaient des géants.
– Vous avez parlé, à propos du processus de votre écriture, d’«inspiration convulsive». Qu’ entendez-vous exactement par là ?
– Lorsque j’écris, à un moment donné, j’ai l’impression d’être en butte à d’ étranges soubresauts. Lorsque j’évoque par exemple, dans mon livre, l’armée des faucheurs qui gravissent soudain la montagne, ce passage m’est pour ainsi dire dicté. Je ne vois plus du tout de faucheurs mais c’ est comme un montée d’ instruments dans une symphonie de Mahler. A de tels moments, je prends toujours des risques parce que je me laisse aller, sans prévoir du tout dans quel état je me retrouverai après, par rapport à ce que j’ avais prévu. Je procède par visions. C’est ainsi que, pour m’en tenir au même exemple, je me suis trouvé à la fin d’une journée, quittant mon bureau, à me dire simplement: demain, les faux vont monter…
– Que représente pour vous la tradition populaire ?
– Elle m’intéresse dans la mesure où elle était liée au travail et à la vie d’une communauté. J’ ai passé mon enfance dans un monde où elle était l’ expression naturelle des gens qui m’entouraient, mais je ne puis dire que ses manifestations me fascinaient particulièrement. Ce qui m’ attriste aujourd’ hui, c’ est la désertification de ces lieux, plus que la perte d’ un folklore pour touristes.
– Comment écrivez-vous ? Travaillez-vous beaucoup ?
– J’écris à la main tous les matins. L ’ après-midi, je transcris à la machine. Ensuite je laisse reposer. Puis je relis mon texte dactylographié, et le corrige encore à la main. Il m’arrive de le retaper car je ne dispose pas de l’ outillage sophistiqué de mes enfants. Enfin un dernier travail se fait, le cas échéant, sur le conseil de mon éditeur.
– Fréquentez-vous le milieu littéraire ?
– Ah non, pas du tout, rarissime ! Ca me nuit, quelques fois, mais que voulez-vous… Je regrette évidemment certains commentateurs de mes premiers livres, tels Kléber Haedens, Ro- bert Kanters, Jacqueline Piatier, qui représentaient encore la grande tradition de la critique littéraire, et qui m’ont littéralement porté. Mais il y a toujours, et même parmi la nouvelle génération, des critiques qui me suivent, et puis d’une façon générale on me connaît, je ne me plains pas. Certains de mes livres ont choqué, mais je ne crois pas nécessaire, à 59 ans, de commencer à faire des grâces…

– Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous appelez le «syndrome de Robin des Bois» ?
– Interrogé sur l’évolution économique et financière mondiale, le président Faucheur évoque l’émergence possible d’une nouvelle forme de terrorisme international, non plus fondé sur une idéologie politique mais sur une sorte de réaction instinctive et violente des gens, non seulement dans le tiers et le quart monde, mais de la part des centaines de millions d’ exclus, de chômeurs, d’oubliés et d’offensés qui se multiplient dans le monde tandis que, parallèlement, se développent la spéculation mondiale et les délits d’ initiés. Ce n’est pas là du tout un discours de gauchiste, mais l’expression d’ une inquiétude que j’ ai observée dans les hautes sphères, et c’est pourquoi je l’ai mise dans la bouche d’un super patron dont la raison d’être reste de gagner de l’argent. Quant à moi, je suis évidemment persuadé que le développement de cette globalisation off shore de l’économie, qui échappe à l’autorité juridique des nations, et qui ne pourrait donc être jugulée que par une nouvelle autorité supranationale à imaginer, constitue un danger pour nos civilisations. La révolte des manants que j’appelle «Syndrome de Robin des Bois» ne se perçoit encore qu’ à l’ état latent, mais je crains fort qu’elle ne devienne un thème brûlant de cette fin de siècle, par delà toute littérature…
(Archives du Passe-Muraille, No 9, octobre 1993)

