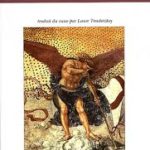Le labyrinthe aux mille miroirs
À propos du (splendide) roman de Mikhaïl Chichkine,
Le cheveu de Vénus.
Par René Zahnd
Quand le drogman retrouve, comme dans un rêve, sa vieille institutric Galpétra à Rome, celle-ci tout en parlant de mille choses décide de lui montrer « le plus important », un végétal qui coiffe une frise où l’on voit des dauphins : « Chez nous c’est une plante d’intérieur, qui a besoin de la chaleur des hommes pour survivre, mais ici, elle pousse comme de la mauvaise herbe. Son nom, dans une langue morte qui désigne les choses vivantes, est Adiantum capil-lus veneris. L’herbe drue de la famille des adiantacées. Le cheveu de Vénus. Le dieu de la vie.
Il frémit légèrement dans le vent, comme s’il hochait la tête pour dire oui : oui, oui, c’est bien cela, c’est mon tem- ple, ma terre, mon vent, ma vie. L’herbe des herbes. » Et soudain, tout semble dit. Mais que de chemins par- courus pour en arriver là ! Avant de lui faire découvrir l’herbe des herbes, Mikhaïl Chichkine a entraîné son lecteur dans un fabuleux la- byrinthe, un palais des glaces aux reflets surprenants, où s’entremêlent les époques, les destins, les références, les échos, comme si entre le conflit tchétchène et les guer- res de l’Antiquité il n’y avait qu’un souffle de mort, alors qu’en tout temps et partout, des êtres opposent à l’haleine de la Faucheuse leur furieux désir de vie et leur fabuleuse capacité d’invention. Pas de doute : pour se retrouver face à l’herbe des herbes, il fallait bien le livre des livres.
Si l’on s’ingénie à décortiquer cette puissante fresque, on constatera d’abord qu’elle résulte d’une sorte de double culture. On y trouve à la fois des passages profondément empreints « d’âme russe » et, dans l’usage de la polyphonie, dans la construction complexe de l’ouvrage, une application des techniques romanesques de l’Europe occidentale. Par bonheur, les échafaudages de cette savante construction ne sont pas visibles : les éléments sont fondus les uns aux autres dans une même incandescence poétique.
Le narrateur sert d’interprète dans un centre de tri pour requérants d’asile en Suisse. Il lit Xénophon et traduit pour le chef du service, qualifié de « Maître des Desti- nées », les propos des personnes interrogées. Très rapide- ment, le jeu des questions et des réponses qui traverse tout le roman s’écarte des conven- tions documentalistes. On glisse dans des univers où aux récits évoquant les horreurs de la guerre se mêlent une part délirante, l’imagination part au grand galop, nourrie par tout un fond de contes populaires et d’histoires fabuleuses. C’est comme si les frontières entre mythomanie et mythe devenaient pour le moins in- certaines. Ce d’autant que très rapidement l’identité des deux voix se brouille. Qui interroge ? Qui témoigne ? A croire que Question et Réponse devien- nent deux personnages d’un théâtre intime, fantasmagorique, où l’on chercherait par mille détours non pas à cer- ner, mais à humer le mystère de la vie et des destinées.
Ce même narrateur écrit aussi des lettres pleines de fantaisie à un dénommé Nabuchodonosor, qui n’est autre que son enfant, resté fort loin de son père. Et le narrateur, encore lui, entreprend d’écrire le journal émouvant d’une jeune fille russe au début du XXème siècle et qui deviendra cantatrice. Cette prose parle beaucoup de choses qui semblent frivoles, s’attarde sur les amours de Bella, ses déboires, sa carrière entre Paris et Moscou, alors qu’elle passe comme chatte sur braise sur le cortège des atrocités qui marque le temps, de la première guerre mondiale (où elle perd tout de même son Alliocha) aux grandes heures du stalinisme.
Cette voix de femme, superbement rendue, semble rappeler à chaque instant que la vie continue et qu’aux se-cousses sombres de l’Histoire, on peut opposer sans avoir à en rougir ses désirs intimes. Et le narrateur, toujours lui, rendra compte de son séjour à Rome où, s’il perd définitivement son Iseult, il semble se retrouver lui-même.
Des aventures de Cyrrus à la guerre en Afghanistan, du « petit pois » qui germe dans le ventre de Bella au requérant qui croise le fer avec son avocate, tout cela est mêlé dans un livre d’une maîtrise éblouissante. Par ses soulèvements poétiques, par son savant jeu d’échos et de résonances, il touche à quelque chose de l’humaine condition, au-delà des époques et des situations géographiques. Ou quand l’art romanesque se déploie dans toute sa splendeur.
Mikhaïl Chichkine, Le cheveu de Vénus, remarquablement traduit du russe par Laure Troubetzkoy, Fayard, 2007, 444 pages.