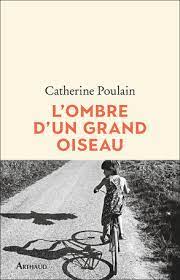Comme une enfance grappillée
À propos de L’ombre d’un grand oiseau, de Catherine Poulain
par Alain Dugrand

Septembre. Disparus les martinets, les rouge-gorge, effacés les accenteurs mouchets, ceux que Buffon nommait « traîne-buisson » simplement. Bienvenue, place aux buses, pies et corbeaux ! C’est le même refrain au terme de chaque été, les noisetiers s’effeuillent sur des terres roussies de trop de chaleur. En regrets de congés payés, les canards affichent en une : « rentrée littéraire ». Dans leurs pages, on retrouve de vieilles gloires, des épopées intimes, tendrons violentés, des roublards, diaristes et chasseurs de primes. Le lecteur se méfie. Normal. Croassements, caquets critiques et jacteurs épuisés, on observe, sceptique, les teintes affolantes du dernier perroquet d’Amazone au jardin, celles d’un pic-vert qui fore l’écorce moussue du vieux poirier au verger. On espère la décantation de la première pressée, donnera-t-elle ce rouge fruité, sublime, qui sait ?
Quant à Catherine Poulain, celle-ci publie un livre splendide : L’Ombre d’un grand oiseau.Quatre récits d’une enfantelette farouche, sauvageonne, père pasteur, mère radicale, enfance calviniste.

Auteure mondialement lue avec un best-seller, Le Grand marin, en édition de poche désormais. Catherine Poulain relatait des années de travail à bord du Rebel, un palangrier inscrit à Kodiak, Alaska. Seule femme à bord d’un équipage de marins pêcheurs, elle écrivait les temps vécus au large d’Anchorage, Pacifique Nord, the last frontier. Le lecteur découvrait l’existence d’une Lili dégoutante de sang, ouvrant le ventre des morues noires dont à cru elle gobait les poches de laitance. Drues, âpres, ces pages n’étaient pas le fruit d’une imaginative, mais celles d’une aventurière coureuse de routes, compagne attentive des saumons dans leur run de retour vers les sources. Lili, charcutière de flétans, chassant du balai-brosse les viscères sanglants du pont par les écoutilles du navire abattoir.
Etrange vendangeuse, bergère de troupeaux, soigneuse de brebis de Haute Ubaye, cueilleuse des bractées du tilleul en Baronnies, Catherine Poulain est sans cesse en chemin. Lectrice de Faulkner, Steinbeck, London, son genre possède quelque chose de la radicale exigence d’un André Gide, d’un Théodore Monod, ces auteurs parpaillots qui nous font pencher vers le fameux axiome : « Qui n’a pas souffert, qui n’a pas vécu a bien peu à écrire. »
Fille d’une haute vallée occitane, avec L’Ombre d’un grand oiseau celle-ci évoque l’enfance, le chagrin ressenti à l’égard d’une abeille intrépide, égarée, perdue sur une dernière neige. L’enfant pleure toutes les larmes possibles quand, malgré le sauvetage d’une cuillerée de miel, l’insecte défuncte sur l’assiette. Etrange gamine fascinée par les mouches. Les plus belles, vertes ou bleues, en saison des mirabelles éclatées à la margelle du puits. La souplesse d’une limace, d’une couleuvre d’eau dans les mains. Et les questions s’enchaînent, innocentes et graves : « Qui se rappelle pourquoi on n’entend plus chanter le coucou après le 15 août ? Peu de gens savent que c’est en mémoire des oisillons morts dans l’incendie du Gerbier. Depuis, en signe de deuil, les coucous se taisent tous lorsque revient le temps des moissons, tandis que la femelle abandonne ses œufs dans un autre nid, le sien ayant brûlé avec sa couvée. »
De presbytère en presbytère, la fille du pasteur, aux premières froidures, observe un merle juvénile abandonné, survivant à la courbure d’un cyprès mutilé. Quand les oiseaux le survolent, l’oisillon, ailes écartées, tendant cou et bec grand ouvert, espère la becquée. « Mais, toujours, les autres poursuivaient leur vol. Ne regarde plus, me dit maman, autrement je vais mettre ma main sur tes yeux. Mais moi, je ne pouvais. J’aurais tout donné pour le nourrir, aller encore une fois creuser la terre pour lui ramener de ces lombrics gras et rosés. »
La prose de ces pages jaillie du lot des livraisons de rentrée vous prend au cœur. Un ton, de pareilles réminiscences nous saisissent à l’évocation de ce vélo d’enfant, une « Hirondelle » de la manufacture de Saint-Etienne, rouge ; à ces tortillons adhésifs emprisonnant les mouches folâtres dans leur glu. A son tour, le lecteur s’adonne au piège de cette « punaise marbrée qui erre, lentement, sur la vitre du Velux ».
Ces pages tissent, composent une ode aux insectes, aux oiseaux, aux animaux, leur fragilité. « J’ai vu des troupeaux décimés par des meutes, brebis agonisantes, poitrail ouvert. Le cœur à nu pulsait encore. Leur regard. Qui va protéger la proie ? » Mais que vivent réellement outardes, bernaches, la fin annoncée du chien Mozart, l’épervier et la mésange, l’envol libéré d’une fauconne borgne, soignée, ce choucas hésitant, les grues cendrées de retour, enfin, sur cet enclave de Médoc qui pourrait s’appeler Solitudes, Silences, « notre presqu’île bordée d’eau, l’océan à l’ouest, la rivière à l’est, leur rencontre au nord – ancrée entre vignes et forêts qui peu à peu se raréfient, s’estompent, jusqu’à disparaître lorsqu’on remonte vers les terres nues de la pointe, laissant place à d’anciens marécages asséchés aujourd’hui. De chaque côté de l’unique route, de petits chevaux et des vaches paissent sous un ciel exténué de course. »
Juré du prix Nicolas-Bouvier, contemporain de Jean Giono, homme de Grèce, Digne et Manosque, provinces tragiques, Gilles Lapouge, rencontrant Catherine Poulain pour la première fois, murmurait : « Noiraude, noueuse comme un rameau de lavande trop longtemps négligé, cette brune est des garrigues, c’est une femme de chez nous. » Sauvage. Ecrivaine des êtres, des choses, d’une fauconne borgne. « C’était l’hiver. Ca sentait l’étoupe, l’huile de lin, le bois détrempé, le varech, mon sac de couchage humide qui puait le fauve. J’entendais la mer, blottie sous les coques. J’avais froid souvent. Un vieux pêcheur en rade me donnait de la soupe chaude. Il m’avait offert un pistolet et des jarretelles rouge grenat, trouvées à l’Armée du Salut. Elles étaient belles. Je les portais sous mes joggings élimés, mes sweaters de coton dont j’avais taillé l’encolure au couteau. »
A. D.
Catherine Poulain. L’ombre d’un grand oiseau. Editions Arthaud, 192p.2023.