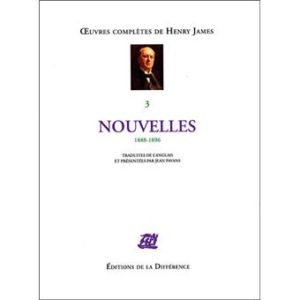Un grand nouvelliste du secret
Henry James en ses Œuvres complètes,
par Gérard Joulié
Henry James est un grand écrivain qui a erré toute sa vie dans les limbes littéraires entre le paradis de la culture européenne et l’enfer de l’Age d’or américain. Trop fin pour supporter la vulgarité d’une atmosphère irrespirable pour un artiste, trop puritain de Boston pour se sentir tout à fait à l’aise dans une Europe réaliste, il fut pendant la plus longue partie de sa vie un déraciné. Le milieu où il trouva quelque réconfort spirituel fut celui de l’aristocratie britannique. Les châteaux dans les parcs immenses, les belles jeunes femmes anglaises, les écrivains qu’elles recevaient chaque week-end furent pour lui ce qu’avait été pour les moralistes et poètes du XVII’ siècle français le monde de la Cour. Comme eux James en était arrivé à penser que seule une société de loisirs, héritière d’une longue civilisation, constitue un milieu favorable à l’éclosion des sentiments. Là il trouva une humanité qui, parce qu’elle n’avait rien à faire, porta la personne humaine à un extraordinaire degré de perfection, et qui n’eut d’autres problèmes que ceux de l’âme. L’un de ses thèmes favoris fut celui de l’innocence américaine confrontée à la vieille Europe raffinée et corrompue. Il se fit pour ces analyses un style chargé d’incidentes qui annonce Proust. Plusieurs de ses nouvelles sont des chefs-d’oeuvre.

On devrait d’abord dire, pour résumer l’oeuvre d’Henry James, ou pour la présenter à ceux qui l’ignorent, que si ses personnages avaient pu s’exprimer librement il n’y aurait jamais eu d’oeuvre d’Henry James… Le drame est justement qu’ils ne peuvent s’exprimer librement. «Il y a bien des choses qui sont trop délicates pour qu’on puisse les penser, à plus forte raison pour qu’on puisse les dire», a écrit Novalis. Ce sont ces choses-là qui font le sujet des romans et des nouvelles de James. Il est permis de supposer, depuis l’apparition de la psychanalyse, que tout malentendu entre deux êtres disparaît si ces deux êtres ont la force de parler avec une extrême brutalité des problèmes qui les divisent. Mais, d’une part, il n’est pas permis à chacun de parler avec brutalité, et, d’autre part, les nuances de nos sentiments, et surtout les plus douloureux, sont si fragiles, si changeantes que la lumière du plein air tolère difficilement leur présence. Nous n’avons pas assez de phrases à notre disposition pour leur donner forme, et même si nous le pouvions la pudeur nous en empêcherait.
La pudeur, voilà la maladie fondamentale dont les héros de James sont affligés. Les lecteurs sont habitués, à présent, à ce qu’on leur dise tout, et un peu plus. Mais cela équivaut à ne plus rien dire du tout, parce que l’expression d’une chose, d’un sentiment est un savant mélange d’ombre et de lumière; et c’est en quoi notre auteur excelle.
Tout tourne, dans les nouvelles de James, autour d’un secret, et ce secret est avidement poursuivi de page en page par les protagonistes, mais ce secret ne nous est jamais complètement connu. Son principal intérêt, aux yeux de l’auteur, est la multiplicité des réactions qu’il éveille chez ceux qui veulent le connaître. «Je fais mes délices, écrivait James à un ami, d’un passé palpable, imaginable, visitable… des marques et des signes d’un monde que nous pourrions toucher… de la poésie des choses perdues et disparues». Mais le passé est inviolable, car on ne saurait le saisir directement. Une illumination intérieure de l’esprit peut seule en donner la sensation.
Dans Les papiers de Jeffrey Aspern, le héros veut pénétrer les souvenirs lointains de Mlle Bordereau, jadis maîtresse du grand poète Aspern, et convoite les lettres qu’elle a reçues de celui-ci. Incarnation du passé, elle est représentée à dessein avec une sorte de visière cachant ses yeux. Ce n’est pas dans ses tiroirs qu’il va jusqu’à vouloir forcer, mais dans le regard de la vieille dame, la seule fois qu’elle le lui dé-couvre, qu’il reçoit subitement la révélation de son passé — le vrai et grand amour entre Aspern et elle.
Dans L’auteur de Beltraffio, un jeune admirateur rend visite à un écrivain célèbre. Après les premiers enchantements — le charme du cottage, la prestance du maître, la douceur de son épouse et la beauté androgyne de leur enfant —le visiteur découvre la face cachée de la réalité: la mésentente profonde, meurtrière, qui sépare les époux au sujet de l’éducation de leur fils. On sait qu’en vérité la nouvelle concerne la mésentente de l’écrivain homosexuel John Aldington Symonds, et de sa femme. Or voici l’étrange: à aucun moment du drame, son aspect sexuel n’est abordé, ni même posé, fût-ce par la plus discrète allusion. Au vrai, la société victorienne avait pris à la lettre, non parce qu’elle était vertueuse — quelle société peut l’être ? —, mais parce qu’elle était hypocrite — quelle société ne l’est pas ? le conseil de l’Apôtre: qu’il ne soit pas question de ces choses entre vous. S’il en avait été question, ou si mari et femme avaient pris conscience de leurs penchants et de leur singularité, l’oeuvre y aurait-elle gagné en profondeur ? C’est un fait que L’auteur de Beltraffio, exempte de toute psychologie, donne l’étude la plus poussée de ce combat scabreux entre deux époux, et dont un petit garçon est l’enjeu. L’hypocrisie évidente et l’esthétisme ambiant de la fin du siècle servent d’alibi non seulement aux personnages, mais à l’auteur et à ses lecteurs anglo-saxons de 1900. A l’abri de cette fiction tout nous est dit, non de ce que peuvent faire d’horrible, mais de ce que ressentent un homme et une femme également nobles, engagés dans un conflit de cet ordre. La tristesse insidieuse de cette nouvelle rap-pelle celle de L’Elève et du Tour d’ écrou, où les enfants préfèrent la mort aux tiraillements qui les déchirent.
Dans Daisy Miller, cette nouvelle qui débute à l’hôtel des Trois Couronnes de Vevey, James a personnifié une fois de plus l’innocence américaine et le «droit de chacun de vivre sa vie». Le seul tort de Daisy est d’en faire à sa tête sans se soucier des conventions. A Rome, accompagnée de sa mère et de son petit frère, elle s’amuse avec Gianelli, galant peu recommandable. «Elle fait tout ce qui ne se fait pas ici, dit d’elle une dame romaine, caqueter avec le premier venu, s’asseoir dans les coins avec de mystérieux inconnus, danser tous les soirs avec les mêmes cavaliers »… Victime de l’incompréhension de la bonne société et de sa morale bornée, Daisy, sûre d’elle-même et de sa pureté, va d’excès en excès, contracte le paludisme un soir de lune au Colisée et meurt. On pense à ce mot du Prince de Ligne selon lequel les femmes honnêtes courent plus de risques que les autres parce qu’elles ne s’attendent pas à ce qui va se passer et rougiraient de prendre des précautions. L’art avec lequel cette nouvelle est traitée en fait un véritable chef-d’oeuvre, et chaque phrase lui crée comme un accompagnement de musique et de poésie qui retentit longtemps en nous. Il y a dans cette figure de Daisy une expression qui n’est pas d’ici, pure, profonde, d’une sérénité et d’une résolution impressionnantes. Ces héroïnes, James les a cherchées et trouvées, depuis Madame de Cintré dans L’Américain, jusqu’à l’Isabelle Archer du Portrait d’une dame, en passant par Maisie, Milly (Les ailes de la colombe) et la gouvernante du Tour d’écrou. Il a rêvé ses créatures idéales, jamais abaissées par la vie, trahies par leurs proches, mais insoucieuses de cette société de tromperie qu’elles traversent comme une momerie et dont elles meurent.
Car il ne faut pas s’y tromper: le monde de James est un monde de corruption, de dissimulation, de trahison et, oserais-je le dire, de damnation. Il n’est pas d’oeuvre qui fasse plus résolument du Mal l’objet de son propos, mais il n’en est pas non plus où tant de raffinement se mêle à cette peinture. Ses nouvelles les plus abstraites, il faut les admirer de confiance. Nous voici arrivés, avec Henry James, à l’extrême pointe de la pudeur. La satisfaction qu’on éprouve devant son art est d’une qualité à ce point immatérielle que tout en nous sachant redevables aux sens, c’est à l’intelligence que nous en rendons grâces.
G.J.