Dans l’amitié d’Alain Gerber

Éloge d’un grand méconnu, romancier et poète jazzy,
par JLK
Alain Gerber était, à trente ans, à la parution de son premier livre, La couleur orange, le type du doux oiseau de jeunesse de province (il est né à Belfort en 1943), du genre fou de Jarry et de jazz, de cinéma et de romans américains (auxquels, avec deux trois compères, l’avait initié son prof de lycée Henri Baudin), qui rêvait de devenir si possible Hemingway et distillait déjà, avec un lyrisme bluesy, la mélancolie des anges terriens conscients qu’il battront tant un jour de l’aile qu’ils ne s’en relèveront plus.

Un peu moins de trente ans plus tard et avec quarante livres jonchant son sillon de grand laboureur, dans un bar parisien proche de Radio-France où tous les soirs il raconte le roman du jazz, notre ami Alain (une amitié nourrie par ces coups de coeur successifs que nous valurent Le Buffet de la gare en 1976, Le Faubourg des coups-de-triques en 1979, les inoubliables nouvelles des Jours de vin et de roses en 1982, puis distraite et distendue comme souvent par «la vie», relancée avec le très beau quatuor de la cinquantaine que fut Quatre saisons à Venise, en 1996, et ravivée plus encore par le sentiment profond de stoïcisme fraternel qui se dégage de son dernier roman) paraît à vrai dire plus frais et libre qu’à l’époque où l’exténuait la course aux prix littéraires.
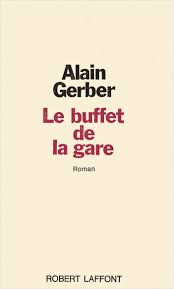
L’auteur du Plaisir des sens (1977) et de La porte d’oubli (1993) eût certes mérité plusieurs fois le Goncourt, mais il ne saurait pourtant être dit un maudit (l’ensemble de son oeuvre lui a valu le Grand Prix du roman de la Ville de Paris, entre autres distinctions), même si le public lui est plus fidèle que la critique établie, qui le snobe plutôt. A sa façon de sanglier des Vosges, avec sa chère moitié dédicataire de tous ses livres, il a fait sa vie à l’écart des estrades et des cénacles, souriant aujourd’hui de «tout ça» et se réjouissant surtout d’écrire enfin avec plaisir.
«Pendant des années, j’ai travaillé dans la peine et le labeur, mais j’étais convaincu que c’était le prix à payer. J’ai mis beaucoup de temps à me trouver en harmonie avec ce que j’écrivais. C’est peut-être avec ce dernier roman, où j’ai vraiment dit exactement ce que je voulais, que le bonheur d’écrire m’est venu. A présent, il faudrait presque m’arracher de ma chaise, même si je travaille toujours beaucoup dans la masse. C’est vrai que je suis un cheval de labours et qui ne se retourne pas… Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir fait «une oeuvre». A l’origine, je crois que je je n’aurais jamais écrit si je ne m’étais pas mis dans la peau d’un écrivain américain behaviouriste. Non, sans Hemingway, je n’aurais jamais écrit. C’était un peu contre mon naturel, qui était plus «lucide» et plus porté aux idées. Je ne suis pas poète, mais ce qui m’a quand même intéressé dans le roman, c’est de faire dire aux mots ce que les mots ne son pas capables de dire. C’est d’ailleurs la définition qu’on donne de la musique…»
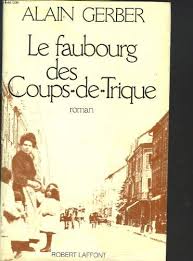
De la musique, il en ruisselle dans l’oeuvre d’Alain Gerber, et pas seulement quand il brosse ses «portraits en jazz» ou lorsqu’il se glisse carrément dans la peau de Lester Young, de Clifford Brown ou, tout récement, de Bill Evans. Or, à propos de ces livres apparemment distincts de ses fictions, Alain Gerber se défend d’avoir composé des biographies.
«En racontant Lester Young ou Bill Evans, je ne fais en somme que me raconter d’une autre façon. Avec Bill Evans, plus précisément, c’est un retour à ma source «philosophique». Par ailleurs, le milieu du jazz est celui que je fréquente de la manière la plus proche et constante, depuis des années, et en même temps celui que je comprends le moins. Je vois ces gens vivre et se défoncer, je ne vis absolument pas leur vie de dingues, mais j’essaie néanmoins de les rejoindre en écrivant. De la même façon, je fais de la batterie depuis plus de quarante ans, et je ne suis toujours pas fichu de jouer. Jouer de la musique est un truc tellement mystérieux, au sens le plus fort, presque au sens religieux… Or, je me dis souvent que si j’en avais le secret, j’aurais le secret de beaucoup d’autres choses.
Ce même introuvable «secret» se trouve, en somme, au coeur de Jours de brume sur les hauts plateaux, dernier roman d’Alain Gerber que d’aucuns, un peu trop vite, auront classé dans la postérité du Désert des Tartares, sous prétexte que l’histoire se passe dans une garnison «oubliée» de l’Histoire, en pleine brume cochinchinoise.
«Après en avoir écrit une quarantaine de pages sans penser du tout à Buzzati, je me suis dit tout à coup qu’on allait me tomber dessus avec cette comparaison, et j’ai donc laissé ce texte de côté, que j’ai repris des années plus tard pour l’achever en trois semaines. Quant à son vrai déclencheur, c’est plutôt du côté de La 317e section qu’il faut le chercher. Ce film m’avait bouleversé à l’époque, et quelque chose en reste évidemment dans le rapport liant les deux officiers.»
Le thème de la filiation, qu’Alain Gerber lui-même dit présent dans tous ses livres, fonde la relation initiatique établie entre le commandant vieillissant et son jeune second impatient de prouver sa valeur, qu’un adjudant baroudeur va éprouver plus physiquement de son côté. Très «physique» aussi bien, ce roman à tournure de conte philosophique baigne dans un climat de fantasmagorie où les données bien terrestres de l’action, de la force, de l’élan guerrier, du désir sexuel, se mêlent, dans ce no man’s land, à celles du vieillissement, de la faiblesse, de la conscience de plus en plus aiguë de la vanité de toutes choses.
«La première de toutes mes révoltes, explique encore Alain Gerber, je l’ai éprouvée dans ma toute petite enfance, lorsque je me suis rendu compte que nous devrions mourir. Cette énormité m’est apparue: que les gens qui m’entouraient seraient morts lorsque j’aurais leur âge. Plus tard j’ai choisi, comme ma femme, et même avant que nous nous rencontrions, de ne pas avoir d’enfant. L’idée de savoir, à mes côtés, une pendule vivante qui me rappellerait tous les jours que devrais mourir m’était insupportable. C’est peut-être pour m’en «excuser», d’une façon inconsciente, que je reviens sans cesse à ce thème de la filiation… Je ne sais pas, pas plus que je ne sais pourquoi j’écris… J’ai besoin, toujours, de sentir le trousseau dans ma main, mais je ne sais pas quelles portes mes clefs vont ouvrir…»
Alain Gerber. Jours de brumes sur les hauts plateaux. Fayard, 167p.
Alain Gerber. Bill Evans. préface de Pierre Bouteiller. Fayard, 360p.
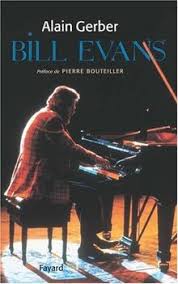
Alain Gerber a publié, récemment un nouveau roman-jazz consacré à Frank Sinatra, chez Fayard.
