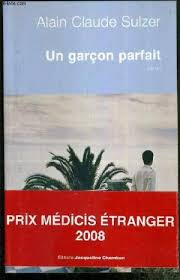Un amour peut en cacher un autre
Un garçon parfait, d’Alain Claude Sulzer
Par Jean Perrenoud
Jamais je n’aurais imaginé un roman d’une telle densité en commençant Un garçon parfait d’Alain Claude Sulzer. Ce roman paru en 2004, le premier traduit (remarquablement) en français de cet auteur suisse alémanique, offre une grande maîtrise de l’écriture, dans un style proche du Nouveau Roman ou de L’Etranger d’Albert Camus : «Ernest attendait le bateau à vapeur. Sa vie se déroulait sans projet et il ne ressentait aucune vacuité. Lorsque quelqu’un faisait des projets pour lui, c’était des gens qu’il connaissait et qu’il écoutait volontiers. Le travail à l’hôtel lui donnait plus qu’un sentiment de sécurité, il s’y sentait à l’abri. Le soir, quand il s’écroulait de fatigue dans son lit, il se sentait en sûreté, et cette sécurité le berçait aussitôt. Il n’avait aucune raison de désirer une autre existence».
Voici donc un nouvel étranger à lui-même, sorte de bel au bois dormant. De cette léthargie, Ernest, le garçon parfait (jeu de mot créé aussi par la traduction française), en sera brutalement sorti à deux reprises : une première fois avant guerre par l’amour et une seconde fois trente ans plus tard par une sorte de fantôme qui se manifestera sous la forme de deux lettres postées des Etats-Unis.
Ernest ne sortira pas indemne de cette aventure ni du coma dans lequel il s’est par deux fois plongé volontairement. La brutalité de la réalité va le rattraper, comme nous rattrape sans cesse la brutalité de ce XXe siècle qui reste nôtre. En entremêlant, chapitre après chapitre, avant et après-guerre, Sulzer nous conduit peu à peu à découvrir, avec Ernest, sa véritable identité.
Klinger, écrivain allemand célèbre qui fuit le nazisme, fait une halte dans l’hôtel où sert Ernest comme garçon de salle. Il y fera la connaissance de Jacob, ami d’Ernest, qu’il emportera dans ses bagages vers le Nouveau monde. Mais Sulzer ne parle pas seulement d’une banale histoire de rivalité amoureuse : il dresse aussi les portraits subtils de divers personnages.
Ainsi celui de l’écrivain : « Julius Klinger était un homme sensible, sensible mais aussi fragile, un homme qui se sentait exclusivement investi de la mission de suivre ses pensées et de trouver les mots justes pour les transcrire. Il exerçait une profession dont les conditions n’étaient même pas soupçonnées par ses lecteurs. Ceux-ci étaient sans doute convaincus que l’écrivain à succès engrangeait les mots aussi aisément que le spéculateur habile les retours sur investissement. Sa véritable vie n’avait pas lieu dans quelque salle à manger ou salon, mais à son bureau devant une feuille de papier, tout le reste ne l’intéressait que de façon périphérique, pour passer le temps ou, mieux, comme motivation dans son travail ».
Les descriptions sont précises, jamais gratuites, utiles au récit : «Une grosse mouche cognait de façon répétée contre la vitre, mais Ernest était le seul à remarquer ses vaines tentatives de fuite. Sur le lit défait gisait la serviette humide de Jacob, la serviette qu’il utilisait pour se rafraîchir. Sur la serviette était posée une pièce de cinq francs toute neuve, la récompense pour son zèle à veiller au bien-être de Klinger, et la main droite d’Ernest se mit à frémir à sa vue».
Les amours évoquées dans le récit sont fortes, car clan-destines ; à croire qu’en apparaissant au grand jour elles se flétriraient irrémédiablement.Certains esprits grincheux feront sans doute la fine bouche et une moue dégoûtée devant la passion d’Ernest et Klinger pour Jacob : «Et voilà, les pédés sont à la mode!»
Eh bien non, peu importe ici le sexe des protagonistes. L’acte d’écriture, faut-il le rappeler, n’est pas homo ou hétéro. L’écriture est. Elle décrit, elle nous apporte des images. C’est à nous, lectrices et lecteurs, de butiner et d’en concevoir notre propre miel.
«Et Sulzer, est-il gay?» Personnellement, je m’en moque. Le rythme de ce récit seul m’importe : c’est tout. C’est beaucoup. Connaître les préférences sexuelles de l’écrivain n’ajoute rien. Il est cependant assez piquant de remarquer que, le jour où je termine ma lecture du roman de Sulzer, je reçoive une lettre m’infor-mant que les œuvres d’Yves Navarre comme Le Jardin d’acclimatation ou Ce sont amis que vent emporte ne seront pas republiés par les éditions Flammarion qui cèdent ainsi volontiers leurs droits (comme aussi Robert Laffont) à d’autres éditeurs plus pugnaces. Yves Navarre s’était vu refuser la parution du Temps voulu chez Laffont justement, avec la phrase cinglante : « Dommage que Pierre ne s’appelle pas Martine ».
Le Jacob de notre Garçon parfait, trente ans après Le Temps voulu, ne s’appelle pas non plus Martine… bien heureusement.
J.P.
Alain Claude Sulzer. Un Garçon parfait. Traduction de Johannes Honigmann. Editions Jacqueline Chambon et Actes Sud, 326p.