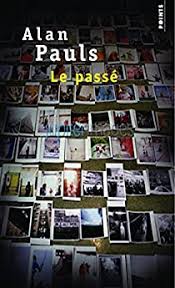Quand le passé passe mal
Sur Le Passé d’Alan Pauls,
par Hélène Mauler
«Il ne regardait pas une photo et disait: Ce que je regarde est arrivé; il disait: ce que je regarde est arrivé, est mort et moi, jai survécu.» Alan Pauls
C’est l’histoire d’une séparation qui avait tout pour réussir : le « chemin de réciprocité exclusive» dont on est deux à s’éloigner imperceptiblement, deux à pressentir le bout; le regard clair que l’on jette sur le passé commun, chacun de son côté, comme une dernière preuve d’amour; et les adieux minutieusement planifiés, organisés, purifiés ainsi, croit-on, de toute amertume et de tout ressentiment.
C’est l’histoire d’une séparation qui « n’était pas l’au-delà de l’amour : elle était sa limite, son sommet, le bord interne de ses confins; si elle se consumait comme ils se proposaient de la consumer, amoureusement, c’était ce qui lui permettrait d’avoir une bonne mort; c’est-à-dire, dans leurs mots, de continuer à vivre sans eux à l’intérieur de la bulle qu’ils avaient créée. » C’est l’histoire d’une séparation qui se voulait sans rupture — sans luttes, sans cris, sans manoeuvres vengeresses —et qui ainsi inventée ne sera jamais une séparation mais une porte laissée grande ouverte où la mémoire siffle aux oreilles comme un souffle corrosif et glaçant, mettant les coeurs et les corps à nu ; où le passé s’engouffre par blocs entiers, pulvérisant au petit bonheur le présent, le futur. La vie.
C’est l’histoire de la séparation de Rimini et Sofia et, imparablement, de leurs retrouvailles tout au bout d’un passé qui n’en finit pas de passer. Car même relégué dans les replis du souvenir, même recouvert des lourdes strates d’un présent très quotidien, le passé affleure et impose jour après jour sa présence recrudescente et influente, menace permanente sur toute ébauche d’un avenir autre. Et si Le Passé est le titre de ce roman plein à craquer d’une énergie tendue comme un arc électrique, c’est aussi qu’il en est sans conteste le personnage principal.
Rimini et Sofia, donc, ont décidé de briser la bulle qui, depuis douze ans, est à la fois leur enfermement et leur protection. Rimini plus que Sofia, semble-t-il. Par lassitude, par défi, par appétit et curiosité d’autre chose, peu importe : la bulle doit éclater, éclater comme une délivrance. Mais la membrane est solide, épaissie par douze années de vie sans ennui, et l’explosion libératrice tant espérée va prendre, pour Rimini, les allures d’un long effort d’extirpation : extirpation de la présence latente de Sofia, avec sa graphomanie et sa pré-sence solaire dans les lieux les plus improbables de Buenos Aires, extirpation du passé et de son lot de photos mortes — extirpation par le truchement de la cocaïne, de la traduction compulsive, du sexe et du temps, dont on dit qu’il efface tout. Extirpation par la fuite. Vouée à l’échec. Et peu glorieuse.
C’est en effet un personnage peu sympathique que Rimini, avec son inertie, sa promptitude à s’évanouir, son éloignement de la réalité, son incapacité, et celle de son corps, à prendre des décisions généreuses, sa façon d’enregistrer les événements plus qu’il ne les vit, de se reposer sur la fatalité comme sur « une couche douce et moelleuse» — et sa peur des fulgurances de l’intensité, sa « docilité impassible d’orphelin » quand il retrouvera Sofia… Mais il a aussi, partagée avec Sofia depuis la nuit des temps, une admiration inconditionnelle pour Riltse, artiste imaginaire, adepte d’un Sick Art tout aussi imaginaire, dont Alan Pauls nous livre une « analyse critique » aussi féroce que cocasse — «Le Sick Art comme économie du double don, comme infection croisée : ne pas faire donation de la maladie à l’art sans faire donation de l’art à la maladie, et vice versa ; » artistiser la maladie sans rendre l’art malade »… le Sick Art comme prétexte à un extraordinaire exercice d’écriture ! Vibrant, incisif, impitoyable. Avec une certaine emphase parfois, comme dans tout le reste du roman, et des longueurs, et des phrases ondoyantes et enchevêtrées à souhait, dont on se plaît à penser qu’elles résultent d’une irrépressible fougue et non, même si ce soupçon nous effleure parfois, d’une trop grande facilité.
Il y a des livres qui vous font regretter de ne pas maîtriser l’espagnol. Le Passé, avec ses circonvolutions narratives échevelées, sa cruauté désabusée et sa diabolique drôlerie, est de ceux-là.
H. M.
Alan Pauls. Le Passé. Traduit de l’espagnol (Argentine) par André Gabastou. Christian Bourgois, 2005, 656 pages.