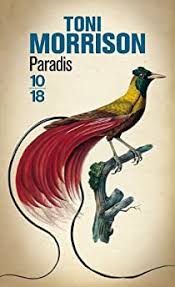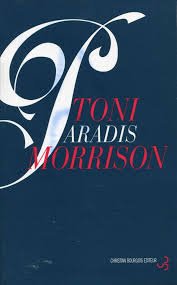Paradis
Extrait inédit d’un roman de Toni Morrison
Ils tuent la jeune blanche d’abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps. Inutile de se dépêcher ici. Ils se trouvent à vingt-cinq kilomètres d’une ville située à cent trente-cinq kilomètres de toute autre ville. Il y a des quantités d’endroits pour se cacher dans le Couvent, mais ils ont le temps et la journée vient juste de commencer.
Ils sont neuf, plus de deux fois le nombre de femmes qu’ils sont obligés de mettre en fuite ou de tuer et ils ont tout ce qu’il faut pour cette tâche: des cordes, une croix en feuilles de palmier, des menottes, des grenades lacrymogènes et des lunettes noires, ainsi que de beaux fusils bien nets.
Ils n’ont jamais pénétré si loin dans le Couvent. Certains ont garé une Chevrolet près du porche pour prendre un chapelet de piments ou sont entrés dans la cuisine pour y chercher un bidon de sauce barbecue; mais quelques-uns seulement ont vu les salles, la chapelle, la classe, les chambres. Maintenant, ils vont tous les voir. Et ils vont enfin voir la cellule et ils vont en exposer la saleté à la lumière qui décrassera bientôt le ciel de l’Oklahoma. En attendant, les vêtements qu’ils portent les inquiètent – ils ont brusquement conscience qu’ils ne conviennent pas. Car à l’aube d’une journée de juillet, comment auraient-ils pu imaginer le froid qui règne à l’intérieur du couvent ? Leurs T-shirts, leurs chemises de travail et leurs tuniques africaines absorbent le froid comme une fièvre. Ceux qui ont mis des souliers de travail sont effrayés par le bruit de leurs pas qui résonnent sur le sol de marbre; ceux qui portent des ProKeds, par le silence. Puis il y a le caractère imposant des lieux. Seuls, les deux hommes qui ont des cravates semblent comme chez eux et chacun à son tour se souvient qu’avant d’être un couvent, cette maison était une folie cons-truite par un escroc détourneur de fonds. Une demeure où les sols de marbre rose et blanc succèdent aux parquets de teck. Du mica qui retient une lumière d’autrefois et des murs décorés, qu’on a dénudés et blanchis à la chaux il y a cinquante ans.
Les accessoires de la salle de bains fantaisie, qui soulevaient le cœur des nonnes, ont été remplacés par de simples robinets ordinaires, mais les baignoires et les lavabos princiers qu’on n’aurait pu remplacer sans de grandes dépenses restent calmement malhonnêtes. Ce qu’on pouvait détruire de la joie de vivre de l’escroc l’avait été principalement dans la salle à manger, que les nonnes transformèrent en salle de classe où de sages jeunes filles Arapaho s’assirent autrefois et apprirent à oublier.
Aujourd’hui, des hommes armés fouillent des pièces où des paniers de macramé se balancent à côté de candélabres flamands; où le Christ et sa mère irradient dans des niches décorées de grappes. Les sœurs de la Sainte-Croix ont fait sauter toutes les nymphes au ciseau mais les courbes de leurs cheveux de marbre enserrent toujours les feuilles de vigne et se glissent entre les grappes. Le froid devient plus vif au fur et à mesure que les hommes s’enfon-cent dans la demeure, ils prennent leur temps, regardent, écoutent, vigilants à cause de la malice des femmes qui se cachent ici et de l’odeur de levain et de beurre de la pâte qui lève.
L’un d’eux, le plus jeune, s’oblige à se retourner pour voir comment le rêve dans lequel il se trouve peut se poursuivre. La femme abattue, allongée sur le sol de marbre dans une position incommode, lui fait signe des doigts – ou c’est ce qu’il semble. Son rêve se déroule donc comme il faut, sauf pour la couleur. Jamais encore il n’a rêvé dans des couleurs comme celles-ci: un noir profond dans lequel s’étale une violente traînée de rouge puis un jaune épais et fiévreux, comme les vêtements d’une femme qu’on a eue facilement. L’homme de tête s’immobilise et lève la main gauche pour stopper les silhouettes qui le suivent. Elles s’arrêtent, reprennent leur souffle, et replacent de façon amicale leurs mains qui serrent des fusils ou des pistolets. L’homme de tête se retourne et sépare ses hommes d’un geste: vous deux par là vers la cuisine; deux autres là-haut; deux dans la chapelle. Il se réserve, ainsi que son frère et celui qui croit rêver, pour la cave.
Ils se séparent avec grâce, sans un mot et sans hâte. Tout à l’heure, quand ils ont fait sauter la porte du Couvent, la nature de leur mission leur donnait le vertige. Mais, après tout, leur but, ce sont des détritus: des gens dont on se débarrasse et qui parfois reviennent dans un courant d’air après qu’on les a chassés d’un coup de balai. Maintenant ils contrôlent le venin. Tuer la première femme (la Blanche) l’a clarifié comme du beurre: l’huile pure de la haine sur le dessus, la partie dure stabilisée en dessous.
Au-dehors, la brume est à hauteur de la taille. Bientôt, elle deviendra argentée et rendra les arcs-en-ciel de l’herbe assez bas pour les jeux des enfants, avant que la chaleur du soleil ne la dissipe, révélant des arpents de pâturin et d’herbe à sorcière.
* * *
La cuisine est plus grande que la maison dans laquelle chacun de ces hommes est né. Le plafond de poutres plus haut. Avec plus d’étagères que dans l’épicerie d’Ace. La table mesure près de cinq mètres de long et il est facile de voir que les femmes qu’ils pourchassent ont été prises au dépourvu. A un bout, une cruche pleine de lait est posée à côté de quatre bols de céréales. A l’autre bout, la préparation des légumes a été interrompue: un petit tas de ciboulette coupée comme des confettis verts dans lequel brillent des rondelles de carotte, mais les pommes de terre, épluchées et entières, sont blanches, humides et croquantes. Du bouillon chauffe sur le poêle. Il a la taille d’un poêle de restaurant avec huit brûleurs et, sur une étagère, sous la grande hotte métallique, une douzaine de miches de pain lèvent. Un tabouret est renversé. Il n’y a pas de fenêtres.
Un homme fait signe à un autre d’ouvrir la dépense pendant qu’il va vers la porte de derrière. Elle n’est pas fermée à clef. Il jette un regard au-dehors et voit une vieille poule, le derrière enflé et rouge sang, prête à pondre, suppose-t-il, des œufs monstrueux – deux ou trois jaunes dans des coquilles énormes et déformées. Des gloussements discrets viennent de la basse-cour, derrière; des poulets picorent en toute confiance dans la brume, ils disparaissent, réapparaissent, disparaissent de nouveau, chaque œil vide et indifférent ne fixe que la nourriture. Aucune empreinte dans la boue autour des marches de pierre. L’homme referme la porte et rejoint son compagnon dans la dépense. Ils inspectent ensemble les bocaux poussiéreux et ce qui reste des conserves de l’an dernier: tomates, haricots verts, pêches. Flemmardes, se disent-ils. On est bientôt en août et ces fem-mes n’ont même pas trié et encore moins lavé les bocaux.
T. M.
(Extrait de Paradis, roman traduit de l’anglais par Jean Guiloineau, à paraître chez Christian Bourgois Editeur)