Mon Walser
Libres propos d’un walsérien valsant à ses heures,
par Antonin Moeri
Vous voulez vraiment que je vous dise. On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. On va se promener sous les platanes, on lorgne les jolies filles, on fume des joints. Transgresser les règles, que ce soit à l’école, en famille ou dans les grands magasins, procure un plaisir qui n’est pas sans rappeler l’extase érotique. C’est une période de ma vie à laquelle je songe souvent. Elle donne envie de raconter des choses. J’avais pas tellement d’argent. J’aimais les films d’aventures, les romans policiers, les soirées au théâtre de la ville, où je me rendais en train, avec une copine qui me montrait ses seins sur la banquette du wagon, à côté des water-closets. Elle évoquait, entre deux baisers, les livres qu’elle aimait, les barbus révolutionnaires et les kibboutz. On allait voir des pièces de Brecht. On se montrait des photos d’Artaud. On parlait très vite. On mangeait les mots. Un jour qu’on se promenait sur les quais de Montreux, elle prononça le nom d’un poète grec. Il habitait Genève. Je pris l’habitude de me rendre dans cette autre grande ville où, dans un petit restaurant bien tenu, je retrouvais l’écrivain passionné et passionnant. Parmi les nombreux auteurs qu’il me fit découvrir, Robert Walser tient une place à part.
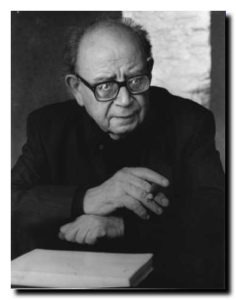
J’aimais bien les cours de grec. C’était l’art pour l’art. Le prof avait du charme, de magnifiques yeux bleus et des pantalons très classe. Il avait été guide touristique dans le Péloponèse. Il communiquait sa passion. On traduisait un passage d’Euripide. L’évocation du cou pâle d’une déesse. J’avais décroché. Je préférai, ce jour-là, m’évader avec les frères et soeurs Tanner. Il aimait pas tellement qu’on lise autre chose, l’ancien guide touristique. Il me renvoya du cours. Je les énervais trop, tous ces profs. La direction finit par me mettre à la porte de l’établissement. Elle m’avait souvent averti. Je foirais dans plusieurs matières dites scientifiques, j’étais pas assez appliqué, je répondais avec insolence. J’ai eu de la chance, parce que je pensais tout le temps à Walser. Ma copine et moi, nous avons mis en scène L’Institut Benjamenta. C’était à mourir de rire. Une trentaine de personnes assistèrent au spectacle. Elles avaient payé l’entrée. On remboursait nos frais. Enfin presque…
Les périodes de chômage, quand je faisais l’acteur à Paris, étaient extrêmement agréables. D’une part parce que je maigrissais considérablement, d’autre part parce que j’avais décidé de traduire des histoires de Robert Walser. De ces histoires qu’il envoyait aux journaux pour survivre. Un directeur de revue littéraire me commandait régulièrement des traductions. Je ne l’ai jamais vu, ce directeur de revue littéraire, je n’ai jamais entendu sa voix au téléphone. On s’écrivait des lettres. Les siennes étaient particulièrement belles. Il vouait une sorte de culte à Robert Walser. Traduire est une activité des plus enrichissantes. Réfugié dans le petit appartement que me louait un colonel de Saint-Cyr, je passais les heures du jour et de la nuit à rendre en français ce que le poète suisse allemand avait formulé dans sa langue. Mon dictionnaire bilingue se disloquait rapidement. Sa bordure noircissait à vue d’oeil. La reliure se déchirait. Il perdait ses feuillets. On voyait nettement le travail, l’effort et le ravissement. En effet, trouver le mot juste procure un plaisir qui n’est pas sans rappeler l’extase érotique.
De quoi parle Walser, en réalité, dans ces textes brefs envoyés aux journaux jusque dans les années trente ? D’une dame qui accoste un possible narrateur en lui disant poliment : «J’ai lu vos livres, j’en ai conclu que vous étiez un valet. Je vous prends à mon service. » Et l’espiègle narrateur d’expliquer à l’aimable dame que sa proposition le laisse de marbre, qu’il est un genre particulier de valet, de ceux qui servent les lettres. Walser peut également évoquer une petite libraire qu’il salue régulièrement avec un mouvement de tête majestueux, parce qu’en la saluant de cette manière il entend saluer toutes les oeuvres de l’esprit qu’on trouve dans la librairie où travaille la demoiselle. On l’aura compris, le sujet n’est pas si important. Ce qui compte dans cette entreprise, c’est de raconter des choses. Et pour raconter des choses, il faut trouver un ton, varier les perspectives, égarer le lecteur dans une prairie où souffle une brise heilderlinienne.
Walser ne développe pas des idées, il ne cherche pas à nous dire combien le monde est triste avec ses matérialistes obtus, ses mères étouffantes et ses entrepreneurs cupides. De même ne cherche-t-il pas à nous annoncer l’avènement d’une heureuse Arcadie où les bons sentiments inspireraient le législateur. C’est que Walser ne se prend pas au sérieux sur le plan idéologique. Le chantage à la conscience lui soulevait la poitrine de dégoût. Il préférait s’orienter vers la musique et le rythme de la langue, pour y chercher cette liberté qui lui était plus chère que tout. Un peu comme les grands pessimistes (qui sont en vérité les gens les plus drôles), il laisse entendre que le malheur de l’homme a sa source en lui-même. Mais contrairement à des auteurs plus sombres que lui, Walser n’a pas besoin de noircir le trait pour accepter son plaisir.
On entend une ou plusieurs voix dans les textes de Walser, et il y a toujours des yeux permettant au lecteur de regarder un monde. On peut passer de la vision d’un aubergiste à celle d’une cliente pour ainsi dire soûle, de la vision d’un ancien pasteur à celle d’un insomniaque nerveux. Ce n’est pas une étude des comportements, c’est un enchevêtrement de perspectives, d’observations et de sensations visuelles, sonores ou tactiles. L’enquêteur ahuri est central dans ces textes. Il donne forme à l’univers qui se construit devant vous. Il entretient peu de rapports avec les personnages mis en scène, sauf avec les délinquants, pour qui il éprouve une véritable affection. Cet enquêteur ahuri se caractérise par une extrême sensibilité, par une grande fragilité et une confiance presque illimitée.
S’il entre en conflit avec le monde qui l’entoure, s’il désapprouve parfois les valeurs de la société dans laquelle il vit, il n’a rien d’un redresseur de torts, d’un chevalier luttant contre les forces du Mal. Ou si tel devait être le destin de notre héros, alors ce serait dans le registre comique. On sera plus proche de Buster Keaton que du Dahlia noir. Ce n’est pas l’intrusion de la tragédie grecque dans le polar, c’est le triomphe de la gratuité, de la dérision, de la légèreté, de l’insouciance et de la digression. Nulle identification possible avec une victime, avec un personnage sympa ou cruel. Nulle fusion avec l’autre dans l’annulation de toute différence. L’émotion sur laquelle joue Walser est une émotion subtile, celle qu’on pourrait éprouver lorsqu’on apprivoise les mots, ces mots qui ont été construits comme des ports et qu’on devrait soigner comme des roses.
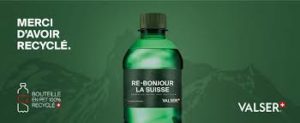
Quand Georges Haldas me fit découvrir l’oeuvre de Robert Walser, personne n’avait entendu parler de ce mystérieux poète suisse allemand mort fou, semblait-il, dans un asile psychiatrique. Il faisait bon passer ses soirées avec Jakob von Gunten qui était alors, je crois, le seul titre traduit en français. Il va de soi que, de nos jours, personne ne sait qui est Robert Walser. Généralement, on pense qu’il s’agit d’une eau minérale, d’un joueur du Bayern ou d’une marque de pyjama… Par contre, il est devenu une référence incontournable pour les germanistes, les critiques dits littéraires et bien des gendelettres. J’ai voulu, dans ces lignes, parler d’un autre Robert Walser… Le mien.
A. M.
Pour mémoire:


