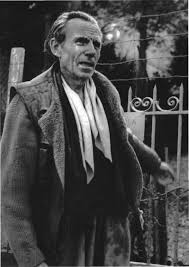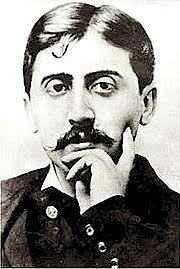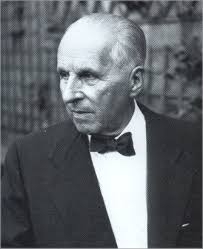Louis-Ferdine, le petit Marcel et tonton Gaston en son chic boxon
À propos des haines littéraires diversement ambivalentes et partagées,
par Jérôme Meizoz
On pourrait qualifier ce petit livre de psychodrame littéraire, de roman familial, d’essai historique, d’enquête policière, de micro-sociologie de l’édition, comme on voudra. Jean-Louis Cornille recourt à divers tons et couches d’analyse pour retracer les grands moments d’une haine célèbre, certes ambivalente, de l’histoire littéraire: celle de Louis-Ferdinand Céline pour Proust. Haine plus complexe, assurément, que celle professée dans Bagatelles pour un massacre à l’égard de l’«écrivain sémite». Haine circulant par le biais d’un vecteur sensible, d’une incarnation paternelle: celle du «pourvoyeur d’encre» que fut l’éditeur Gaston Gallimard.
Ce qui rapproche les deux romanciers ? L’un et l’autre furent d’abord des «refusés» du comité Gallimard. Pour le reste, tout les oppose: les origines sociales, le style de vie, la formation, le personnel romanesque (le haut et le bas du panier), le rapport à la langue, les destinataires implicites, la visée de l’œuvre.
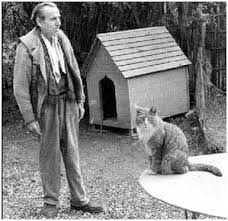
Débuts en plans rapprochés: Céline s’introduit dans le bureau de Gaston Gallimard, fouille ses archives, le dossier Proust, le dossier Céline. Voilà les entrailles éditoriales des deux monstres antithétiques qui assurent l’économie mythologique de la maison.
1954: la Pléiade de Proust devient le 100e volume de la collection. Céline enrage. Proust, d’abord raté par la «nénéreffe», devient son symbole embaumé: ce mort célèbre assure l’«effet de mausolée», indispensable à toute fondation. A ce point, Cornille convoque, sans lourdeur académique, les documents disponibles (les Lettres à la nrf, 1991, de Céline, la Correspondance Marcel Proust-Gaston Gallimard, 1989). Deux volumes publiés par la maison Gallimard qui érige ainsi, toujours selon Cornille, son propre monument. Alors que le gentil Marcel et Gaston entretiennent une «correspondance» amicale où le mimétisme mondain tient lieu de scénario, Céline, lui, ne dialogue pas avec le «calmar», comme il le nomme en jouant de l’étymologie: Gallimard, l’éditeur-pieuvre, ne fait l’objet que de demandes, de plaintes ou d’injures. Dès février 1955, après la parution de la Pléiade Proust, Céline réclame la sienne. En vain. Il n’aura que la promesse d’une édition du Voyage en poche… Ayant adopté une fois pour toutes la posture du Grand Exclu, l’in-verse du Marcel mondain, il lance ses salves. Les lettres à Gaston sont injustes, ordurières: l’éditeur est accusé de saboter le succès de Céline, de retenir ses œuvres dans les caves de la rue Bottin.
Ces lettres réactivent le dispositif calomniatoire des pamphlets («Pape coco, pédé, gaulliste !»). Mais sitôt que Céline s’aperçoit de leur inefficacité, il réagit en écrivain: il intègre Gallimard à ses fictions, le digère dans son œuvre sous la forme d’un pantin nommé Achille Brottin. Invectivé à souhait. A l’occasion de ces péripéties, Cornille analyse finement la République des lettres et son fonctionnement. Il décrit les faiblesses du statut d’auteur, les doubles contraintes de l’éditeur, le rôle de la critique.
Tandis que Proust parle de la nrf comme d’une «Eglise», Céline la qualifie de bordel: deux versions d’une mythologie du sacrifice. Et Céline d’incriminer la maison, comparant toujours son injuste sort à celui de Marcel: «Quelle indignation si l’on venait à effleurer une particule de crotte insipide d’un Prouproust ou d’un Gide !… mais mon texte, à la pioche !»
Cette haine pour l’Autre absolu de Proust, son envers structural dans le champ littéraire, cache cependant un rejet littéraire fécond. Elle conduit Céline à réécrire à sa façon, dans ses propres œuvres, des passages de la Recherche, la démembrant et la dépeçant allusivement, au passage. Ainsi la tante Armide de Céline fait-elle pendant à la tante Léonie de Proust. En de brèves analyses, Cornille fait apparaître encore la différence sociale entre ces deux univers romanesques. Celle-ci éclate au début du Voyage, à travers la libraire-lingère Mme Herote, à propos de laquelle on lit: «Proust, mi-revenant, lui-même, s’est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l’infinie, la diluante futilité des rites et démarches qui s’entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désirs, partouzards indécis attendant leur Watteau toujours, chercheurs sans entrain d’improbables Cythères. Mais Mme Herote, populaire et substantielle d’origine, tenait solidement à la terre par de rudes appétits, bêtes et précis.» N’étaient quelques tics lacaniens mortellement gratuits, voilà un essai inventif et non dénué d’humour.
J. M.