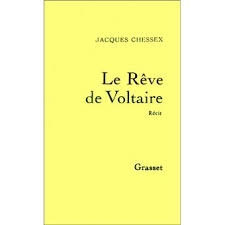Les Lumières sur le Jorat
Entretien avec Jacques Chessex,
par François Conod
Comme son titre l’indique, Le rêve de Voltaire est un récit lumineux, heureux, aérien; une petite heure de musique, une fugue dans le temps, une prose poétique maîtrisée et mesurée. Nous sommes au château d’Ussières, hameau de Ropraz. Le maître des lieux, Jacques-Abram-Elie-Daniel Clavel, reçoit indifféremment Rousseau, le docteur Tissot, Gibbon, M. de Haller, Casanova et Voltaire. Indifféremment ? La préférence des Clavel va sans conteste à l’auteur du Dictionnaire philosophique. Un jeune homme de dix-huit ans, Jean de Watteville, pose un oeil de Huron sur ces illustres personnages. De l’autre oeil, si j’ose dire, il ne perd pas un seul des mouvements de la belle mademoiselle Aude, pupille de Clavel comme lui. Nous sommes au siècle des Lumières, tout baigne dans la clarté de l’été. Pourtant, le récit suggère constamment que les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent. «Car une chose est certaine», dit le narrateur, «tout ce que je vois est double. Donc je ne crois pas, je crois voir.»
En filigrane transparaissent la Lettre sur les aveugles de Diderot et son Paradoxe sur le comédien. Puis s’entrouvre la porte du romantisme, créant comme un appel d’air. En choisissant de faire raconter l’histoire d’un adolescent par le vieillard qu’il est devenu soixante ans plus tard, Chessex opte pour une distance qu’on aurait tort de confondre avec la sérénité ou la réconciliation. Sous les Lumières de la raison ou les orages désirés, la problématique ne change pas: que croyons-nous savoir de la vie, de la mort, des papillons chers à Nabokov ? L’écriture reste une quête. «Moi, je n’ai pas besoin de mentir», dit le narrateur, «le réel ment à ma place.» Sous le faux semblant d’une luminosité qui rassurera certains, l’auteur des Aveugles du seul regard signe ici un livre composé de touches légères dont chacune nous rappelle que Mozart, à son insu il est vrai, a composé son propre requiem.

— On a salué la lumière et la transparence, la musique de ce petit livre.
— Les lecteurs sont peut-être rassurés de me voir abandonner les abrupts ou les ravines dans lesquels ils pensaient que je me complaisais. Ils ont vu dans ce récit quelque chose de plus léger, à juste titre d’ailleurs, de plus humoristique. Comme une nouvelle manière. Ils ont cru, un peu naïvement peut-être, que ce livre ignorait les pentes raides. Or il ne les ignore pas.
— C’est vrai. Le noyau du livre n’est-il pas constitué de la même scène primitive que celle de L’Ogre ?
— Tout à fait. Et c’est là que ces gens n’ont peut-être pas très bien lu. Dans le siècle des Lumières, il y a toute une vie cachée, désordonnée, menaçante. L’époque classique gomme tout ce qui est du domaine de l’erreur, de la monstruosité. Il s’agit d’éradiquer le vice. Le docteur Tissot, qui apparaît dans le livre, en est un exemple patent. A toutes sortes de signes, de cernes, il traque ce qui est coupable à ses yeux. Et mon personnage est justement celui qui voit que derrière la surface lisse, le code, il se passe un certain nombre de choses qui relèvent du mystère ou du scandale.
— Symptomatiquement, la scène où le docteur Tissot quête le vice chez le narrateur s’arrête juste à temps.
— C’est une façon pour moi de jouer avec le danger en le signalant et en interrompant le drame au moment où ça deviendrait scabreux. C’est un héritage classique, une parodie du classicisme. Je me suis tenu dans une sorte de suspens, d’ailleurs très agréable à vivre, une harmonie dans l’écriture, un plaisir musicien de suivre un rythme sans heurts, ni dans le mental ni dans le style. Mais chaque fois qu’il y avait quelque chose, je le signalais. Au lecteur de deviner ce qui se passe au-delà du «montré».

— A ce propos, j’ai relevé une petite phrase: «Le docteur Tissot gratte une tache imaginaire sur sa culotte prune…» La tache est montrée, mais elle est imaginaire.
— C’est ça, vous avez parfaitement défini l’art poétique de ce livre: dénoncer avec le sourire tout en laissant penser que c’est à la fois imaginaire et réel. Le récit pourrait se dérouler dans le creux de la vallée, mais il veut rester dans la lumière de l’été. C’est la lumière dans les Lumières. Et curieusement, cette lumière est plus intéressante que celle de la raison. Le déraison-nable apparaît derrière la raison.
— Et puis, il y a les orages désirés… l’appel du romantisme.
— Oui, ce jeune homme a dix-huit ans en 1760, soixante-quinze au moment où il écrit, en 1817. Mais l’histoire se passe bien avant Chateaubriand. Jean est un pré-romantique, il a quelque chose de nervalien: il vit dans le siècle de Voltaire, mais il est déjà dans le rêve.
— On songe souvent au «souvenir à demi rêvé» dans la «Sylvie» de Nerval.
— Je n’y ai pas pensé en écrivant. J’ai pensé à Candide, plutôt. J’ai voulu rester à la fois proche et pas trop proche de Candide. Par le thème, c’est bel et bien un jeune homme qui se fait mettre à la porte d’un château, mais d’autre part je rejoignais les figures de personnages qui ont été chassés, dans mes livres, La tête ouverte, Le pasteur Burg, La Trinité: ils sont chassés. Jean Calmet dans L’Ogre est chassé. C’est le thème de l’exil, de l’exclusion. Comme dans ce récit de Gide, Isabelle. Un texte d’une grande brièveté, quatre-vingt pages, où tout est dit. Un grand modèle.

— A propos de brièveté, Le rêve de Voltaire est très structuré, parfaitement symétrique. Deux scènes similaires ouvrent et ferment le récit, et la narration bascule au milieu exact du livre, lorsque intervient Casanova.
— J’ai toujours paru un personnage désordonné, mais c’est l’apparence provinciale. En fait, mes livres sont très structurés. La mort de Jean Calmet par exemple correspond exactement aux vingt minutes de la lecture, je l’avais calculé. Ici, dans ce récit, le début, le centre et la fin autour de la parole de Casanova qui fait basculer le jeune homme dans le doute, tout est calculé selon un rythme, et même une rythmologie étudiée.

— Pour passer à autre chose: les opinions négatives du narrateur sur Rousseau sont-elles celles de l’auteur ?
— Oui. Je n’ai jamais aimé Rousseau. Il m’intéresse, mais je n’aime pas la tristesse. Il y a chez lui une sorte de mensonge triste. C’est une oeuvre qui me fait de la peine, et comme je n’aime pas les oeuvres qui m’affligent, j’ai toujours écarté Rousseau de mon chemin. J’ai été confirmé par des gens comme Flaubert ou Maupassant, qui le détestent; et je me suis aperçu que beaucoup des écrivains que j’admirais, Paulhan par exemple,«n’aimaient pas Rousseau. Moi je l’ai su après, ces trente dernières années si vous voulez, mais mes réactions d’enfance et d’adolescence sont restées les mêmes: je ressens les choses de la même façon, aujourd’hui et à quinze ans. Et ce que les Clavel ressentent dans le récit, ce que le narrateur ressent, c’est aussi ce que ressent l’auteur. J’ai une immense confiance en Voltaire. Quand je parle de son rire fort et sec, je l’entends; et pour moi il est ainsi. Voltaire m’a toujours fait du bien. C’est surprenant pour quelqu’un qui a cultivé parfois l’obscur ou l’abrupt, mais ces obscurs et ces abrupts sont dans Voltaire. Il n’y a qu’à voir le Dictionnaire, l’extraordinaire part nocturne que le dix-neuvième a voulu ignorer chez Vol-taire: l’obsession de la superstition (on n’est pas obsédé pour rien: c’est qu’on est tenté); l’obsession extraordinaire du rêve et de la divination, comme s’il fallait absolument qu’il établisse des barrières soit ironiques, soit logiques.
— A la fin de votre livre, vous citez: «Si les organes seuls produisent les rêves de la nuit, pourquoi ne produiront-ils pas seuls les idées du jour ?» J’ai dû relire plusieurs fois.
— N’est-ce pas que c’est difficile ? Je ne suis pas sûr que ni vous ni moi, ni mon personnage ne comprenions, ni même Voltaire lui-même Il y a chez lui une tache aveugle sur tout ce qui est de la nocturnité, en quoi il me fait penser à Saint-Augustin, qui était fasciné par les rêves. En 1230, Saint Augustin aurait été brûlé vif parce qu’il était, dans certains de ses propos, complètement hérétique.
— Chaque fois que je pense au dix-huitième siècle, j’imagine le marquis de Sade croupissant dans son cachot et rédigeant en parallèle des Lumières son oeuvre atroce. Il y a ce cachot de Sade, la face obscure de ce siècle.
— Il est cette formidable image retournée des Lumières, à la lueur des bougies dans son cachot. Il y a autre chose, c’est peut-être le point de départ de ce récit: j’ai souvent dit que j’étais obsédé par les maisons: prison, château, hôpital, maison de maître, ferme. Les maisons ont pour moi un pouvoir d’envoûtement considérable. Bien avant d’habiter Ropraz, je passais souvent devant ce château d’Ussières, ce manoir rose; je savais que Voltaire était l’ami du châtelain. Et déjà cela me fascinait, j’avais l’idée d’y mettre quelque chose en scène: sinon Voltaire, du moins des familiers de Voltaire dans l’été. C’était au temps où j’écrivais La Trinité, que j’avais failli interrompre comme ça m’arrive souvent: il naît une petite branche dans le livre et on a envie d’en faire un récit, une nouvelle. Je devais me défendre contre un récit de cette taille-là, une sorte de rêverie amoureuse autour de Voltaire. J’ai laissé reposer, sans prendre de notes, et au printemps dernier, les premières phrases du texte me sont venues. Le rêve de Voltaire est né en un mois; je ne dirai pas sans ratures, mais d’un seul mouvement. Je n’ai eu qu’à le cueillir, ce qui est nouveau pour moi. Je ne travaillais pas ainsi avant d’avoir écrit mon Flaubert. Je crois que cet essai a heureusement assassiné en moi le mythe du chantier difficile, de l’écriture de peine. Il m’a permis de dégager ma table de travail des trop lourds outils de chantier.
— On sent que vous avez saisi quelque chose au vol, entre dit et non-dit, rêve et réalité.
— Exactement, c’était comme un texte suspendu dans l’air, je le voyais physiquement, sa masse légère, sa dimension brève mais étendue dans le temps. Je n’avais plus qu’à le coller sur le papier.

— On est frappé aussi par le côté théâtral du livre. Vous n’avez jamais été tenté d’écrire pour le théâtre ?
— On me l’a souvent proposé, mais j’ai toujours dit non, parce que je ne sais pas collaborer. Je travaille complètement seul. Si je dois rendre des comptes à un metteur en scène, un décorateur etc., je suis perdu. Mais le théâtre est omniprésent dans mon livre parce que Voltaire vivait constamment comme un homme de théâtre. A douze-treize ans, chez les Jésuites, il jouait déjà ses propres compositions devant ses camarades. Et jusqu’à quatre-vingts ans, il n’a jamais cessé d’être en représentation. C’est le plaisir de jouer. Et jouer, c’est à la fois être plus vrai que son personnage originel, c’est en même temps jouer un personnage que l’on n’est pas, c’est vivre dans cette distanciation permanente puis dans cette incarnation qui, en même temps, représente la vérité.
— C’est l’opposé du mensonge.
— L’opposé même du mensonge. Pour Voltaire, le théâtre, c’était la vérité.
— Dans le livre, Aude tient un journal, qui d’ailleurs reste secret. Est-ce que vous tenez un journal ?
— Pas du tout. J’aurais l’impression de voler l’essentiel de l’écriture aux livres. Je ne comprends pas qu’on puisse tenir un journal. Pour moi, ce qu’il y a de vrai, d’essentiel, c’est ce qui passe dans les livres. Donc le livre, c’est mon journal. Et ceci quoi que j’écrive: essai, poèmes, nouvelle, récit, roman… Mon actualité, mon journal, c’est la matière même que je mets dans le texte. Je ne comprends pas que Julien Green, par exemple, écrive des milliers de pages qui auraient pu passer dans un roman. Pourtant, je le lis avec passion, car curieusement, j’aime lire les journaux des écrivains. Celui qui m’a le plus intéressé, ces dernières années, c’est celui de Benjamin Constant —aussi par le non-dit, d’ailleurs.
— Et les Confessions de Rousseau ?
— Elles entrent dans un système que je comprends très bien, parce que je suis moi-même l’auteur de La confession du pasteur Burg et que je me suis souvent référé aux Confessions de saint Augustin. La tradition confessionnale n’appartient pas pour moi au journal, c’est un exercice d’écriture existentielle, elle est mise en forme rhétoriquement. Ce qui me fascine et en même temps m’étonne, chez ces écrivains, comme Constant, qui arrivent à se concentrer sur des récits aussi prodigieux qu’Adolphe, c’est qu’ils avaient encore de quoi écrire en marge qu’ils avaient perdu au jeu, qu’ils n’avaient rien fait de toute la journée… Mais je le lis avec délectation. Michel Leiris en revanche m’a déçu par ses ruses et ses prudences.
— En somme, le journal, c’est le mensonge suprême, la vérité se trouve dans la fiction.
— Dans l’écriture.
— A cet égard, Le rêve de Voltaire foisonne d’allusions aux apparences, à ce qu’il y a derrière…
— Vous touchez là un point important pour tout ce que je fais depuis une dizaine d’an-nées. Le livre, c’est le livre plus l’écho du livre, la musique du livre. Il y a une aura, une vibration. C’est ce que j’ai essayé de faire. Un vrai livre comprend sa part de mystère. Ce qu’il y a d’extraordinaire chez Giono, c’est que malgré la grande lumière de Manosque, c’est prodigieusement mystérieux. […] Je me repais de livres d’entomologie du XVII’ et du XVIII’ siècle. La description de ces insectes apparemment sans finalité, qui ne vivent que quelques heures, me remplit de plaisir. Là, j’ai le sentiment que je tou-che aux questions à la fois obscures et claires qui m’obséderont toute ma vie.

— Seriez-vous d’accord avec l’idée qu’on ne peut que décrire le monde ?
— Je suis tenté de dire oui, mais il y a une voix en moi qui dit: décrire pour comprendre. Et si on ne comprend pas, admettre qu’on ne comprend pas parce que la description a achoppé à l’obscur, à la clarté obscure. […] C’est toujours par l’écriture que nous essayons de résoudre notre pourquoi et notre com-ment devant le monde.
— Y a-t-il une question que vous auriez aimé qu’on vous pose ?
— Celle du récit. Dans le récit, il y a un narrateur, peu de personnages, dans un lieu donné. Et en même temps, je pense que ce récit est chargé de poésie, parce que le genre permet une diffusion constante du sentiment poétique. Dans un récit, il y a à la fois la menace qui peut peser sur une nouvelle, la magie de certains personnages, l’enchantement d’un paysage et une certaine écriture, une écriture sans heurts qui laisse deviner tous les heurs et les malheurs.
Propos recueillis par
François Conod