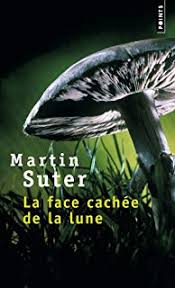L’échappée folle du battant
À propos de La Face cachée de la lune de Martin Suter,
par Elisabeth Vust
Après une entrée remarquée en littérature avec un roman policier médical (Small World, Bourgois, 1998), Martin Suter creuse la veine d’une prose sous haute tension et signe La Face cachée de la lune, une mise en question de l’être et du paraître.
Qui est est Urs Blank ? À 45 ans. sa réputation d’avocat aux dents longues, spécialisé en fusion d’entreprise, n’est plus à faire. Ses comptes en banque fournis lui assurent une existence privilégiée dans la quiétude d’une ville suisse. Rien ne le distingue des requins de la finance côtoyés quotidiennement, sinon sa grande pugnacité et le chic de ses travailleurs londoniens. Rien jusqu’à cette envie de respirer autrement ailleurs. Ainsi hume-t-il l’encens vendu par Lucille sur un marché aux puces.
Jolie coïncidence. Les deux Suisses de la rentrée littéraire des éditions Bourgois. Bernard Comment et Martin Suter, baptisent du prénom de Lucille leur personnage féminin principal. Qui est Lucille ? Alors que le Jurassien s’empare de la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds (un hommage au LSD ?), et parle d’« iris bleu de cyanure », le Suisse allemand s’attarde sur les yeux «indescriptibles», d’un «bleu délavé», de Lucille, une adepte de substances hallucinogènes. À ce jeu des ressemblances, nous nous en tiendrons là, même si les deux écrivains partagent l’ironie d’un regard porté sur leur pays d’origine quitté pour d’autres horizons. En termes de probabilités, la rencontre d’un golden boy et d’une baba cool avoisine le zéro. Heureusement, le romancier n’en a cure et tire des scènes savoureuses de cette confrontation culturelle. A l’instar de la convention entre Lucille et Urs de s’inviter dans des restaurants à la mesure de leurs moyens respectifs. Et l’on se régale du contraste caustique formé par le plat du jour à six francs proposé par l’Union des femmes protestantes, ou autre tambouille communautaire, et les mignardises des cantines de luxe. À ce sujet. les dépenses d’Urs franchissent le pas de l’indécence avec une ardoise de cinq mille francs pour un repas exigé par son supérieur.

On le voit, Suter se joue des clichés et des travers de la Suisse. Ici, il épingle sa richesse et appelle la réflexion: « plus on a d’argent, plus on en dépense : mais en est-on pour autant plus heureux ?»
Ailleurs, on pense à Dürrenmatt, à son image pour notre pays, une prison sans murs où les «détenus sont gardiens et se surveillent eux-mêmes». Arrive le « week-end méditatif» — en fait une dégustation de champignons hallucinogènes — l’occasion d’une scène de trip hilarante où l’invective de Shiva, guide du rituel, de « mettre en sommeil l’instance interne qui critique et qui juge» s’essouffle devant l’ego de chacun. Or la nervosité contamine le rire. Par la juxtaposition de tableaux. où l’on s’immisce dans l’esprit de chaque membre de l’expérience, on ne respire ni la béatitude ni l’acceptation du prochain mais une dose massive d’agressivité dirigée contre Urs, trouble-fête de la cérémonie. De façon conjointe, Urs fait l’expérience de sa toute-puissance (il peut éliminer les autres, en disposer à son gré) et découvre que rien n’existe hormis lui-même. A l’aune de ces deux visions, l’indifférence le gagne: pourquoi se soucier de choses sans réalité? Sous la gouverne de ses pulsions destructrices, il ne décroche pas de son trip et s’engage dans la spirale infernale de ses tueries. Et Suter de déployer toute son habileté narrative. À dessein, il rappelle le remords évincé par l’hallucinogène, soumet Urs à sa torture et parvient, de la sorte, à induire de l’empathie pour un homme pris de démence. Traqué de toutes parts. Ers se réfugie dans la forêt et dans l’étude obsessionnelle de la faune et de la flore. Du coup le récit se pare du mystère de la légende au milieu d’une nature inquiétante.
« Dans la forêt, comme n’importe quelle autre créature, il n’était ni bon ni mauvais.» Urs mobilise toute son énergie pour se nourrir, s’abriter et met sa pensée en veilleuse. Il ne contrôle cependant pas ses rêves, peuplés par les figures de ses victimes. Ici, la forêt fonctionne comme symbole de l’inconscient. Urs refoule le souvenir de ses gestes meurtriers — il s’enfonce dans la végétation — et conçoit en vain des stratégies pour étouffer sa culpabilité: il y aura sans cesse quelqu’un pour écorcher sa tyrannie et il ne peut que céder à ses instincts maléfiques. Il se résout donc à sortir du bois et se confronte à sa réalité. Malgré ce sursaut, les mots s’enchevêtrent dans un engrenage fatal depuis trop longtemps et condamnent Urs à l’obscurité, où vacille toujours sa flamme pour Lucille. Autour de la jeune femme, l’auteur dresse des décors de tendresse lumineuse. de beauté et de tristesse. En écho. les larmes d’Eros et sa détresse…
Martin Suter orchestre avec brio la riche matière de ce très subtil polar de l’identité, celle d’un être sous l’emprise diabolique de lui-même. Scrutateur de l’âme, il file son scénario époustouflant autour des mécanismes de survie de la machine humaine. A ce titre, d’autres protagonistes prennent place dans l’épaisseur du récit. Bien qu’il brosse leurs portraits à grands traits et y applique une dose d’exagération bienvenue, l’auteur excelle néanmoins dans l’art du détail qui fait mouche. Il en résulte une galerie de personnages tout à fait singuliers, avec des sommets de succulence et de machiavélisme largement atteints.
E. V.
Martin Suter, La Face cachée de la lune. traduit de l’allemand par Olivier Mannoni. Christian Bourgois, 2000.
(Le Passe-Muraille, No 49, Octobre 2000)