Le théâtre de Marguerite Duras
Duras, vous connaissez?
par Jacques Lassalle

— C’et vous, Lassalle?
— Oui, il me semble, oui.
— C’est vous ou ce n’est pas vous?
— C’est moi.
— Duras, vous connaissez?
— Non, mais je vous reconnais.
— Ce n’est pas de moi que je parle, mais de mes livres, de mes films, de mes pièces.
Il est minuit passé depuis longtemps dans le hall désomais presque désert du Vieux-Colornbier. Nous sommes à l’aube du 18 avril 1993. Comment l’aurais-je oublié? Tout à l’heure, c’était la générale du Silence et de Elle est là, deux pièces de Nathalie Sarraute. Elles inauguraient la nouvelle salle du Vieux-Colombier, et l’intronisaient, un demi-siècle après Copeau, seconde salle de la Comédie-Française. Nathalie Sarraute n’est pas venue ce soir. Les générales parisiennes l’effraient plus encore que moi. Nous irons dîner une autre fois et elle demandera avec malice au maître d’hôtel sa bouteille de bordeaux des bonnes années. Elle a l’âge du siècle. Elle est la plus jeune d’entre nous. Elle nous aura accompagnés jusqu’à l’extrême bord de la représentation. Malgré l’absence de chauffage, la poussière des gravats, les trépidations incessantes des perceuses et des marteaux-piqueurs. Deux ou trois châles superposés l’enveloppent. Ils sont de couleur pain brûlé, tissés dans cette laine anglaise qu’elle préfère à tout autre. Sur la petite table de régie, éclairée par l’éternelle petite lampe chapeautée de filtre bleu, elle a posé entre nous un thermos de thé brûlant. Nous sommes épaule contre épaule. Elle suit chaque mot, chaque geste esquissé sur la scène, avec le sérieux de la petite Natacha, qu’elle évoque dans l’admirable Enfance et à laquelle, jusqu’à la fin, elle ne cessa jamais d’être fidèle. Quelquefois, l’expression d’un acteur, un mot échangé entre nous la font rire. Un rire léger, pouffé, sonore pourtant. Tous, alors, sur la scène, dans les coulisses, comme enchantés, s’interrompent un instant…

Mais le temps des répétitions s’éloigne déjà. La première représentation est finie. Les acteurs, maintenant, sortent de leurs loges qui sentent trop fort la peinture fraîche. Le ministre L. et le ministre T., l’ancien et le nouveau, très entourés, sont restés longtemps dans le hall. Le premier a voulu que le Vieux-Colombier, lieu mythi-que, soit rénové et rendu au public. Il en a obtenu les moyens. Le second inaugure. Il m’a pris par le bras : «Tout était parfait, le lieu, le texte, les acteurs. Dites-le-leur. » Il tente déjà de s’arracher aux solliciteurs : « Vous comprenez, je ne suis là que depuis deux petites semaines, et demain matin il y a école. » On me dit qu’il a dormi comme un ange durant toute la représentation. Il attendra l’après Don Juan d’Avignon et les somnolences d’août pour me démissionner du Français.
Elle se tient devant moi. A quelques pas derrière elle, un groupe de cinq ou six hommes et femmes. Ses «companeros», comme elle dit, arrivent apparemment en voisins de chez elle, rue Benoît. Ils n’ont vrai-semblablement, pas plus qu’elle, vu la représentation et nous observent, mi-amusés, mi-inquiets, prêts, qui sait, à intervenir. Elle paraît plus petite encore, plus fragile que Nathalie — mais dans le visage parcheminé, de plus en plus oriental, oui, anamite, que les rides ont griffé, hersé profond en tous sens, le regard vrille, s’amuse par éclairs, mord encore.
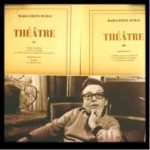
— Pourquoi n’avez-vous pas inauguré ce théâtre avec moi?
— Parce que cela n’était pas ma priorité.
— Vous avez lu mes pièces ? Des Journées entières dans les arbres, L’Amante anglaise, Les viaducs de Seine-et-Oise, L’Eden-Cinéma, Savanah Bay, ça vous dit quelque chose?
— Oui, celles-là, et quelques autres.
— Et pourtant, ce n’est pas moi que vous avez choisie ?
— Non.
— Ecoutez-moi bien, Lassalle. Si l’autre que vous avez choisie n’était pas Nathalie Sarraute, que j’aime et que j’esti-me, je vous étranglerais, là, sur place, séance tenante. Pourquoi m’avez-vous fait ça?
Elle attend, menaçante. Le temps presse. Une idée me vient.
— Le théâtre de Nathalie Sarraute est moins connu que le vôtre, qui est joué partout, en France, dans le monde…
— Oui, en 47 langues.
— J’ai pensé qu’il fallait rétablir l’équilibre.
Un sourire, j’en jurerais, a traversé son regard. La voix, toujours aussi rauque, s’est adoucie.
— C’est vraiment la raison ?
— Oui.
— La seule?
— La plus déterminante en tout cas.
— Alors je vous pardonne. Mais ne recommencez jamais. Maintenant, à laquelle de mes pièces pensez-vous, ici ou à Richelieu, pour la saison prochaine?
Les « companeros » rient bruyamment. Elle se tourne vers eux, ravie. Ils l’entourent maintenant.
— Laquelle?
— Prenons rendez-vous. Nous en parlerons.
Elle me tend la main. Elle est presque amicale maintenant. Elle se détourne et soutenue, portée, vite absorbée par sa garde prétorienne, sa silhouette menue, si menue qu’on ne sait par quel miracle de volonté elle tient encore debout, s’efface. C’est ainsi que je l’ai vue, pour la première, la dernière fois.
A quelque temps de là, je racontai l’épisode à Nathalie Sarraute. Elle parut rêveuse et garda le silence un instant. « Chère Marguerite… Si j’avais eu, moi, le centième de la confiance qu’elle avait en elle, que de doutes, que de détresses je me serais épargnés. »
Je n’avais jamais encore songé, sinon à programmer, en tout cas à mettre en scène un texte de Marguerite Duras. Non que l’oeuvre m’ait laissé indifférent. Hiroshima mon amour m’avait tellement impressionné dans ma jeunesse que je n’ai eu de cesse, ensuite, de rencontrer Emmanuelle Riva et de travailler avec elle. De Kundera à Marivaux, d’Anna Seghers à Vinaver, de Goldoni à Euripide, nous devons en être à notre sept ou huitième équipée commune. Lorsque Duras, de la scénariste qu’elle était d’abord, est devenue la propre réalisatrice de ses films, son utopie d’un cinéma de texte, dont peu à peu s’évaderait ou s’estomperait l’image, m’a aidé à poursuivre certaines de mes propres recherches, et je ne pense pas qu’à India Song, Son nom de Venise dans Calcutta désert ou au Camion, les plus connus sans doute de ses films.
Périodiquement, je revenais à l’écrivain, et après Un barrage contre le Pacifique et avant L’Amant, c’est probablement Le Ravissement de Lol V Stein et Le Vice-Consul qui, de toute son abondante production, m’ont le plus durablement poursuivi. Enfin, même si ce n’est pas dans ses propres traductions, ce n’est pas tout à fait par hasard qu’après elle, j’ai voulu porter à la scène, hier Les Papiers d’Aspern de James, demain La Danse de mort de Strindberg.
Mais hasard de la vie ? Surgissement d’autres urgences ?
Ou peut-être, appréhension, et même impatience certains jours, face à l’image publique que l’écrivain avait complaisamment proposée d’elle-même ? Je ne pensais pas m’approcher davantage de l’oeuvre de Duras. Tant d’autres, au demeurant, l’avaient fait. Tant d’autres le feraient encore. Avec passion et discernement.
Il a fallu le remarquable essai-monographie que Laure Adler a consacré, en 1998 chez Gallimard, à l’oeuvre et à la traversée dans l’Histoire de Marguerite Duras, pour que je découvre La Douleur. Ce bouleversant recueil de six récits est paru chez P.O.L. en 1985. Marguerite Duras a assuré longtemps en avoir retrouvé tels quels les manuscrits dans ses cahiers des années 1944-1945, entre le départ pour Drancy, puis Buchenwald, et le retour, mort-vivant, à Paris de son mari Robert Antelme. Celui-ci écrira, peu après, L’Espèce humaine, l’un des livres capitaux, avec Si c’est un homme de Primo Levi, qui ait été écrit sur les camps de la mort. En fait, Duras ne s’est pas contentée d’ouvrir ses cahiers au public. Il semble bien que, après la sortie de L’Amant, elle ait entièrement repris, fin 1984, l’écriture de La Douleur, fusionnant, réorganisant, brouillant à plaisir l’initial matériau biographique.
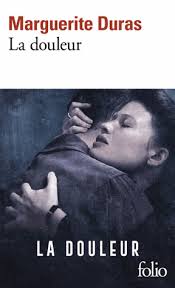
Là n’est pas l’essentiel. «Le mentir vrai », l’inlassable transmutation de la réalité traversée en fiction romanesque, est plus, que de n’importe quel écrivain contemporain, le propre de Marguerite Duras. Il reste que La Douleur, et plus spécialement le deuxième récit, celui que l’auteur a intitulé Monsieur X. dit ici Pierre Rabier, est à mes yeux le plus déchirant, et le plus « intolérable » témoignage qu’il m’ait été donné de lire à propos de la France de l’Occupation, puis de la Libération. Mais il constitue aussi, peut-être d’abord, l’aveu le plus troublant, le plus impudique, le plus vertigineusement ambigu sur ce que c’est, dit-elle, que d’être une femme.
Jacques Lassalle
(Le Passe-Muraille, No 55)

