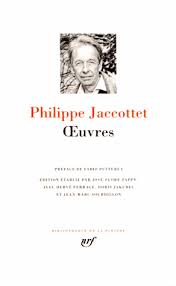Le poète face au mystère du monde
Rencontre et conversation avec Philippe Jaccottet, en 1995,
par René Zahnd
Devant la maison, il y a une terrasse, avec des dalles de pierre qu’escortent les fleurs et un grand figuier aux allures conquérantes, que le bâtiment n’abrite pas tout à fait des assiduités du mistral. Au-dessus, il y a ce ciel immense de la France méridionale qui, chaque fois qu’on vient du nord, nous donne le vertige à l’envers, lorsqu’on le voit s’ouvrir dans toute son ampleur. Et alentour s’étendent les paysages de la Drôme, que le poète scrute et déchiffre depuis quarante ans. Ce jour-là, Grignan et sa citadelle sont prises dans une lumière trop brutale, à la douceur balayée par le vent. Mais c’est à l’abri de la maison, dans un salon aux murs constellés de dessins et de peintures, que Philippe Jaccottet s’est mis à parler de son travail. Être du doute, pétri de sincérité, il cherche sans cesse à saisir la vérité au plus près, et n’avance qu’avec circonspection sur le terrain fuyant de la parole.
– L’abandon de la traduction, qui représentait une part importante de votre existence, a-t-il laissé un vide ?
– Ça n’a pas laissé le moindre vide. Je suis absolument ravi et soulagé. Quelquefois, lorsque je lis de très beaux poèmes d’ un auteur étranger, je me dis qu’il est dommage que je n’aie plus le courage ou l’envie de faire connaître telle ou telle œuvre. Mais je ne vais pas jusqu’à me remettre au travail. Je profite largement de cette liberté nouvelle, en allant beaucoup plus au hasard de mes caprices dans les lectures, en me promenant peut- être encore davantage que je ne le faisais avant. Je ne crois pas que j’écrive plus en ce qui concerne mes œuvres personnelles, dès lors qu’elles ont toujours été le résultat d’une pression intérieure, dont l’ absence fait que je ne peux pas me forcer à écrire. De sorte que j’ai gagné surtout une espèce de tranquillité d’esprit, qui peut-être se reflète dans les textes que j’ ai écrits depuis lors.
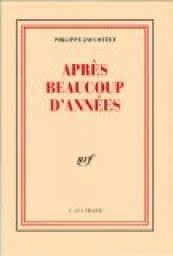
– Une chose m’a frappé dans votre dernier recueil, «Après beaucoup d’années», c’est le dépouillement de la forme.
– C’était déjà présent, je crois, dans Cahier de verdure. Il y a un peu plus de sérénité et de clarté que dans d’ autres livres. Mais je ne voudrais pas non plus exagérer sur ce point. Il y a tout de même un texte qui relate la fin d’une jeune femme que nous aimions beaucoup, qui fait que la mort , dans ce qu’elle a de plus brutal, de plus incompréhensible, est présente. En écoutant La Passion selon Saint-Jean, je me disais qu’il y a quelque chose de terrible de vivre dans une époque où il n’y a pas de telles œuvres pour transfigurer la souffrance. Parce qu’il n’y a pas de doute que les moments les plus prodigieusement beaux de cette Passion sont les moments de la mort du Christ. Il y avait donc ce génie qui était capable de transformer la mort en quelque chose de lumineux, sans qu’on ait l’ impression que ce soit un tour de passe-passe, ce qui serait affreux. A mon tout petit niveau, j’essaie d’écrire des textes dans lesquels les événements ne seraient pas masqués. La douleur ne serait pas masquée, mais transformée, d’ une certaine manière accueillie par les mots, avec toujours cette crainte de céder à un mensonge, à une illusion, qui est constante chez moi, mais peut-être moins présente qu’avant. Je dirais qu’il y a une plus grande fermeté dans l’affirmation de la présence du monde, de ce qu’il y a dans le monde de profondément nourrissant et positif. Avec aussi une moins grande crainte de me laisser aller à monter vers les cimes, ce qui est d’ ailleurs littéralement le cas, puisqu’il y a ce texte «Au col de Larche», où curieusement je rejoins des souvenirs très anciens. J’ ai naturellement passé des vacances en montagne quand j’ étais enfant en Suisse, et puis ensuite il y a eu une sorte de refus de la montagne, à cause du tourisme, à cause de clichés un peu stupides, peut-être aussi à cause de l’influence de Gustave Roud, du Petit traité de la marche en plaine. Avec le fait qu’ici nous allons beaucoup dans les petites montagnes des Préalpes, j’ ai retrouvé tout naturellement, sans les chercher, des sensations très fortes liées à ces lieux hauts, à leur fraîcheur, au jaillissement des torrents. J’ étais heureux de retrouver ces sensations-là à un moment de ma vie qui est tout de même loin du commence- ment. Ce qui explique que dans un autre texte, où je parle aussi des eaux qui descendent de ces petites montagnes, j’aie eu envie de citer Hésiode, non pas par une espèce de goût de la culture, mais parce que, dans ces textes d’Hésiode, sont dites des sensations extrêmement fraîches, extrêmement limpides et fortes, comme on peut les avoir eues dans une période lointaine. Il me semble que nous-mêmes parfois, dans notre expérience la plus banale, nous rejoignons quelque chose qui est vraiment hors du temps, presque au commence- ment du temps.
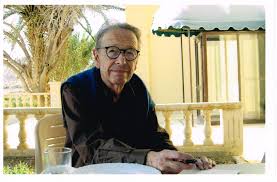
– N’y a-t-il pas aussi un retour, par la montagne, de ce qu’on pourrait appeler le pays natal ?
– Sans doute. Je ne voudrais pas que ce soit comme un retour en arrière. Je n’ ai aucune nostalgie de l’enfance. Mais il y a cette chose presque merveilleuse qu’en se retournant, d’une certaine manière, vers ce qu’on a vécu, on n’ a pas l’ impression de se retourner vers l’arrière. Finalement la lumière n’ est pas forcément derrière soi lorsqu’on a déjà beaucoup de temps derrière soi. Ce sont des choses peut-être un peu folles à affirmer ainsi et je ne suis pas quelqu’un qui a une rigueur de pensée suffisante pour les affirmer autrement que comme intuition poétique, donc à l’intérieur d’un poème, et non dans une théorie quelconque.
– Y a-t-il chez vous la recherche de la pérennité dans ce qui est éphémère, la quête d’ une sorte de permanence des choses ? Je songe en particulier au texte que vous consacrez aux pivoines.
– Je pense que le mouvement profond de toute œuvre, et pas seulement poétique, est cette lutte contre la destruction par le temps et la mort. S’agissant des pivoines, dans ce dernier livre, je les regarde, et je les trouves belles, et je trouve étrange d’être à ce point ému par leur beauté, donc j’ essaie de les dire. Mon souci n’est pas de les faire durer plus. Il s’agit d’essayer de com- prendre leur mystère, de comprendre pourquoi elles me touchent, et alors je passe par des métaphores qui sont parfois un peu trop maniérées, un peu trop jolies, qui font partie des détours de mon travail. Mais j’ai le sentiment d’approcher un peu plus de leur étrange présence. Elles sont comme dans un autre monde. On ne peut donc les com- parer à quoi que soit. A la fin du texte, alors que j’ essaie de les cerner comme les cernerait un peintre, c’est peut-être à ce moment-là, quand je dis qu’elles sont comme liées à la pluie, qu’ elles sont le plus présentes. Les poètes japonais du haïku ont réussi à merveille, à mon sens, à saisir cette espèce de scintille- ment. C’est une présence et une absence.
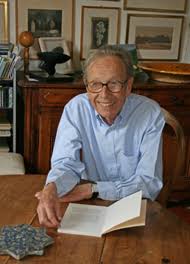
– Avez-vous l’impression, de livre en livre, d’ avancer dans le déchiffrement du monde ?
– Ce serait évidemment beaucoup dire. Il me semble que chaque fois que j’ aborde un sujet analogue, j’ arrive sensiblement au même résultat. On progresse un peu dans le maniement de la langue et peut-être aussi dans la simplicité. Mais le progrès dans le déchiffrement… S’il y a progrès, c’est peut-être dans le fait qu’il y aurait une force un peu plus grande donnée à la lumière sur l’obscurité, avec toute la prudence qu’il faut quand on affirme ce genre de choses, car tout peut être balayé d’ un coup avec des événements malheureux.
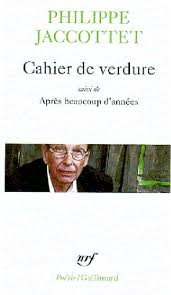
– Cela voudrait dire qu’il existe, quelque part, des frontières de l’indicible infranchissables.
– Il me semble, oui, pour autant que j’ accepte de m’ aventurer sur ce terrain glissant de la philosophie. Ce qui nourrit un mouvement poétique, le besoin qu’a un poète d’écrire est le fait qu’il se heurte à quelque chose d’insaisissable et qu’il a, par défi, envie de saisir, mais qui se dérobe toujours, recule indéfiniment. Cela correspond rigoureusement à ce que peuvent dire certains scientifiques sur la connaissance du monde, qui fait de tels bonds prodigieux en avant, et qui en même temps se heurte à des espèces de limites qui reculent sans cesse. Je crois que par le travail et par l’intuition poétiques, on aboutit à des conclusions assez proches.
– Vous évoquez le fait que l’Histoire vous a peu atteint, que vous êtes resté fidèle à certains principes. Comment voyez-vous la position du poète dans le monde ?
– Je suis touché, évidemment, par ce qu’on peut finalement ranger sous le signe du Mal, pour simplifier. Comment ne serait-on pas sensible à cela, et comment ne serait-on pas, parfois, obsédé, au point de songer à ne plus écrire. Je crois que j’ai peut-être traduit cela le plus nettement dans A travers un verger. Ce n’était pas, alors, à propos de l’histoire du monde, mais de la mort de quelqu’un, ce qui est le même problème. Je ne peux parler que de ce qui est tout proche de moi. Je pense que si j’ étais dans un pays touché par la guerre, ou bien je me tairais, parce que ce serait trop affreux, ou bien je parlerais de ce qui est là, à côté de moi. Lors de la guerre du Vietnam, par exemple, il y avait des poètes français ou suisses romands qui mettaient le mot Vietnam dans leurs poèmes, ou des bombes au napalm, et finalement c’était de la fumisterie. Ça pouvait bien sûr partir d’ un très bon senti- ment ou d’ une émotion vraie, mais ne rimait à rien. Ce n’est pas de parler de la guerre dans les poèmes qui change quoi que ce soit. Je crois aussi qu’il y a des espèces d’écrivains différents. Le poète lyrique a toujours existé et existe encore aujourd’hui de manière défendable, bien qu’on puisse se poser des questions sur sa légitimité d’existence. Il parle, et il a à parler, et il est capable de parler de toute autre chose, qui est de l’ordre de ce qui continue à exister, même dans les périodes d’extrême violence. Je parle aux autres même quand j’ai l’ air de ne parler que de fleurs ou d’arbres, disons jusqu’à satiété. Il s’agit de choses aussi importantes, dans la vie humaine, que les problèmes que nous évoquions. Je pense aussi que si on me lit bien, on remarque le poids d’une espèce de destruction générale, cette sorte de fragilité dans laquelle nous sommes plus qu’autrefois, surtout parce que nous sommes davantage conscients et renseignés. Cette présence de la menace et du désastre est souvent affirmée. Mais cela est dit sans références immédiates aux événements de l’histoire. C’est ma façon d’être. Il est vrai que parfois, je me dis: n’est-ce pas obscène d’écrire de pareils textes, quand on voit ce qu’on voit à la télévision ? Il m’arrive de le penser, mais je ne le crois pas vraiment. Le monde est ce qu’il est, et rajouter sur la cendre et la suie et l’horreur, je n’en n’ai pas envie. Il ne faut pas faire semblant d’être dans une ville assiégée quand on est ici. Il y a une honnêteté à dire et à continuer de dire ce qui compte, ce qui est au centre. Il faut s’en tenir à ce qui est, pour soi, une nécessité et aussi une joie.
– C’est une question de sincérité, d’authenticité ?
– Oui, je crois, mais qui n’est même pas vertueuse. C’est presque physique, mécanique. Les textes que j’écris, ce qui les a nourris était suffisamment central et fort pour devenir des mots sur la page. Sinon, tout ce qui est un peu marginal, si je me force à le faire, devient mauvais. C’est donc de l’authenticité, mais pas par vertu.
– Les derniers mots de «Après beaucoup d’années» suggèrent que, dans le fond, votre travail poétique pourrait s’ arrêter là.
– Oui. Je ne suis pas du tout sûr d’écrire encore. On peut compter, chez les poètes, le nombre d’ œuvres écrites après soixante ans qui soient vraiment de qualité. Et puis il y a tant d’exemples de gens qui se répètent en vieillissant… Alors, je me dis qu’il vaut peut-être mieux ne pas se forcer. Si j’ai encore des émotions suffisamment fortes pour déclencher des poèmes ou des proses, je ne vais pas me retenir. Mais, tout pourrait s’arrêter, parce que j’ai eu un sentiment assez fort, de quelque chose de tellement impalpable que peut-être, oui, je ne dirais rien de plus en poésie.
Propos recueillis par René Zahnd.