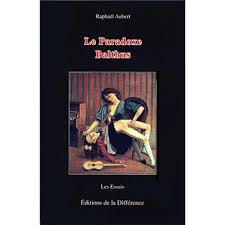Le mystère Balthus

Le Paradoxe Balthus, de Raphaël Aubert
par Janine Massard
Dans Le Paradoxe de Balthus, essai publié aux éditions de La Différence, Raphaël Aubert se penche sur le parcours du grand peintre, qu’il nous montre dans sa superbe mythico-mondaine de comte Klossowski de Rola, titre de noblesse dont il abusait car seul son frère Pierre, l’écrivain et son aîné, avait le droit de le porter. Mais peut-on tenir rigueur à un artiste d’arranger son patronyme ? Et Balthus proclamait aussi que peindre était une prière, que toutes ses figures féminines étaient des anges et sa peinture essentiellement et profondément religieuse…

Raphaël Aubert, se fondant principalement sur lestableaux de l’exposition de 1934 (le peintre n’a que vingt-six ans), analyse quelques œuvres dont La leçon de guitare, la Fenêtre, Alice, La Chambre, La Toilette de Cathy et La Rue, ainsi que d’autres peintures phares de la première partie de la viede Balthus pour décrypter le fondement de l’artiste, au-delà de ses allégations.
Ainsi La leçon de guitare, qui fit scandale lors de l’exposition, tableau dans lequel on voit laprofesseur substituer à la guitare le corps d’une fillette et promener ses doigts près du pubis comme s’il s’agissaitd’un instrument. La pose lascive de la fillette, tête renversée, n’a rien à voir avec le monde des anges et derrière cette scène de pédophilie saphique, il y a la position des personnages de la Pietà de Villeneuve-les-Avignons. La cruauté glacée de la scène n’a pas échappé à AntoninArtaud qui, dans la NRF, fit un compte-rendu très élogieux de ce tableau.
La Fenêtre manifeste l’effroi d’une jeune femme, agressée sexuellement et prête à se jeter par la fenêtre. Et puis, il y a ces poses troubles de fillettes, comme celle de Chambre, qui ne laissent aucun doute sur l’extase qui habite la gamine.

Alice est un tableau débordant de sensualité trouble, construit autour du pubis de la femme, que Pierre Jean-Jouve acheta et garda jusqu’à sa mort dans sa chambre àcoucher en confessant quec’était toujours le mêmetrouble qui l’habitait lorsqu’il contemplait ce tableau.
Celui de La Rue, lié à l’enfance, montre un étrange petit enfant à tête d’homme et porté par une femme, et dans le coin à gauche un jeune homme tentant de violer une fillette. Au centre, se trouve un personnage en blanc por-tant une planche, référence à L’Elévation de la Croix dePiero della Francesca.
Raphaël Aubert se base sur l’étrangeté contenue dans ces tableaux et leur appui sur les grands maîtres de la peinture pour démontrer que si Balthus réinvente des choses qui ont existé cela s’insère dans une volonté presque désespérée d’assurer la continuité de l’histoire del’art, quitte à gommer sa propre individualité.
Il cite le peintre : « Je bute parfois sur quelque chose que je n’arrive pas à trouver et qui me hante éperdument :l’enfance de l’art. » Ainsi voit-il son univers comme« le tragique palpitant d’un drame de la chair » et « les lois inébranlables de l’instinct ».

Vers 1949, AlbertCamus, à propos de La victime,représentation d’une jeune fille égorgée, aux yeux révulsés, dont le corps est déposé dans un drap-linceul en forme de mandorle, écrira :« C’est le côté Barbe-bleue de cette peinture. Balthus a trop le goût des limites pour ne pas faire sa place au crime où s’achève parfois la plus effroyable connaissance. »
Des regards aigus, déjà, avaient saisi la profondeur deBalthus. L’originalité de Raphaël Aubert réside dans la proposition selon laquelle«Balthus ne fait que mimer la posture de l’artiste classique. À certains égards, il opère dans le domaine de la peinture ce qu’un Jean-Paul Sartre a tenté en littérature avec LesMots: son œuvre se donne à voir – mais malgré elle,comme un adieu à la peinture. »
Le décryptage de cette œuvre singulière s’arrête en 1960 mais, dès ces années-là, les vieux démons ont cessé de hanter le maître. Le Paradoxe Balthus est une approche très personnelle du peintre et ouvre de belles possibilités de réflexions et de discussions sur la peinture du XXesiècle, puisque c’est bien en lui que se sont confrontés modernité et classicisme.
J. M.
Raphaël Aubert. Le paradoxe Balthus , Editions de la Différence, 2006.
(Le Passe-Muraille, No 68, 2006)