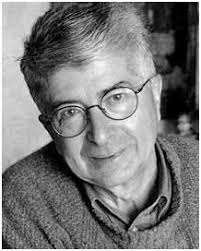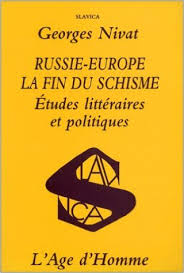Le jour se lève à l’Est, la Russie va tenter de vivre
À propos de l’humanité trop humaine de la Russie et de sa littérature. Entretien avec Georges Nivat,
par JLK
Il est rarissime de trouver, dans un livre de critique littéraire, une matière aussi dense et aussi passionnante que celle qui bouillonne dans le nouveau «monstre» de Georges Nivat. Nulle autre littérature plus que la russe, il est vrai, n’a cristallisé avec autant de puissance, de génie et de variété tous les aspects de la condition humaine. Lorsque Georges Nivat demandait à son maître, le slavisant Pierre Pascal, ce qui l’avait attaché à la Russie, celui-ci lui répondit: «J’ai été frappé par son humanité: c’est le mot qui résume peut-être le mieux cet ensemble de vertus que j’ai trouvées aux Russes». Or l’humanité de la littérature russe nous frappe à notre tour comme une récapitulation de toutes les aspirations, déconvenues, tribulations, perversions et redressements de l’homme contemporain.
Fabuleuse traversée de la littérature russe, ce recueil d’ études littéraires et politiques nous confronte aussi bien aux grandes espérances des utopies contemporaines et à leur détournement funeste, à la glaciation communiste, puis à la récente implosion du régime et à la renaissance difficile d’une nouvelle société. La première fois que son maître envoya Georges Nivat en Russie, c’était juste après le XXe Congrès du PCUS. En la personne de Boris Pasternak, le jeune slaviste approcha le dernier grand représentant de la Russie raffinée d’ un autre temps. Or, une vingtaine d’années plus tard, il lui fut donné d’approcher, aussi, cet autre symbole qu’incarne Alexandre Soljenitsyne dont il devint le commentateur lumineux et clairvoyant.

A équidistance de la passion vive et de la lucidité raisonnable, Georges Nivat est de ceux qui savent illustrer la grandeur d’ un auteur tout en soulignant posément leurs possibles égarements. Ainsi ses approches de Tolstoï et d’ Alexandre Zinoviev , de Tchekhov ou de Rozanov nous en imposent-elles par leur équanimité. Tour à tour lecteur savant mais non moins personnellement impliqué et ne discontinuant d’arrimer les œuvres à la vie, historien de la littérature, sociologue ou penseur très ouvert à la dimension religieuse, Georges Nivat poursuit, dans Russie-Europe, la fin du schisme, une réflexion sur la destinée de la Russie amorcée il y a dix ans avec une autre somme intitulée Vers la fin du mythe russe. Simultanément, le slaviste de Genève publie un journal de voyage à la fois éclairant et fraternel, où nous découvrons, sur fond de marasme, la campagne russe et son peuple libéré qui chemine à tâtons vers la lumière.
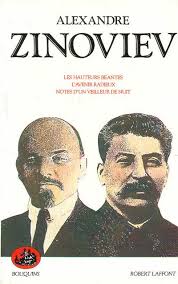
– Zinoviev a décrit l’homo sovieticus comme une sorte de mutant atrophié, de rat social. Qu’en est-il aujourd’hui ?
– Toute révérence gardée à l’égard du génie satirique d’ Alexandre Zinoviev , je ne l’ ai jamais considéré, pour ma part, comme un sociologue vraiment fiable. L’image du ratorium m’est toujours apparue comme un paradoxe littéraire. Sans doute y a-t-il dans ses livres une quantité d’observations justes, mais l’homme russe vivant ne se réduisait pas à ces caricatures. En fait, Zinoviev pensait que toute la société soviétique obéissait aux mêmes mécanismes qu’ il a observés au sein du Parti, formant un bloc monolithique voué à durer mille ans. Mais la société soviétique était traversée de tensions contradictoires, composée d’un mélange de culture et d’anticulture détonant. Il y avait là-dedans le germe de la ruine. Ce qu’on n’a pas encore bien perçu, c’est que le moteur premier de la campagne de Boris Eltsine a été l’attaque en règle du Parti, qui avait accumulé un potentiel de haine formidable. En outre, Zinoviev, pas plus d’ailleurs que la CIA, ne s’est avisé de l’importance cruciale du phénomène qu’ a constitué la révolte de la classe ouvrière.
– Quelle est, aujourd’hui, l’influence des intellectuels dans la société russe, et comment les écrivains vivent-ils ?
– Les intellectuels ont joué un rôle exceptionnel durant la perestroïka, mais leur influence a beaucoup diminué depuis lors. Pareillement, le prodigieux bouillonnement des publications, revues, journaux de toute sorte, qui a marqué le tournant des années 80-90, est retombé faute de moyens économiques. Victimes de l’hyperinflation, les revues ne trouvent plus d’ abonnés au- delà de six mois Quant à la plupart des écrivains choyés de naguère, ils se trouvent à présent dans une situation précaire, sinon critique. La puissante Union des écrivains, qui comptait tout de même 10’000 membres entretenus à proportion de leur docilité, a éclaté en cinq ou six tribus rivales qui se disputent les dépouilles. Le même nettoyage s’accomplit dans le domaine de l’édition, dont les contingents pléthoriques d’ employés ont subi des coupes sombres, tandis qu’ on loue une partie des anciens locaux aux Japonais, en dollars bien entendu.
– Qu’ en est-il des nouveaux écrivains. Y a-t-il des œuvres qui ressortent du lot ? Et les traductions françaises dont nous disposons sont-elles représentatives ?
– De nouveaux écrivains intéressants sont apparus, mais je ne saurais dire qu’une œuvre en prose majeure s’ impose particulièrement. Les traductions qu’on a vu paraître en France reflètent assez bien la situation, avec les récits «troglodytes» de Vladimir Makanine, peintre noir des décombres de l’utopie, de l’hyperréaliste Sergueï Kaledine évoquant une société en état de survie, les nouvelles plus lyriques d’Oleg Ermakov qui font écho à la guerre de l’ Afghanistan, les romans frottés d’ érotisme provocateur d’ un Victor Erofeev ou les proses satiriques d’un Viatcheslav Pietsoukh.

– Soljenitsyne parlait récemment de la nécessité d’une expiation à l’ échelle nationale. Qu’ en pensez-vous ?
– Il me semble que l’équivalent de la dénazification est impossible en Russie. Soljenitsyne a raison de souligner le fait que tous ne sont pas coupables des crimes du passé. Cependant, le système communiste a cela de particulier qu’il «mouille» tout le monde, d’une façon ou de l’autre. Ce qu’il faut remarquer, c’est que l’ application de la violence s’était beaucoup affaiblie ces dernières décennies. Une chose est certaine en outre, c’est que la société a radicalement extirpé la peur. Plutôt qu’une chasse aux sorcières, je crois que l’ expiation peut s’accomplir par le truchement de l’ art et de l’ éducation. La découverte, dans les années 1990-91, des grandes voix interdites de Soljenitsyne, de Grossman ou de Chalamov, entre beaucoup d’autres, a été l’occasion de formidables remises en question personnelles pour l’immense majorité des enseignants qui perpétuaient une certaine idée de l’histoire. Ce n’était pas tant qu’ on leur apprenait, soudain, des faits insoupçonnés. La plupart des gens connaissaient, par exemple, l’ existence du goulag. Mais il en allait de l’interprétation de ces faits. Tout à coup, les dogmes fondamentaux de la religion d’Etat ont été battus en brèche, jusqu’au caractère intouchable de Lénine en personne. On n’imagine pas le séisme qu’ont provoqué, à cet égard, des livres comme L’Archipel du goulag ou Vie et destin de Grossman. Ce fut là un début d’expiation. Et maintenant, c’est un bouleversement complet qui affecte l’enseignement de l’Histoire.

– Vous parlez des «forces de haine» qui travaillent le pays ? Quelles sont-elles, et quels éléments positifs s’y opposent- ils ?
– Il y a un nationalisme exacerbé qui véhicule une haine néfaste. Celle-ci apparaît notamment dans une certaine presse où reviennent les thèmes du complot international judéo-maçonnique ou de la pourriture de l’Occident. Cela étant, je ne crois pas que la Russie profonde soit réellement atteinte par cette peste, et la remarquable maîtrise qu’ elle a manifestée dans la démocratie émergeante le prouve, me semble-t-il. Certes les chauvins existent, et les anciens privilégiés s’ accrochent à leurs vestiges de pouvoir, enfin la corruption et la délinquance se déchaînent dans une jungle où les mafieux ont la vie belle, comme le décrivent d’ ailleurs maints écrivains. Enfin les meilleurs d’entre ceux-ci ne résistent pas toujours aux excès du nationalisme, à commencer par un Valentin Raspoutine.
– Quelle est alors la différence, selon vous, entre patriotisme et nationalisme ?
–Je crois que ce qu’il y a d’inacceptable, dans le nationalisme outrancier, se résume à la haine de l’autre. Il est certes compréhensible, voire légitime, que des nations longtemps frustrées de leur identité par le marxisme-léninisme, développent des réactions qui s’opposent également à l’ utopie du «village mondial» selon Mac Luhan. Le nationalisme renaît partout où il a été opprimé, cela me semble une loi de la physique des nations. Reste à savoir où s’ arrête la nation russe, et dans quels habits elle va s’accepter. Ce qui me paraît essentiel, c’ est qu’ elle échappe à la tentation de s’affirmer aux dépens des autres. C’est d’ailleurs le premier mérite d’Alexandre Soljénitsyne, partisans de l’autorestriction et d’une Russie des petits espaces, que d’avoir toujours résisté à la tendance impérialiste des nostalgiques d’une grande Russie.
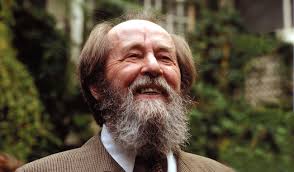
– Pensez-vous que Soljenitsyne soit appelé à jouer un rôle particulier quand il sera de retour au pays ?
– Ce pourrait être le cas si le pays avait à affronter une crise d’une gravité exceptionnelle. Autant dire que je ne le souhaite pas. Jusque-là, en dehors des recommandations qu’il a formulées, vous aurez remarqué sa discrétion. Ceci dit, il reste assurément, après la disparition de Sakharov, l’une des rares grandes voix qui inspirent encore confiance. Ce qu’il a déjà dit sur le danger que constituait le maintien de l’ empire a été salutaire. En outre, je suis convaincu qu’il contribuera à la réconciliation nationale.
– Que souhaiteriez-vous dire aux Occidentaux à propos de la Russie ?
– J’aimerais qu’ils fassent l’effort de mieux la connaître. Et d’abord, que nos médias envoient là-bas des correspondants qui sachent le russe, car trop souvent les correspondants, vivant en vase clos, ne sont à même que de colporter les rumeurs du seul milieu intellectuel moscovite. Enfin et surtout, j’aimerais qu’on ne se borne pas à considérer la Russie comme une mendiante. Elle a toujours des choses à nous apprendre et de grandes richesses à nous donner, notamment du point de vue intellectuel et spirituel. J’ai rencontré, dans la province russe, des jeunes gens très instruits et très ardents qui animent une véritable renaissance spirituelle. Le message que je voudrais transmettre de la part de ces Russes n’est pas de noyés qui tendent la main, mais de frères humains en quête de lumière et d’espoir.
Propos recueillis par JLK
Georges Nivat, Russie-Europe, la fin du schisme, L’âge d’Homme, 1993.
(Le Passe-Muraille, Nos 6-7, mai 1993)