Journal de l’imprécateur
À propos de Léon Bloy, mystique entrepreneur de démolition,
par Gérard Joulié
Léon Bloy est mort le 3 novembre 1917 à Bourg-la-Reine, au sud de Paris, à l’âge de 77 ans. Bien qu’il se fût acquis la réputation d’un écrivain d’une incontestable originalité, aucun de ses ouvrages, pas même son chef-d’œuvre, La femme pauvre, n’avait de son vivant dépassé deux mille exemplaires. Tout cela a quelque peu changé. Durant le demi-siècle qui suivit sa mort, les livres de Bloy connurent un sort différent de ceux de la plupart des littérateurs de son temps: ils gagnèrent un public toujours plus large. Aujourd’hui, nul ne songe plus à contester la qualité du style de Bloy, le lyrisme de son inspiration, la richesse d’une pensée qui puise son inspiration aux sources les plus élevées. A tous ces dons, comment ne pas ajouter l’art prodigieux avec lequel il maniait l’imprécation. Son Journal est là pour en témoigner: L’Age d’Homme publie l’intégralité en trois volumes, dont le premier vient de sortir.
«Pamphlétaire, disait-il à un ami, sans doute que je le suis, parce que je suis forcé de l’être, vivant comme je peux, dans un monde ignoblement futile et contingent, avec une faim enragée de réalités absolues. Tout homme qui écrit pour ne rien dire est à mes yeux un prostitué et un misérable et c’est à cause de cela que je suis pamphlétaire». Ailleurs il dira: «J’eus le malheur de naître avec un sentiment d’impatience et de mécontentement contre tout ce qui constituait mon entourage immédiat.» Ou encore: «Je suis bonnement un pauvre homme qui cherche son dieu en l’appelant avec des sanglots par tous les chemins. La vérité bien nette qui éclate dans tous mes livres, c’est que je n’écris que pour Dieu.»

Les titres de son Journal sont d’ailleurs significatifs: Le mendiant ingrat, Le vieux de la montagne, Au seuil de l’Apocalypse, Quatre ans de captivité à Cochons-sur Marne... S’y déroulent, sous un jour cru et dans une langue de lion rugissant, l’interminable file de ses misères, les douloureuses péripéties de sa vie, mêlées d’invectives pour les mauvais prêtres, les donneurs chiches, le mauvais riche, et d’alléluias argentins en faveur du donateur généreux, de l’ami fidèle et opportun, du visiteur secourable. A l’égard de sa femme et de ses enfants, il garde une pudeur dont on lui reste reconnaissant.
La partie la plus frappante du Journal, ce sont les invectives dont il sait renouveler les images, le ton et le rythme avec une verve incroyable et d’autant plus qu’elle ne se démentit pas pendant un demi-siècle. Il n’a, dans ses cuisantes diatribes, fait grâce à personne. Le pape n’est pour lui qu’un fétide calotin, et les évêques des Judas engraissés dans l’ignominie qui viennent pieusement lécher les pieds de Marianne, la «grande salope».
Une certaine absence de respect humain se voit quelquefois. Mais l’absence totale de celui-ci, comme chez Bloy, se voit si rarement qu’on en est saisi de stupeur. De même la foi complète est un spectacle qui nous est rarement donné. Or Bloy eut cette foi complète, sans restriction ni hésitation, sans concession d’aucune espèce, telle qu’en notre ère de doute, de libre examen et d’esprit critique on serait tenté de la trouver monstrueuse. Bloy fut ce monstre.

Le Journal participe aussi à vrai dire de la théologie et de l’histoire. Bloy y insère souvent des commentaires sur son temps et sur la pente invincible qui mène le siècle aux fins dernières. On sent en outre qu’il a voué une dévotion spéciale à la Vierge, «Celle qui pleure», et au Saint-Esprit. A tel point qu’il se permet parfois de traiter le Christ de haut. Il écrit en effet dans son Journal en date du 14 août 1892: «Aujourd’hui dixième dimanche après la Pentecôte vu ceci: le pharisien représente le Christ; le Publicain le Saint-Esprit. Remarqué que le premier dit qu’il n’est pas: non sum, tandis que le second affirme, en demandant grâce, qu’il est un pécheur.» Bloy voyait là une confirmation de son principe suivant lequel l’Esprit saint remplacerait le Christ, déchu par la faillite de son Eglise.
Ce qui caractérise Bloy, c’est l’impatience et la frénésie. Une frénésie sans pareille dans notre histoire littéraire. Frénésie née d’un sentiment d’urgence extrême, comme si l’Histoire allait s’abîmer sous une avalanche d’éternité. Et celui qui fatigue le ciel de ses clameurs pense provoquer cette avalanche. Bloy vivait à la frontière du Temps, attendant que celui-ci se précipite et bascule dans l’Eternité, ce qui est tout le contraire d’être à l’avant-garde de l’Histoire, car Bloy, comme les prophètes, «qui se souviennent de l’avenir», considérait le futur comme étant déjà du passé. «En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n’arrive», disait le Christ, prince de l’impatience.
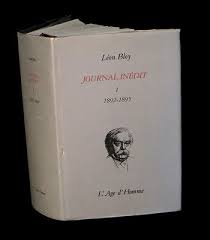
Il y a dans l’impatience de Léon Bloy, dans son lyrisme d’artiste chrétien exilé de la beauté, comme une tentative de briser le mutisme de Dieu pour qu’il émette la parole irréfutable, et à l’égard de l’homme, pour que celui-ci se soumette, par la violence, à la parole qu’il ne comprend pas. Comme Mallarmé, Bloy croit à la magie de la forme. C’est pourquoi il cherche le mot définitif, le mot implacable, «le mot frappé d’absolu qu’on ne retire jamais plus et qui peut mettre en mouvement d’occultes puissances». Bloy aimait à dire que «la splendeur du style n’est pas un luxe» mais «une nécessité». Aussi ce Latin, ce Français est-il le plus byzantin des écrivains catholiques.
«Bloy sait vitupérer d’une façon inouïe», écrivait Kafka. A l’heure où les philosophes de son temps, Taine, Renan, affirmaient que le monde est désormais sans mystère, et qu’on faisait une idole de la Science, à l’heure où triomphaient, selon le mot de Baudelaire, M. Progrès et Dame Industrie, Léon Bloy, tapi dans la tanière de son âme, proclamait les droits du Surnaturel.
G. J.
Léon Bloy, Journal inédit I, L’Age d’Homme, 1996.
(Le Passe-Muraille, No 24, Avril 1996)



