Homme déchiré
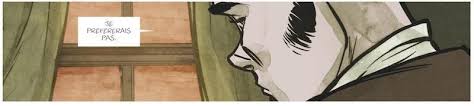
À propos de Bartleby le scribe d’Herman Melville
par Antonin Moeri
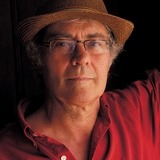
Je dois absolument vous faire part d’un étonnement. Chaque fois que j’ai évoqué, avec des inconnus ou avec des proches, le nom de Bartleby, la conversation a immédiatement tourné autour de ce personnage blême, ni aimable ni attachant, qui engendre par sa présence, son mutisme et sa résistance passive, une progressive désorganisation dans l’open space de l’avocat qui vient de l’engager. La conversation a immédiatement tourné autour de ce personnage désarmé et désarmant qui sera broyé dans une relation de pouvoir.
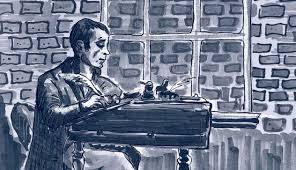
Il est vrai que ce personnage singulier dont on ne sait rien a une fonction, dans le récit de Melville, qui rappelle celle du protagoniste de «Théorème» de Pasolini: ce beau jeune homme qui, par sa présence et sa grâce, vient troubler l’organisation d’une famille de riche industriel milanais. Il est également vrai que Melville a donné à sa nouvelle le titre «Bartleby» et que le lecteur est amené à penser que le protagoniste est ce copiste anorexique, un copiste qui, par son étrange comportement, va peu à peu sortir de scène pour avoir refusé de jouer le jeu social.
Mais à y regarder de plus près, le lecteur s’aperçoit que le protagoniste n’est pas Bartleby mais bien l’avocat, celui qui engage et emploie Bartleby.

D’ailleurs, c’est bien l’avocat qui prend la plume pour rédiger une sorte de confession. Le lecteur n’aura droit qu’au point de vue de cet homme au coeur plus ou moins grand. Un avocat cultivé qui interroge sa conscience quand il le faut et qui ne reste pas indifférent au malheur des autres. Oui, c’est bien la question que pose Melville dans cette nouvelle: Comment devrait-on ou peut-on réagir devant la détresse, la souffrance des autres? Jusqu’à quelle limite peut-on ou doit-on éprouver de la pitié?
Après le premier refus de Bartleby d’obéir aux ordres de son empoyeur, celui-ci essaie d’absorber le choc. Or quelque chose en Bartleby émeut et déconcerte cet employeur-narrateur. Au deuxième refus du copiste, l’avocat est envahi par une cruelle perplexité. Il va observer son employé de plus près et constate que celui-ci ne sort jamais pour aller déjeuner ou pour aller se promener et qu’il se nourrit uniquement de biscuits au gingembre. Homme de raison, sérieux, posé, méthodique, l’homme de loi décide, après mûre réflexion, de garder cet employé récalcitrant, un employé au comportement inqualifiable. Il s’efforce «charitablement d’interpréter par son imagination ce qui se révèle insoluble pour la raison. Si je le renvoie, il risque de tomber sur un employeur moins indulgent et on le traitera avec brutalité. Oui. Je peux m’offrir à peu de frais une bonne conscience».

Quand Bartleby refuse d’aller à la poste pour relever le courrier, l’employeur reste «assis absorbé dans une profonde méditation». Et lorsque, un dimanche matin, il décide de faire un petit tour par son étude, il découvre à sa grande surprise un Bartleby à moitié nu déclarant qu’il est «très occupé pour l’instant». L’avocat se sent dévirilisé car il obéit à son employé qui lui ordonne de faire deux ou trois tours du pâté de maisons. En revenant à son étude, il constate que Bartleby s’est installé dans son bureau «comme un célibataire dans sa garçonnière». Profonde mélancolie. «Fraternelle mélancolie!» Troublé par cet élan compassionnel, il se soumet docilement à toutes les excentricités de son employé. Il n’ose plus lui demander le moindre service.
Or cette mélancolie va se transformer en crainte. En effet, si l’aspect de la misère mobilise nos meilleurs sentiments, jusqu’où peut-on s’engager sans y laisser des plumes? On peut certes offrir de l’argent pour soulager la misère ou aider le déplorable d’une autre façon. L’homme de loi continue de faire preuve d’indulgence à l’égard de son employé qui refuse, cette fois, de lui dire où il est né.
Le vase déborde lorsque Bartleby renonce définitivement à copier les documents, c’est-à-dire à faire son travail pour lequel il est rémunéré. «Il était devenu comme une pierre à mon cou, collier non seulement inutile mais lourd à porter». Que faire face à une «épave au milieu de l’Atlantique»? Les affaires sont les affaires! Tout le monde sera d’accord (le lecteur y compris) avec la décision de l’employeur: licencier ce branquignol! On ne va tout de même pas héberger un SDF! Que diront les confrères, les clients, les amis?
Et voilà que le branquignol refuse de quitter les lieux! L’avocat lui règle son salaire en y ajoutant 20 dollars. Pitié, charité, Bon Samaritain, ça va un moment! Dès qu’on se soustrait aux lois du marché, le couperet tombe! Oui, nourrir une trop grande pitié à l’égard d’un excentrique pourrait coûter sa réputation à l’avocat dont les affaires, en ce moment, vont bon train. Une étude d’avocat n’est pas un foyer pour SDF! Un homme de loi n’est pas Mère Teresa. La pitié peut vite se transformer en répulsion! S’il ne veut pas devenir fou, l’avocat est obligé de rompre tout lien avec celui qui exerçait un prodigieux ascendant sur lui, qui le subjuguait littéralement et dont il a de la peine à se défaire. Après avoir erré dans les rues de Wall Street, il retourne à son étude et demeure foudroyé quand il se rend compte que son employé n’a pas quitté les lieux.
En proie à une perplexité inouïe, il choisit de ne pas céder à la colère et de questionner encore son employé. «Allez-vous faire quoi que ce soit qui justifie que vous refusiez de quitter ces lieux?» Devant le silence de Bartleby, l’avocat pourrait le tuer. Mais il n’est pas dépourvu de principes moraux: «Aimez-vous les uns les autres! On ne peut commettre un meurtre au nom de la douce charité! Pauvre garçon, il a traversé des moments difficiles, il mérite l’indulgence!»
L’avocat lit des livres sur le libre arbitre et l’idée de nécessité, livres qui ont un effet salutaire sur lui. Il pense désormais que la Providence lui a envoyé Bartleby. Mais la philanthropie permettra-t-elle à l’employeur-narrateur de supporter les remarques désobligeantes de ses confrères? Ou bien le jeu social aura-t-il le dessus? Que faire alors? Comment se comporter? «Tu ne vas jeter dehors une créature aussi inoffensive! Tu ne vas pas le faire arrêter par un agent de police!»
En proie à sa lancinante perpléxité, l’homme de loi n’a pas le choix. C’est lui qui va déménager! Et rien ne pourra arrêter la vague qui emportera le malheureux sans logis. L’impitoyable machine du jeu social va broyer celui qui mérite certes la pitié de l’homme bien assis mais que personne, en réalité, ne peut secourir ou insérer dans la société. La machine va effacer de la surface du globe ce cafard ignominieux qui laissera, grâce à Melville, une trace dans ce qu’il est convenu d’appeler la «littérature».
J’avais besoin de ce petit détour pour vérifier ma dernière hypothèse: ce n’est pas Bartleby qui est le protagoniste de ce récit, mais l’avocat dont le lecteur ne saura ni le nom ni le prénom ni l’orientation sexuelle ni l’état civil ni la couleur des yeux ni l’origine sociale ni la masse corporelle, un avocat dont le lecteur apprendra tout au plus qu’il est «d’un certain âge».
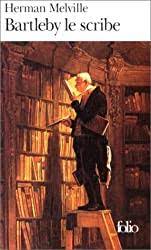
Herman Melville: L’intégrale des nouvelles, Finitude, 2021
Herman Melville: Bartleby le scribe, Libertalia, 2020
Herman Melville: Bartleby, Les Îles enchantées, GF, 1989
Herman Melville: Bartleby, Mille et une nuits, 1994
Enrique Vila-Matas: Bartleby et compagnie, Bourgois, 2002
