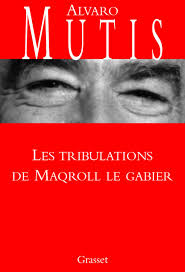Du scepticisme considéré comme un des beaux-arts
Entretien avec Alvaro Mutis,
par René Zahnd
Entraîné dans un jeu de piste qui paraît sans limites, le lecteur n’en finit pas de suivre Maqroll el Gaviero à travers les indices qu’en donne Alvaro Mutis. Héros romantique, navigateur pour des causes d’emblée perdues, arpenteur de la face cachée des horizons, bourlingueur qui joue à la marelle sur les méridiens et les parallèles, marin avec pour bagage l’érudition, figure errante sans retour possible, voyageur traquant l’incandescence de l’instant, solitaire et pourtant entouré d’amis: le «Gabier» est tout cela, et plus encore, car il ne se laisse pas emprisonner dans un filet de mots. Alvaro Mutis restitue ses aventures dans des récits au pouvoir envoûtant, dont chaque nouveau titre vient compléter le puzzle, dans un tourbillon d’espace et de temps. Mais, derrière les histoires et les situations, derrière la magie du verbe, se trouve pour l’écrivain et son double une manière d’appréhender le monde, une façon de composer avec ce cadeau redoutable: la vie.
– Quel rapport existe-t-il dans votre œuvre entre la poésie et les romans ?
– Je n’ ai jamais eu l’impression de franchir une frontière quand j’ai commencé à écrire de la prose. Pendant quarante ans, j’ai été un poète, enfin j’ai essayé d’être un poète. Et quand j’ai commencé à travailler dans le domaine de la prose, j’ai eu la sensation que je donnais à Maqroll, qui appartenait déjà à ma poésie, un espace plus vaste pour raconter ses expériences et sa vie. Mais tous les éléments essentiels de ma poésie se retrouvent dans mes narrations: une certaine désespérance, la conscience du pourrissement, de la destruction des êtres et des choses, et aussi de la nature même, qui est une problème qui me hante.
– Maqroll el Gaviero est né sous votre plume en 1946. Est- ce un personnage qui vieillit ?
– Il est très difficile ou d’un autre côté très facile, pour moi, d’expliquer son existence. Quand Maqroll a paru dans ma poésie, c’ était naturellement une sorte d’alter ego. A cette époque, je vivais un désespoir total qui, pour un homme de dix-huit ou dix-neuf ans, est ridicule si l’ on n’est pas Rimbaud. Alors j’ai appelé à mon aide ce personnage qui avait toute une expérience intérieure. C’est ainsi qu’ est né Maqroll. Mais, au fur et à mesure qu’ il apparaît dans mes romans, il s’enrichit d’un passé. Maintenant, c’ est une personne qui peut me harceler de manière inimaginable.
– D’avoir, pour un écrivain, un personnage de cette nature qui l’ accompagne et devient en quelque sorte son porte-parole, n’est-ce pas aussi une manière de se cacher ?
– Oui, de se cacher, ou de s’enrichir. Le moi de l’écrivain a toutes les limites que l’on connaît. Naturellement il y a le miracle extraordinaire de Proust, l’oeuvre de Céline. Mais cela ne me convient pas dans mon travail d’ écrivain, alors que si je laisse parler Maqroll, j’ ai l’ occasion d’élargir mon propos, de trouver des horizons plus vastes. Je ne me sens pas coincé par lui, tout au plus harcelé: il me fait changer des passages entiers.
– Mais la manière d’être de Maqroll, son scepticisme, son errance physique et métaphysique, est-ce aussi votre manière d’être ?
– Comme Maqroll, je crois qu’il n’y a rien à faire, que nous sommes perdus à partir de notre naissance, que tout effort est inutile mais qu’il faut tout de même le poursuivre, parce que cet effort est la seule raison de notre existence. Pourtant il faut savoir que c’est, quoi qu’on fasse, condamné à la vanité. C’est ce que je pense. En revanche, j’ai vécu en bon bourgeois. J’ai travaillé dans la publicité, dans les relations publiques, dans des activités tout à fait commerciales et légales, contrairement à Maqroll ! En fait, Maqroll va jusqu’au bout de sa philosophie, là où moi je n’ai pas le courage de m’aventurer. Je reste dans la position commode du type qui est sans espoir, sceptique, mais qui ne prend pas de risque. Maqroll, au contraire, estime que puisque la situation est ainsi, il faut prendre tous les risques.
– Ce qui est frappant, avec Maqroll, c’est qu’il n’y a pas de but à long terme. Le fait même de prendre un risque devient un but en soi.
– C’est ça, exactement. Quand il réussit dans les bordels, à Panama, il dit à sa compagne: c’est écœurant. Quand il remonte le fleuve pour chercher des scie- ries, il sait déjà que ça ne vaut pas la peine. Je suis certain que telle est la situation de l’ homme dans le monde. Il se fixe des buts sans y croire. Comme le dit un proverbe chinois: il faut vivre sa vie comme un homme frappé à mort. Il faut vivre dans l’ instant. Dans mon cas, le couteau qui vient me frapper à mort n’ existe pas: je l’ai mis dans le dos du pauvre Maqroll, qui paie pour moi !
– Mais le fait d’écrire, et surtout de publier des livres, n’est-ce pas une contradiction fondamentale avec le scepticisme ?
– Bien sûr. Et croyez-moi, chaque fois que je finis une page, je me demande à quoi elle sert, pourquoi faire cet effort, au lieu d’ être dans le jardin avec mes chats, avec mon petit-fils, avec des livres. C’est facile à dire. Je sais, justement, que les livres s’ oublient. Quand on pense aux écrivains qui sont «oubliés», qui sont des écrivains immenses, très importants, qui ont laissé une œuvre qu’ on imaginait presque éternelle… Il y a une énorme relativité dans la survivance des livres. J’ en suis conscient. Mais, d’autre part, en toute naïveté, quand je vois un de mes livres en librairie, j’en suis très fier, et très content d’ imaginer que je vais avoir un lecteur, qui va prendre mon livre et le lire. Pour moi, ça justifie tout l’effort accompli. Au-delà, je ne me fais pas d’illusions. Je sais que tout reste relatif. Mais, par ailleurs, imaginez l’ horreur d’ un monde où tout ne serait pas relatif, mais définitif. C’est le stalinisme. Ou le calvinisme dans ses aspects les plus durs. Je déteste les hommes bar- dés de certitudes, parce qu’ alors commencent la bureaucratie, la torture, les bûchers.
– Quel est pour vous, d’ une manière générale, le sens que peut avoir la littérature, dans un monde en guerre, malade de crise économique, où la télé- vision impose une sorte de sous-culture ?
– Dans une certaine mesure, ce que vous décrivez a toujours existé. Maintenant, nous vivons cette espèce de cauchemar qui s’appelle la communication. En vérité, on a trouvé le moyen de ne plus communiquer. Par hasard, j’ ai assisté aux retransmissions télévisées sur la Guerre du Golfe. Quand on a signé la paix, je me suis rendu compte qu’on ne nous avait jamais informé de quoi que ce soit. On a simplement été mis en contact avec des formes horribles, très primaires, et très sinistres finale- ment, qui relèvent d’ une espèce de grand marketing. J’ ai de plus plus l’impression de vivre à l’intérieur d’un superarket. Autre exemple: l’indifférence des gouvernements européens par rapport à la situation yougoslave. Ce n’est pas criminel: c’est insensé ! Il y a une inconscience totale. Nous vivons dans un monde qui ressemble beaucoup à l’an mil. Il faut se rappeler que l’an mil était une catastrophe. On imaginait simplement que le monde allait disparaître ! Par une coïncidence chronologique à laquelle je ne prête aucune attention, on est aujourd’hui à peu près dans la même situation. Alors la littérature dans tout ça ? Elle va toujours exister. Le der- nier individu au monde écrira un poème sans s’ en rendre compte. L’homme, même avec ses facultés d’ être l’ espèce la plus nocive et la plus destructrice de la natu- re, a quelque chose qu’on appelle l’ âme, qui reste dans la littérature, dans la peinture, et dans la musique.
– Vos personnages parlent toutes sortes de langues, voyagent dans le monde entier. Il y a dans votre œuvre une indéniable dimension cosmopolite, qui suggère que le monde n’est qu’un seul pays.
– J’ ai cette impression, et je l’ ai depuis très jeune. Ce n’ est pas une invention littéraire de ma part. En tant que personne, par- tout où je me suis rendu, et j’ai pas mal voyagé, j’ai toujours rencontré l’homme, à condition de ne pas tomber dans le tunnel monstrueux du tourisme. J’ aime beaucoup le mot cosmopolite. Par exemple, je goûte énormément l’œuvre de Valery Larbaud, une partie des écrits de Paul Morand ou de Michel Leiris, de Victor Segalen, ou naturellement de Cendrars, que je considère comme un ami, et de temps en temps j’ ai l’ impression qu’ il va entrer dans le bar où je me trou- ve, qu’on va boire une fine et qu’on va parler !
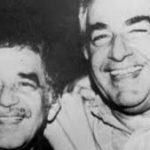
»On peut parcourir le monde entier sans avoir l’ impression de beaucoup changer de place. Il y a le décor, le climat, tous ces éléments très importants, pourtant dès qu’on est en contact avec une personne, on retrouve l’être humain. Je sais que mes propos sentent un peu la facilité, mais je le dis tel que je le vis. J’ai parlé pendant deux heures avec un chamelier au Caire: lui en arabe, moi dans un baragouin que j’inventais au fur et à mesure. On est devenu amis ! Garcia Marquez, en assistant à la scène, disait à ma femme et à sa femme que j’étais complètement fou ! Il n’ empêche que c’est ma notion du voyage: un esprit ouvert. Il est très facile de laisser de côté les questions de nationalité et toutes les autres formes de séparation.
– Quelles sont pour vous les relations de la littérature à la vie ?
– Je crois qu’il faut laisser témoignage de ce qu’on a perçu et vécu. Je crois qu’on a le droit, d’ abord pour soi-même, ensuite pour les autres, de rendre compte de notre expérience. La littérature, c’ est ça. Montaigne, dont les Essais m’accompagnent toujours, a laissé le témoignage de ses contacts journaliers, de ses rencontres littéraires, considérant ceux qu’il lisait comme des personnes. C’est ce qui donne à Montaigne sa permanence absolue. Il est à mes yeux le plus moderne des écrivains français. Ecrire, c’ est laisser un témoignage, périssable, comme tout le reste, mais le laisser justifie le travail de vivre.
– Ne pourrait-on pas dire que, dans le fond, vous ne faites qu’écrire un seul et grand livre, chaque volume venant s’ajouter pour approcher le plus possible du livre rêvé, du Livre ?
– Tout écrivain n’a qu’une ou deux choses à dire. Même Goethe, même Dante. La Bible peut-être trois ou quatre. Alors insister sur ces choses, pour qu’une petite partie reste dans les livres, c’est la lutte de l’écrivain. Il y a un affirmation qu’ aucun écrivain ne peut faire, j’ en suis persuadé, c’ est d’ avoir mis noir sur blanc tout ce qu’il voulait.
C’est impossible, parce que les mots sont par moments d’une inutilité, d’ une turpitude, d’ une maladresse d’expression énormes. Il y a une espèce de tranchée, d’abîme entre ce qu’on veut dire et ce qu’on parvient finalement à dire. Je sais que je n’arriverai jamais à formuler l’ensemble de ce que j’ai espéré exprimer. Dans Pilote de guerre, Saint-Exupéry raconte que lors d’une mission de reconnaissance il va prendre des photos qui n’ont aucune utilité. Pourtant il y va, il vole, il risque sa vie et il revient. C’est ainsi qu’on écrit: on va et on fait ce qu’on peut. Il faut lire dix poèmes d’Horace ou Les Fleurs du Mal pour se rendre compte qu’on n’est rien.
– C’est aussi le doute qui vous fait continuer à écrire ?
– Bien sûr, il vous harcèle. On tombe dans le piège, on se dit toujours que la prochaine fois sera plus proche de ce qu’on cherche.
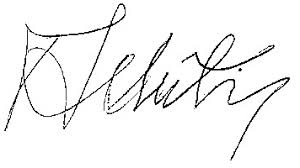
Propos recueillis par René Zahnd
(Le Passe-Muraille, No5, février 1993)