Du particulier à l’universel

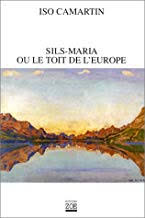
À propos de la défense des particularismes préludant à une plus large ouverture au monde. Entretien avec Iso Camartin,
par JLK
Il y a dix ans paraissait, à Zurich, la version allemande d’un essai d’IsoCamartin dont le titre et le contenu pouvaient paraître quelque peu académique au premier regard, et d’un intérêt local. Bientôt traduit en langue française et publié chez Zoé, ce plaidoyer pour les langues mineures ne tarda pas, cependant, à s’imposer comme une réflexion référentielle sur les thèmes, devenus brûlants, de la survie des communautés minoritaires, des relations entre cultures, des juste rapports entre particularisme et grands ensembles. Fondé sur l’examen approfondi de la situation rhétoromanche et plus précisément sur la destinée de la langue rhéto-romane, cet essai, consacré en 1986 par le Prix Européen de l’Essai, nous paraît demeurer l’introduction la plus intelligente et la plus équilibrée à une «petite littérature» dont les enjeux procèdent d’une grande cause.
S’il est né à Coire (en 1944) et a grandi à Disentis, où vivent encore sa mère et son frère (qui a fonction de maire), Iso Camartin incarne l’intellectuel cosmopolite en constant état de déplacement et de «décentrage» critique. Pratiquant admirablement le plurilinguisme après un cursus universitaire qui l’a conduit de Munich et Ratisbonne à Lyon et Harvard, l’actuel titulaire de la chaire de littérature et civilisation romanches à l’Ecole Polytechnique Fédérale et à l’Université de Zurich, demeure néanmoins le défenseur «rapproché» de sa culture d’origine sur le terrain, multipliant conférences et rencontres, entre autres activités en Suisse et à l’étranger. Un nouveau livre de lui paraîtra dans notre langue à l’automne, aux éditions Zoé, dans lequel, à propos de Sils Maria, il plaide une fois encore pour le particularisme dans une perspective englobante. En attendant, c’est sur les bords de la Limmat que nous l’avons rencontré.
– Comment articulez-vous le particulier et l’universel ?
– Ce qui m’intéresse le plus, et particulièrement en Suisse et aux Grisons, c’est de voir l’universalité cachée un peu partout. Dès lors, par exemple au XVIe ou au XVIIe siècle, qu’un pasteur de nos hautes vallées décide de mettre tel ou tel texte biblique à la portée de ses ouailles par le moyen d’une traduction, et qu’il s’emploie alors à trouver le mot juste, il me paraît que cet acte de transformation introduit quelque chose d’universel dans ce lieu, tout retiré qu’il soit. Par la traduction (pensez, aussi, aux auteurs grisons qui ont multiplié les versions de la Divine Comédie de Dante) les indigènes de nos vallées sont alors mis en contact avec une réalité beaucoup plus large, tandis que leur «humble» langue se trouvait fixée, enrichie, valorisée. Cette symbiose entre réalité vécue et richesse d’expression me semble à la base même de notre littérature. Le romanche est une langue sans aucune importance du point de vue géopolitique, et je crois qu’il faut avoir une motivation «pratique» pour s’y intéresser. Le défendre n’est pas alors un jeu gratuit ou une cause académique, mais c’est approcher une façon de comprendre les choses et les gens. Cela peut commencer avec la curiosité «triviale» d’un pêcheur alémanique qui va se frotter aux autochtones sur les rives d’une rivière des Grisons, cherche le sens de tel mot, puis, de fil en aiguille, va découvrir les nuances particulières propres à cette drôle de langue. Cette curiosité première a d’ailleurs été trop peu pratiquée dans notre pays, où le terreau culturel et linguistique si divers se prête à tant d’observations croisées.
– Qu’en est-il du bilinguisme ?
– D’aucuns y voient un destin cruel. Pour ma part, je le considère plutôt sous son aspect positif. La défense de la culture romanche ne peut se faire seulement à partir du thème de la lan-gue, mais doit participer d’une approche plus globale, plus «existentielle», enracinée dans l’expérience quotidienne et inscrite dans la durée. J’ai fait, il y a peu, une expérience frappante en Roumanie. Pour la première fois, je me trouvais dans le nord de la Moldavie où se trouvent les fameux monastères. Or le signe le plus visible, dans les villages de la région, est désormais la marque Coca-Cola. Il n’est plus un seul village où le sigle de cette firme ne s’étale pas. On n’y trouve pas de lait alors que c’est une région agricole, mais il y a des frigidaires pour les bouteilles de Coca-Cola ! Ce qui me préoccupe, alors, est de savoir dans quelle mesure cette nouvelle réalité peut être intégrée et relativisée, utilisée par les indigènes sans que ceux-ci ne se trahissent eux-mêmes. Aux Grisons, il y a ce que voit le touriste en passant, qui peut lui donner l’impression que le pays s’est «vendu» ou aliéné. Et puis il y a la réalité telle que la vivent les autochtones. Sous les apparences de la «colonisation» culturelle, vous sentez la communauté originelle réaffleurer. La façon de communiquer, la nourriture, les coutumes sont souvent préservés malgré l’érosion de la langue et du mode de vie.
– Comment marquez-vous la limite entre la valorisation d’un particularisme et les multiples avatars du chauvinisme qu’on voit se réaffirmer un peu partout ?
– Le nationalisme est sous-tendu par l’amour-propre public et le refus, voire même le mépris du voisin. La défense de la minorité est tout à fait différente, parce qu’elle est exempte, en principe tout au moins, de la peur et du mépris. Cela dit, certains groupes militants culturels veulent la séparation. J‘ai eu des discussions intéressantes avec mes amis galiciens, dont certains prônent l’indépendance d’avec l’Espagne. Même si le galicien est une langue intéressante, il y a un pas entre sa défense et la revendication de l’autonomie. Ce problème se retrouve évidemment exacerbé en ex-Yougoslavie. Or, le moment qu’il me semble important de repérer, du fait de son caractère dangereux, c’est celui du passage à la peur, donc à l’agressivité. On a vécu cela d’une manière aiguë lorsqu’a été discuté le principe de territorialité aux Grisons, où les imbrications sont telles qu’elles engagent forcément à la souplesse et à la tolérance.
» A cet égard, la notion de pu-reté me semble la chose la plus redoutable. Il y a certes encore, aux Grisons, des groupes qui voudraient pratiquer cette forme de fondamentalisme. Mais ils sont plutôt marginaux en dépit du bruit qu’ils font.
– Quelle fonction l’écrivain a-t-il à vos yeux par rapport à la communauté romanche ?
– Il y a une fonction intérieure de la littérature, et une fonction extérieure. La fonction extérieure se mesure à l’aune des traductions, laquelle procède de la qualité littéraire particulière de l’auteur, dont la «visibilité» dépasse le cercle local. Traditionnellement, c’est d’une manière interne que la littérature a nourri la cohésion de la culture romanche.
» Actuellement, je crois que le lieu le plus important, pour la littérature romanche, est l’école. C’est là le domaine privilégié de l’initiation, par des enseignants motivés et qui sensibilisent les jeunes du degré le plus élémentaire, avec des textes tout simples, jusqu’à des niveaux plus sophistiqués relevant de la re-cherche littéraire.
» Nombre d’écrivains romanches, souvent instituteurs ou pro-fesseurs eux-mêmes, sont parfaitement conscients de ce rôle prépondérant de leurs écrits dans l’aire scolaire, et y adaptent leur pratique.
– Quelle est la diffusion de la littérature romanche ?
– Nos auteurs ne peuvent certes vivre de leurs livres, mais un recueil de poèmes se vend en moyenne à 800 exemplaires, et un roman à environ 1500 exemplaires, ce qui excède je crois les tirages moyens des auteurs romands C’est en effet beaucoup pour un public potentiel de 50’000 personnes. Cet intérêt est évidemment lié à un certaine solidarité. Acheter un livre ne signifie pas toujours qu’on le lit.. Il y a environ quinze à vingt livres de littérature pure qui paraissent chaque année. Sur ceux-ci, disons qu’il en est un au moins qui sera traduit, ce qui me semble une proportion acceptable.
Propos recueillis par
Jean-Louis Kuffer
