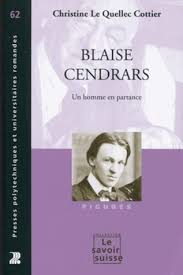Cendrars en mouvement perpétuel


Les rendez-vous passés et à venir du bourlingueur et de son « lecteur inconnu »,
par Christine Le Quellec
Lors du centenaire de la naissance de Blaise Cendrars, en 1987, la Bibliothèque Nationale consacra, par le biais du Centre d’Etudes Blaise Cendrars installé dans ses locaux, une exposition qui permit à bien des amateurs du bourlingueur de découvrir un «autre» Cendrars. Non que l’ altérité ait été méconnue jusqu’alors mais l’image de l’aventurier écrivain a longtemps dominé toute la lecture et l’ interprétation de cet œuvre riche, dense et bigarré.
En effet, Cendrars est surtout connu pour ses premiers grands poèmes qui le situent déjà aux antipodes géographiques de la planète : Les Pâques à New- York (1912) et La Prose du Transsibérien (1913). Avec ces poèmes inoubliables, Cendrars s’ inscrivit dans la modernité du début de siècle, bousculant les codes et innovant avec une écriture libre, jouant, manipulant, cassant des rythmes, martelant un style nouveau qui le plaça au sein des avant-Gardes, grâce entre autres au premier livre simultané – la Prose du Transsibérien – peint par Sonia Delaunay.

A cette phase de création succéda la guerre de 1914-18, axe indélébile dans la mémoire du poète car engagé volontaire – il y perdit le bras droit en 1915. Il rentra doublement mutilé, son moignon criant la douleur de son corps et sa main perdue le rendant incapable d’écrire.
C’est en 1917 que Cendrars reprit la plume, après une nuit d’illumination qu’il décrit dans un récit intitulé Partir, nuit qui marqua le passage à la gauche de son corps. Cette mutation fut vécue comme un événement majeur et tout l’œuvre postérieur est marqué par cette expérience intérieure que l’auteur- narrateur va progressivement mettre en scène avec des essais cinématographiques puis décrire, inscrire et coder dans ses textes.

L ’ alchimie de 1917 va permettre à Cendrars de se reconstruire une vie dans les textes, mêlant le réel et le fictif, utilisant les doubles et les symboles pour exister à nouveau en gommant la coupure de la guerre: les jeux de mémoire et l’écriture rhapsodique vont tenter d’ annuler les structures linéaires et ainsi reconstruire une unité, une identité neuve et intacte grâce à l’ écriture. En cela, les textes de Mémoires1 «qui ne sont pas des mémoires», écrits entre 1943 et 1949 après un long silence à Aix-en-Provence pendant la seconde guerre, sont la clef de voûte de l’ œuvre, sorte de malle sans fond du voyageur mais surtout itinéraire intérieur, univers du signe qui a pour but de rendre Cendrars maître du temps et de sa vie:
«(…) je tape, je tape (…), intercalant dans la vision directe celle, réfléchie, qui ne peut se déchiffrer qu’à l’envers, comme dans un miroir, maître de ma vie, dominant le temps, ayant réussi à le désarticuler, le disloquer et à glisser la relativité comme un substratum dans mes phrases pour en faire le ressort de mon écriture, ce qu’on a pris pour désordre, confusion, facilité, manque de composition (…)» 2
Etant oeuvre de gaucher depuis 1917, les textes devraient peut-être être lus à l’ envers, de droite à gauche, à l’image de la vie du narrateur-auteur, en commençant avec Le Lotissement du ciel, publié en 1949 (et dont la figure emblématique est Saint Joseph de Copertino, mystique qui avait la propriété de léviter en volant à l’ envers!) avant de plonger dans l’univers de Suter, Dan Y ack, Moravagine et de la Petite Jehanne de France… De cette façon, le lecteur surpris naviguerait parmi les sommets de la prose rhapsodique avec La Tour Eiffel sidérale et partirait en quête d’un parcours existentiel en découvrant les doubles emblématiques des récits. Cette lecture mouvante, ce croisement des sens et des signes me semble coïncider avec le principe de création circulaire du narrateur- auteur: le Lecteur Inconnu capterait ainsi le mouvement perpétuel tant cherché par Cendrars…
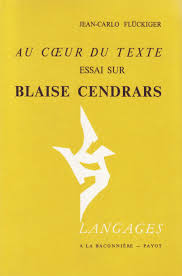
L’interprétation des écrits cendrarsiens fut mis en lumière lors de l’ exposition du Centenaire mais la critique avertie avait renouvelé ses interprétations depuis déjà plus de dix ans. En 1977, Jean-Carlo Flückiger, actuel directeur de Centre d’Etudes Blaise Cendrars, publiait Au cœur du texte cendrarsien et exhumait le Texte de sa malle d’aventurier. De même, Claude Leroy, de l’Université de Paris- Nanterre, démontra l’unité de l’œuvre de Cendrars grâce à de multiples publications et spécialement avec sa thèse d’Etat intitulée La main coupée de Cendrars, présentée en 1987. Ces deux exemples ne font que situer une recherche en pleine activité, soutenue par deux associations internationales et des colloques annuels touchant des chercheurs de tous les horizons qui renouvellent une figure et des textes un peu hâtivement classés au rayon «aventure» des bibliothèques!
Cendrars a constamment joué avec son Lecteur, profitant de ses propres pièges pour se conforter derrière l’image de l’aventurier-baroudeur, mais tout en lançant des piques à celui qui, par une lecture plus attentive, pouvait participer à l’unité recréée grâce à l’écriture. Les Notes au Lecteur Inconnu, qui terminent les chapitres de certains textes des Mémoires, manifestent ce double jeu de façon souvent ironique:
«(…) je déclare au Lecteur Inconnu à l’intention de qui j’ai rédigé ces notes sans prétention pour le distraire, que je n’y dis pas tout. On a pu le remarquer. Je ne dis que ce que je veux bien dire. Prière de ne pas y chercher autre chose et surtout pas ce que je ne dis pas. Inutile d’écrire à mon éditeur sous prétexte d’ éclaircissements supplémentaires. Je ne répondrai pas.»
Eh bien soit! Lecteur inconnu, salut !
Ch. L. Q
1 Sous l’appellation Mémoires, la critique parle de L’ Homme Foudroyé (1945), de La Main Coupée (1946), de Bourlinguer (1948)et Le Lotissement du Ciel (1949).
2 Bourlinguer, Folio, 1987, pp. 228-9.
3 L’Association Blaise Cendrars/BC
International Society, qui publie le bulletin Feuille de Routes dont le premier numéro date de 1979 et Le Centre d’Etudes Blaise Cendrars qui publie la revue Continent Cendrars dont le numéro 1 date de 1986.
4 L’ Homme foudroyé, Folio, 1987, p.190.