Concerto baroque
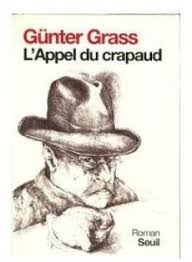
À propos de L’Appel du crapaud de Günter Grass,
par François Conod
J’habitais Bâle, je devais avoir seize ans, le monde germanique ne parlait que du Tambour. Un nain s’abritait sous les jupes de sa grand-mère glaneuse de patates, il savait chanter-kaputt des vitrines et des bocaux d’embryons, on apprenait l’existence d’un peuple nommé Kachoubes. Surtout, avec les copains du Gymnase, on fantasmait sur tel ventre féminin, dans son nombril on versait de la poudre de limonade et on léchait jusqu’à ce que mousse s’ensuive, rose et fraîche. J’avoue: davantage qu’à Marilyn, Stendhal ou Sylvie Vartan, je dois mes premiers émois authentiquement érotiques à Günter Grass.

Trente ans plus tard, nous revoici à Dantzig. Sous l’appellation de Gdansk, la ville s’est refait un nom grâce à Walesa et Solidarnosc. Nous sommes le 2 novembre 1989, jour des morts. Un veuf et une veuve se rencontrent «par hasard» — ose prétendre le narrateur — pour acheter des fleurs au marché. Comme ils ne trouvent pas de bouquet à leur goût, ils décident d’en confectionner un ensemble avec les plus beaux asters des étals. Alexandra exerce la profession de doreuse à la feuille, Alexander enseigne l’histoire de l’art. L’idylle automnale peut commencer. Idylle ? Nos héros sont tous deux déracinés. Elle est d’origine lituanienne et vit en Pologne; lui a été déporté vers la Ruhr à la fin de la guerre. Lors de leur visite au cimetière, une idée délicieusement baroque jaillit dans la cervelle des sexagénaires: «Et si —puisqu’on ne peut pas refaire l’Histoire, puisque la Pologne occupe dorénavant la rive droite de l’Oder —, et si nous donnions la possibilité à tous les exilés, non de revenir au pays, mais au moins d’être enterrés dans le sol natal ?» Sitôt dit sitôt fait: la «Société germano-polonaise des cimetières» est inscrite au registre du commerce.
Alexander et Alexandra ne savaient pas qu’ils mettaient les doigts dans un engrenage. La «germano-polonaise» s’avère florissante, elle devient un joint-venture avec conseil d’administration, il faut trouver de nouveaux terrains, négocier avec les autorités, les banques. Bientôt, on rapatrie les cadavres, de vieux Allemands nostalgiques voudront s’installer près de l’endroit où ils seront ensevelis. Le gouvernement polonais laisse faire. On construit des EMS, des hôtels pour les familles en deuil, puis des bungalows: les futurs morts ont bien le droit de passer quelques jours en compagnie de leurs enfants et petits-enfants. Bref, d’urnes funéraires en ossements, les Allemands reconquièrent la Poméranie, la Prusse orientale et la Silésie, sans Wehrmacht et sans Stukas. Dégoûté par cette victoire du deutschmark sur le zloty, nos deux amoureux s’en vont voir Naples… et mourir.
Voici tout au moins ce que le narrateur, ancien condisciple d’Alexander, a réussi à reconstituer d’après un volumineux paquet d’archives, cassettes, lettres, journaux intimes etc. remis par son camarade avant son décès. Mais il se peut qu’il se trompe, notamment dans la chronologie ou dans sa vision des choses: Alexandra n’est-elle pas «doreuse de temps», puisqu’elle restaure les horloges des églises, ceci grâce à «l’or de martelage propriété du peuple», seule richesse du pays? Quant à Alexander, il s’intéresse aux sacs de plastique, sachets, filets à provision, soit tout ce qui peut contenir des biens de consommation.
À l’évidence, ce roman est une fable, d’autant plus qu’un troisième larron paraît tirer son épingle du jeu avec davantage de succès que nos deux protagonistes: il s’appelle Chatterjee, il vient du Bengale et rêve d’introduire le rickshaw, le cyclo-pousse asiatique, dans les villes d’Europe: à l’est, en raison des pénuries; à l’ouest, à cause des engorgements. Le créneau paraît juteux, mais il faudra engager des pousseurs au teint basané. On pressent la suite: nouveau déferle-ment d’étrangers, nouvelle invasion. Demain, on plantera du soja sur les bords de la Vistule et la noire Kâli, déesse-mère de Calcutta, trônera aux côtés de la Vierge Noire de Czestochôwa.
Baroque, oui. Cette politique-fiction s’orne de nombreux clins d’oeil: la danse macabre devient danse du fric sur le dos des trépassés, la nature croupissante évoque la Verganglichkeit des poètes de Silésie, le mur de Berlin s’écroule et tout recommence: on clôture les ossuaires, ces cimetières de concentration.
Baroque, certes, et quelque peu surchargé à mon goût. Ce foisonnement n’est pas d’un accès facile. Est-ce dû à l’effet de distanciation d’une traduction pourtant savante et scrupuleuse ? Faut-il l’imputer à Grass, à ce mélange de préciosité et d’excès de réalisme, comme par exemple le parler de la veuve qui estropie systématiquement la langue ? («Allemands ont toujours faim même si sont rem-plis déjà.»)
Restent l’humour et la dérision, quelques réflexions à méditer de part et d’autre de l’ex-rideau de fer («On ne peut pas d’une part vouloir le capitalisme et d’autre part jouer les vierges effarouchées»); et bien entendu les crapauds, que notre veuf avale avec autant d’aisance que nous les couleuvres…
F.C.
Günter Grass, L’appel du crapaud, [Unkenrufe], traduit de l’allemand par Jean Amsler, Editions du Seuil, Paris, 1992, 252 pages.

(Le Passe-Muraille, No 5, février 1993)
