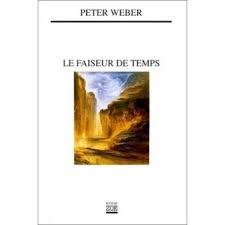Au commencement…
À propos de Peter Weber, auteur du Faiseur de temps, avec un entretien,
par Patricia Zurcher
Au commencement était le verbe, la langue, un fleuve si impétueux qu’il se moquait bien de celui qui tentait parfois de le renvoyer dans son lit et envahissait la matière du récit jusqu’à la noyer…
C’est que Peter Weber n’est pas dompteur, il est musicien. Il freejase, plus exactement, avec toute la fougue et la sensualité que cela exige. Le thème de ses trois cents pages d’improvisation ? Son Toggenbourg natal, les eaux capricieuses de la Thur, l’histoire familiale… et la nuit du vingtième anniversaire d’AAA, August Abraham Abderhalden, né un 1er avril.
Au commencement était la lettre A, était le premier jour d’un mois qui n’en fait qu’à sa tête. Le récit autobiographique qu’AAA entreprend de rédiger en cette nuit magique ne pouvait donc être qu’excessif, chaotique comme l’origine du monde.
Chauffée jusqu’à devenir liquide, amenée à ébullition par le feu de l’imagination, la langue de Weber se fait paysages, personnages, histoires et Histoire, nous inondant d’images, d’associations, de cascades de notes et de rimes.
Pourtant, si ce livre appartient «à l’espèce dite désespoir des traducteurs», comme on l’annonce sur sa quatrième de couverture, ce n’est sans doute pas parce que l’auteur se plaît à jouer sur tous les registres de son orgue – Colette Kowalski, sa traductrice, maîtrise elle aussi son instrument – ni parce qu’il marie avec délice les mots rares, dialectaux ou inventés… Non, le piège pervers que tend ce livre à tout traducteur assez fou pour s’en approcher, c’est qu’il joue sur la malléabilité de la langue allemande, sur cette souplesse incroyable qui permet à l’auteur de la tordre et de la couler dans tous les moules. Le texte de Weber est un révélateur cruel de la rigidité syntaxique du français, une rigidité difficilement contournable si l’on ne veut sombrer dans l’artificiel et l’illisible.
Colette Kowalski le sait et nous offre, avec son Faiseur de temps, une variation extrêmement fine, harmonieuse et intelligente du thème original.
P. Z.
Peter Weber, Le Faiseur de temps, roman, traduction française de Colette Kowalski, paru aux Editions Zoé, 1998.
Entretien avec Peter Weber.
– Peter Weber, voilà des années que nous n’avons plus rien lu de vous; qu’avez-vous fait durant tout ce temps ?
– Après ma tournée de lecture du Wettermacher, je me suis lancé dans un tout autre genre d’activité, des lectures expérimentales en compagnie de musiciens. Il s’agissait pour moi de chercher les limites de la langue et de la musique, de trouver le point où l’un bascule dans l’autre. J’ai pris un bain de musique, puis je me suis remis à ma table de travail. J’ai vécu une année à Londres, une année laborieuse. Et j’ai participé aussi à toutes sortes de pro-jets culturels; le travail sur le terrain m’a fait du bien.
Je travaille en fait à deux livres différents, le second étant une expérience que j’ai prévu d’étendre sur plusieurs années. J’ai lu toutes sortes d’ouvrages spécialisés et entamé une véritable collection de documents. Mes amis se moquent de moi, je ne peux plus me rendre dans un endroit sans empocher tous les prospectus que j’y trouve. Qui sait, tout peut servir…
– Que retenez-vous de toute l’agitation médiatique qui a entouré la parution de votre premier livre ?
– Qu’il faut savoir quel est le rythme qui nous est propre et qui nous permet de ne pas nous perdre. Et ne pas en démordre. Et puis, que la confiance paie mal parfois… Mais la pression que les médias exercent sur moi n’est pas inintéressante: je tente de faire le paratonnerre, de dévier cette énergie sur la langue dont je me sers, afin qu’elle la mette sous tension, plutôt que de la laisser s’abattre sur mon estomac…
– Vous êtes aussi un musicien de free-jazz très actif et l’art de l’improvisation se retrouve dans le Wettermacher. Quel rôle la musique joue-t-elle dans votre travail d’écrivain ?
– J’écris sur deux ou trois vieilles machines mécaniques et j’ai besoin de ce contact physique avec les touches pour des questions de rythme. Quand mes doigts courent sur le clavier, c’est que la musique est bonne. L’ordinateur ne me permet pas d’être musicien …
– Pouvez-vous déjà nous dire deux ou trois choses de vos prochains livres ?
– Non, si ce n’est que je me suis cloîtré cet hiver dans une maison du fin fond du Toggenbourg, perdu dans la neige, pour pouvoir avancer dans mon roman sans me dissiper. Je travaille actuellement sur la masse de ce roman, je le peaufine, j’enlève ici, j’ajoute là, jusqu’à ce qu’il sonne juste. Le second projet, mes Bahnhofprosen, un ensemble de trente-deux textes brefs, est comme suspendu au-dessus de ce roman. Ici ou là, j’y accroche un nouveau texte, quand il se présente à moi.
– Dans le Wettermacher, l’art de raconter semble vous importer davantage que ce que vous y racontez; est-ce vrai et cela le reste-t-il pour vos nouveaux tex-tes ?
– Absolument, et pourtant, il y a quand même des contenus que je souhaite véhiculer, une substance à qui je souhaite faire voir le jour à l’aide de la langue.
– Dans le Wettermacher, on peut lire «Je dérive pour en venir aux faits». Qu’en est-il à présent ?
– J’essaie de mieux «tenir» la langue, d’être plus concis et précis, mais je n’y parviens pas toujours, la langue est si impétueuse lorsqu’elle veut sortir que je pei-ne à la contenir !
– Pour votre premier roman, vous avez passé des années à fouiner dans les archives et vous vous servez du passé comme d’un ouvrage de référence pour interpréter le présent…
– Et je continue à le faire… J’écris avec le regard tourné à la fois vers l’arrière et vers l’avant, l’avant étant chez moi l’invention, l’imaginaire. Mon nouveau roman, par exemple, se déroule dans une contrée totalement imaginaire…
– Dans le Wettermacher, la gare de Zurich occupait déjà un rang particulier et dans vos textes à venir, les Bahnhofprosen, les gares semblent prendre encore plus d’importance. En quoi ce lieu vous inspire-t-il ?
– En ce moment, j’ai l’impression que toutes les gares sont en chantier; on les vide, on les creuse, on en fait des blocs compacts, ça me travaille. Et puis, il y a les horaires, une pure folie, ces trains qui arrivent, qui partent et qui se croisent à la seconde près ! La gare, en fait, est une gigantesque machine à rythme… et le lieu central par excellence.