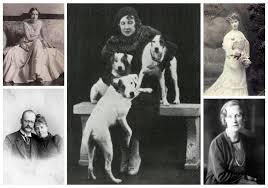Ah ! voyager seule, se libérer de tout !
Un bout de chemin en compagnie d’Elisabeth von Arnim,
par Rose-Marie Pagnard
Il n’est jamais trop tard pour découvrir un écrivain que tous vos amis, paraît-il, connaissent déjà depuis qu’ils savent lire. Et il n’est pas interdit d’imaginer, ensuite, que le hasard qui vient de mettre entre vos mains le livre d’un auteur célèbre que vous ignoriez jusqu’alors, a eu en ce faisant l’intention délicate de vous rappeler que la littérature digne de ce nom peut fort bien prendre son envol à partir d’un petit sujet de rien: en l’occurrence, une excursion estivale sur l’île de Rügen, vécue et racontée par une femme de la bonne société allemande du début du siècle.
Elisabeth von Arnim – c’est d’elle qu’il s’agit – est née en 1866 en Australie, comme sa cousine la nouvelliste Katherine Mansfield. Mariée à un comte von Arnim, lui-même cousin de l’auteur du Coq de Bruyère Achim von Arnim, elle vécut en Europe puis aux Etats-Unis où elle mourut en 1942. Son premier livre, Elisabeth en son jardin allemand, fut un événement littéraire de la fin du siècle. Plus de vingt romans et récits suivirent, dont ce délectable guide des paysages et de la nature humaine intitulé Elisabeth à Rügen.
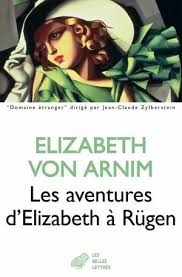
Le récit commence par la description de cette délicieuse démangeaison qu’éprouvent périodiquement les êtres poétiques et aventureux, individualistes et inspirés: la démangeaison du voyage en toute liberté, à pied et seul. C’est l’île de Rügen, en mer Baltique, qu’Elisabeth rêve de parcourir ainsi. Mais, dit-elle, «le monstre sinistre qui a pour nom Convention, dont les griffes d’acier pèseront perpétuellement sur mes épaules et m’interdira définitivement toute tentative de salut innocent, mit un terme à mon projet». Elle se résigne donc à voyager en victoria, avec son cocher et sa dame de compagnie, la taciturne, vieille et archisérieuse Gertrude. L’île, malgré cette compagnie imposée par les convenances, sera solitaire, pense-t-elle. Hélas pour elle, heureusement pour nous, Rügen semble avoir attiré, en cet été parfait, non seulement une foule de touristes anonymes, mais quelques personnes qu’il lui sera impossible – une île étant ce qu’elle est – de ne pas fréquenter.
Voici, haute en couleur, caricature à pince-nez, Madame Harvey-Browne, femme d’un évêque anglais, accompagnée de son fils Ambrose, «un jeune homme tout à fait charmant», capable de philosopher sur les beautés du paysage autant que sur les vertus allemandes. Et, surgie littéralement des vagues, voici Charlotte, une cousine d’Elisabeth, bientôt suivie par son époux Monsieur le Professeur, génie si distrait qu’il est capable, entre deux trains, d’oublier qu’il est marié (il fait parfois penser au «Professeur» du roman de Lewis Carroll Sylvie et Bruno). Ces personnages imposent à Elisabeth, au cours d’un chassé-croisé rocambolesque de rencontres, leurs problèmes personnels, leurs humeurs et leurs conversations. Histoires oiseuses de confort et de bonnes manières, théories pitoyables de Charlotte, féministe malheureuse: oh ! ces dialogues entre les cousines ! Charlotte ne va-t-elle pas jusqu’à accuser Elisabeth d’avoir une vie aussi négative et privée de passion que celle d’une huître ? Elisabeth réfléchit: «Si j’étais une huître – curieux comme ce mot me déconcertait ! – du moins étais-je une huître heureuse, ce qui vaut mieux que d’être une huître misérable ou de ne pas être une huître du tout.»
La mentalité la plus mesquine d’une époque, les excès malheureux de quelques révoltés tels que Charlotte, mais aussi les mœurs des habitants de Rügen, sont ainsi relatés et commentés par la très spirituelle et intelligente Elisabeth: et quel humour, quel sens du détail révélateur, quelle perspicacité dans le regard jeté sur autrui mais aussi sur elle-même ! Des scènes hilarantes – celle où voiture, chevaux et cocher disparaissent à l’horizon d’un paysage désert en oubliant sur la route Elisabeth et Gertrude agrippée à son tricot et ne comprenant pas que sa maîtresse s’étouffe de rire; ou celle de la femme de l’évêque visitant, babouches aux pieds, une tour médiévale; etc. – alternent avec les descriptions des lieux et les rêveries: «(…) le domestique entra, me demandant si je désirais une lampe. Une lampe ! Comme si on voulait toujours voir clair autour de soi. (…) J’ai une aptitude particulière à ne rien faire et à m’en trouver bien.» Ce qui ne l’empêche pas d’être attentive aux aspects pratiques du voyage: «Une longue expérience des oreillers allemands dans les chambres de campagne m’oblige à conseiller aux candidats voyageurs d’emporter le leur. Les oreille indigènes (…) sont horriblement mous et ont, de surcroît, l’inconvénient – commun à tous les oreillers publics – d’être hantés par les cauchemars de vos prédécesseurs.» On pense, pour l’ironie, l’humour délicieux et l’esprit, au héros lointain du Voyage sentimental de Laurence Sterne. Mais la comparaison s’arrête là, tous oreillers confondus.
R.-M. P.