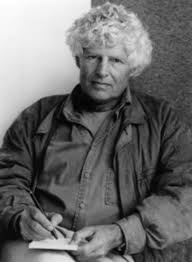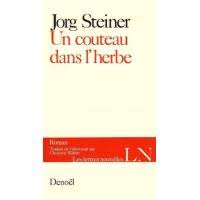La voix du silence
Ce qu’écrivait Jörg Steiner (1930-2013) dans La Suisse et son passé, en 1998…
Je suis né à Bienne en octobre 1930, un Suisse en Suisse. Nous avions une radio (TSF) à la maison; je ne comprenais pas de quoi on parlait, je comprenais seulement comment on en parlait, j’entendais les voix: pour moi, la guerre avait commencé avant même qu’elle n’éclate.
Mes parents avaient fait des provisions de guerre: stocks de sucre emballés dans du papier indigo, lait condensé en boîte, œufs dans des pots en grès, beurre fondu dans des verres à eau. Les fenêtres étaient cachées par des rideaux doublés d’un tissu noir, la cave abritait des lits de secours qui n’ont jamais servi, mon père œuvrait à la gare, où il offrait son assistance, et vers la fin de la guerre, ma mère fut conduite au sanatorium Sanitas de Davos avec une tuberculose déclarée.
Les discussions actuelles dans ce domaine ne m’apprennent rien de nouveau. Elles existaient déjà à l’époque, bien que plus secrètes et inquiétantes, et sont indissociables de ma peur, de la peur de l’enfant qui n’est pas autonome, de l’enfant dépendant à tous les égards.
On ne parlait pas du destin des juifs. Le silence qui l’entourait était si criant que le jeune adulte se mit à ressentir physiquement cette absence de mots et que le mutisme lui-même devint une voix à ses oreilles. Lorsque j’ai montré à ma tante, une chrétienne convaincue, la photo qu’un vacancier américain en uniforme m’avait offerte en juillet 1945, elle a plaqué ses mains sur ses yeux et m’a dit, en larmes: «Jette ça ! Jette-la !»
Au dos de la photo étaient inscrits le nom du soldat et le mot Auschwitz. J’en ai gardé une copie jusqu’à ce jour.
Le processus du souvenir est douloureux, mais c’est de lui que naît la littérature, et je m’excuse si tout ce que j’ai pu écrire en tant que narrateur reste en deçà de ma capacité de perception. Pourtant, jamais je n’admettrai que la valeur de la littérature soit mesurée à l’aune de son utilité politique.
L’ex-président italien, Francisco Cossiga, que j’ai rencontré par hasard chez des amis à Rome, m’a dit par pure gentillesse qu’avant de visiter un pays, il commençait toujours par lire les écrivains de ce pays, parce que ceux-ci lui apprenaient davantage et d’autres choses que les représentants des autorités politiques. Il a évoqué Max Frisch et je me suis aperçu qu’il ne se contentait pas de posséder ses livres, mais qu’il les avait lus aussi, bien que sa lecture fût différente de la mienne. Il admirait l’ironie de Frisch. Le désespoir qui pouvait s’emparer de Max Frisch lorsqu’une pensée lui traversait l’esprit – éclaircissement aveuglant, impérieux, impossible à effacer désormais et se cristallisant dans une image – ce désespoir, quand je lui en ai parlé, l’a mis si mal à l’aise qu’il a immédiatement changé de sujet.
Non, la littérature n’est ni un mode d’emploi pour agir dans la vie, ni un substitut de la vie. Et je ne partage pas non plus le point de vue qui veut qu’il y ait une Suisse de la politique, de l’économie et de l’armée, et à côté de cela, une Suisse «meilleure» de la culture. Elle n’est pas meilleure, elle n’est pas moins bonne, elle part simplement d’autres questions. Elle encourage à se forger une opinion et à résister, elle est une échelle graduée infinie sur la-quelle on mesure la sensibilité, un champ d’expérimentation conçu pour le long terme, un mouvement à l’intérieur d’un ensemble de for-mes vitales de possibles. Elle reconnaît aussi l’échec, les crises et la honte, et surtout, surtout, elle est une voix sans pouvoir.
Elle est donc en contradiction avec le mythe de la Suisse fondé sur le pouvoir. Ce mythe ne peut être compris – dans ce qu’il a de bon et de mauvais – que si l’on se replonge dans l’histoire de la société agricole préindustrielle, avec le noyau que formait la famille paysanne sédentaire, autarcique, travaillant pour son propre compte et sur ses propres terres.
Un homme, Christoph Blocher, industriel de son métier, s’est autoproclamé, en tant que politicien, leur porte-parole: la voix de la majorité silencieuse. Mais comment voulez-vous qu’il réponde aux questions que posent l’attitude suisse durant la Seconde Guerre mondiale, la confusion politique, la sensibilité au chantage, la trop grande capacité d’adaptation des opportunistes ?
Comment voulez-vous qu’il justifie le sang des plus de trente mille juifs que les représentants de notre pays ont renvoyés aux frontières et vers une mort certaine durant la guerre, alors qu’il nie toute coresponsabilité ?
Afin de préserver son propre pouvoir, il a occupé le mythe de la Suisse en le présentant comme son domaine hautement personnel.
Avec une conscience de sa mission qu’aucun doute ne vient troubler, il calomnie et déshonore tous ceux qui ne pensent pas comme lui – écrivains, intellectuels, historiens, cinéastes – les déclare ses ennemis et qualifie toute reconnaissance de culpabilité de lâcheté, toute honte de faiblesse, et la création d’un fonds de solidarité de trahison.
Il n’a rien à craindre de ses ennemis; ce sont ses partisans et ses sympathisants qu’il lui faut craindre. Il leur a promis rien moins que la reconstitution de l’innocence historique. Et cette promesse, il ne pourra pas la tenir.
Notre pays a perdu l’auréole de l’infaillibilité et gagné du même coup la liberté de ne plus devoir être un cas à part. La mémoire sait que rien ne commence à son début et que rien ne se termine à sa fin. Cette mémoire, je ne suis pas seul à la posséder, je la partage avec d’autres, elle parle avec des voix multiples.
J. S.
(Traduction: Patricia Zuercher)