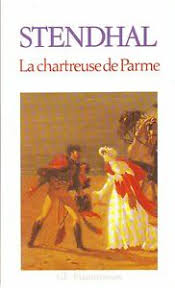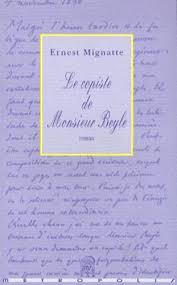Dans la foulée de Fabrice
À propos du Copiste de Monsieur Beyle d’Ernest Mignatte,
par Livia Mattei
Je connais des auteurs qui seront jaloux du bon tour que nous joue Ernest Mignatte, et ce sera le meilleur hommage qu’il lui rendront pour l’idée et la façon du Copiste de Monsieur Beyle, très excitant petit roman qui nous introduit chez Stendhal par la porte du personnel.
Si vous êtes de ceux qu’éberlue la rapidité de la composition de La Chartreuse de Parme (cinquante-trois jours, dois-je le rappeler ?), et qu’un zeste de soupçon reste même en vous, cette lecture sera de nature à vous contenter: non, Beyle n’était pas un surhomme, Beyle avait une béquille, Beyle avait un jeune copiste à sa botte comme nous l’apprend (enfin !) le journal de ce garçon lettré, sortant avec la fille de Charles Nodier et fait au feu de la composition dans les ateliers du père Dumas, dont un plaisant aperçu est donné au passage.
Ernest Mignatte (on me dit que c’est le pseudonyme d’un professeur de littérature française à l’université de Grenoble) est un stendhalien féru et retors, voire facétieux. Le spécialiste démêlera plus ou moins facilement ce qui, dans le journal du copiste, relève des faits avérés ou de l’invention, du secret colporté sous le manteau ou de la licence (c’est le mot) poétique. Henri Beyle s’est-il effectivement déguisé en phallus «à tête rouge», en compagnie de son pair Mérimée, pour apparaître en certain bal costumé dans tel lupanar parisien où s’ébattaient aussi Musset et Delacroix ?
Ce qui est sûr, c’est que ce bon monsieur Mignatte, loin de s’en tenir à ces frasques de «Grands Erecteurs animalesques», parvient à composer un beau portrait oblique de Beyle en ne cessant de mêler conjectures et probabilités, faits et fiction de la vie même de l’écrivain, épisodes de celle-ci et réfractions romanesques. «Personne n’a su exactement quelles gens il voyait, quels livres il avait écrits, quels voyages il avait faits», écrivait Mérimée à propos d’H. B.
Au regard proche du copiste, que les menées mystérieuses du sieur intriguent d’autant plus qu’il soupçonne son employeur de le tromper avec la jeune dame qu’il lui a imprudemment présentée, l’image du «vrai Beyle» se dédouble encore par le truchement du roman qu’il est chargé de recopier, où il imagine à tout moment qu’il le nargue ou le berne. A cela s’ajoute tout ce que l’auteur brode autour de la composition même de La Chartreuse, que le lecteur voit progresser tout en assistant aux affres d’un copiste à la fois admiratif et vampirisé.
Tout cela est à la fois divertissant et instructif. Comme il s’agit d’un roman déclaré, le lecteur ne sera pas obligé de croire que La Chartreuse s’est écrite exactement comme ça, mais pourquoi pas ? Si nous admettons évidemment que Beyle a puisé dans la vie qu’il vivait lui-même pour en nourrir son roman, pourquoi ne pas admettre qu’il ait chargé son copiste de l’aider à ses descriptions ou de se fendre de tel ou tel développement ?
Qui plus est, et qui s’en étonnerait ? ce qui pourrait n’être qu’un jeu de lettreux devient ici création de style, comme par osmose. On ne dira pas cependant que le copiste pastiche Beyle, puisque nous apprenons finalement que celui-ci lui a pris beaucoup. Mais qui croire dès qu’il en va de tels travaux à plusieurs mains. Et d’ailleurs tout écrivain n’est-il pas lui-même en concurrence avec son double ? Telles sont, entre autres, les questions qu’Ernest Mignatte pose sans peser au fil des pages du Copiste de Monsieur Beyle, dont la mise en abyme par-ticipe naturellement de la fiction.
L. M.