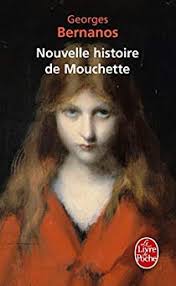Un nid de flammes
À propos de Bernanos et de ses créatures du feu de Dieu,
par Antonin Moeri
Parlant de Bernanos, Henri Debluë se métamorphosait. Ses gestes prenaient une ampleur que je trouvais majestueuse. Sa voix d’alto se faisait violoncelle. Son beau regard d’oiseau des cimes fixait inexorablement les ombres, les contours et les vertiges. Avec une joie que ses narines exprimaient en frémissant, il semblait se mettre à l’écoute d’une intimité muette. Son petit ciel bleu se remplissait d’anges.
Debluë avait aimé Dostoïevski. Il fut bouleversé par les romans de Faulkner. Mais un jour, ayant découvert L’Imposture ou Un Crime (je ne sais plus exactement lequel), il déclara avec une franche conviction et une ferveur de cénobite: Bernanos est le plus grand de tous. Il resta toute sa vie fidèle à ce choix. Il fit de cet auteur le sujet d’une thèse qu’on devrait lire dans les écoles: Le Défi du Rêve.
C’est que Bernanos s’intéresse au mystère du Mal, aux profondeurs psychiques et démoniaques de l’être, à l’immanquable corruption de toute volonté soi-disant bonne. Il excelle à conter «dans le détail le processus de cette surrection brutale des puissances subconscientes». Il met en scène des personnages envahis par ce que Debluë nomme «le mauvais rêve», cette pulsion inexplicable qui, sans la médiation du sentiment fraternel, se retourne contre elle-même et entraîne son propre anéantissement.

Monsieur Arsène est un monstre de force, entouré de néant mais traversé par une tension insoutenable. L’épilepsie et l’alcool agrandissent son imagination en l’aveuglant. Une soif insatiable et une fureur têtue en font le jouet de puissances qui le dépassent et, surtout, qu’il ne maîtrise pas. Ce braconnier ne peut raconter ses exploits que dans la fièvre. Il s’enracine dans une zone trouble, dangereuse, ténébreuse: un fond d’irrationnel que Nietzsche sut déceler derrière les vernis de civilisation, que Freud s’efforça d’expliquer en adoptant une vile rhétorique prétendument scientifique.
Or Bernanos ne diabolise pas le «violeur» de Mouchette, la sauvageonne, la chatte échaudée qui conduit la narration. Il nous fait croire qu’Arsène a tué un garde forestier, qu’il a forcé l’adolescente: ces actes relèvent du possible, ils n’ont pas à subir, ici, la plate description des «réalistes épuisés». Car les histoires vraisemblables ne méritent plus d’être racontées.
Seule une approche pathétique du monde légitime désormais l’écriture romanesque. Avec Bernanos, le lecteur passe de plain-pied dans l’hallucination littéraire.
La fiction s’élabore dans une tête en feu, au milieu d’un nid de flammes. Dans un incomparable polar raté, intitulé Un Crime, un petit juge d’instruction tente d’élucider les meurtres. C’est une enquêteur intuitif qui n’est pas sans rappeler le désarmant Bembow de Sanctuaire; tous deux dépassent «la psychologie analytique en faveur dans les tribunaux». Le petit juriste a une cervelle qui colle au crâne comme un caramel au palais. Pris d’étourdissements, il titube, lutte contre la démence, ne sait plus s’il converse avec des êtres de chair ou avec des fantômes. Il promène ses mains livides sur son front ruisselant. Ses entrailles le brûlent. Il étouffe mais ne peut crier. Le cœur menace de rompre.
Le personnage bernanosien a besoin, pour construire son rêve de vérité, d’un dérèglement de tous les sens qui confine à une état pathologique ou à une ivresse dionysiaque. Il ne fuit pas le réel mais appelle l’inspiration pour mieux investir ce réel qui échappe ordinairement à toute préhension et à toute ratiocination prudhommesques. Ce délire quasi volontaire permet de reconstruire un édifice avec des mots beaux comme des menhirs.
L’auteur des Grands Cimetières sous la lune ne croyait pas au bonheur, ce mensonge qui rend les gens si hargneux, si ragoteurs, si veules et si venimeux. S’il fulminait contre le matérialisme borné de notre civilisation sans odeur (sinon celle des vaporisateurs, de la gazoline, du désinfectant, de la poudre et du crédit), c’est que l’obscène idéal de la bourgeoisie optimiste le soulevait d’indignation, cette aurea mediocritas érigée en règle universelle qui, en rabaissant l’Homme à la matière (laquelle ne se laisse pas dompter comme un caniche), ne peut flatter que ses instincts les plus bas, les plus sordides et les plus grossiers.
C’est contre cette boue insinuante, maléfique et tenace que se révolte pathétiquement le jeune curé d’Ambricourt. Cette fange de tous les désastres porte un nom: l’ennui. Or ceux qui dénoncent cet ennui remuent les eaux croupissantes et «offensent les imbéciles». Ils créent les conditions de leur malheur: marginalisation, calomnies et élimination. C’est précisément ce processus d’exclusion que décrit dans son journal le prêtre sans nom. Car on ne pardonne pas à ces originaux qui démasquent la haine sournoise, la molle saloperie et le contentement de soi.
Ce qu’il y a de prenant, d’envoûtant et de bouleversant dans les romans de Bernanos, c’est que ses personnages vont au bout de leur nuit, au bout de leur idée fixe. Ils ne composent pas avec leur conscience. Ils ne ménagent pas le chou et la chèvre. Ils ne se soucient pas de paraître socialement corrects. Leur obsession n’est pas de se faire accepter par les autres. Leur rêve n’est pas d’entrer dans l’ordre de ce monde.
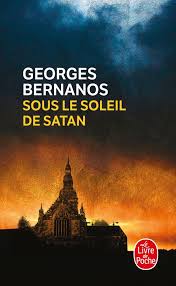
On ne croise pas, dans ce paysage à la fois fangeux et sidéral, des individus faibles, châtrés, qui plient l’échine, ou s’ils le font, c’est pour s’insurger ensuite avec une violence d’autant plus intense. L’abbé Cénabre est un colosse qui répugne à la besogne inachevée, qui n’hésite pas à blasphémer ou à frapper un pauvre vieillard pour se délivrer des démons qui le paralysent: brillance discursive, hypocrisie et ambition douteuse.
Cénabre veut savoir. Il exige que lumière soit faite sur le scandale de l’existence. Il est prêt à tout pour fracasser les fausses valeurs. Il ne compte que sur son énergie personnelle pour débusquer les lièvres de la tartuferie et de l’altruisme tout terrain. Son profond dégoût devant la niaiserie des termites et sa propre vanité provoquent la vision du suicide: «L’ogive de métal forait l’os frontal. L’œil sautait de l’orbite sur la table, et il voyait sur le drap le globe blanc dans un glaire écarlate».
J’ignore ce que le mot grâce désigne. Certains auteurs catholiques parviennent parfois à nous en donner une idée, sans parler des théologiens dont le métier est de trouver des définitions. Il est certain que Bernanos manifestait un goût particulier pour les naufragés, «les puissantes natures jetées hors de la grâce». La haine terrible, le mépris de glace, l’agressivité et la démence représentaient pour l’auteur de L’Imposture, ce «lac de boue toujours gluant sur quoi passe et repasse vainement l’immense marée de l’amour divin, la mer de flammes vivantes et rugissantes qui a fécondé le chaos».
A. M.
(Le Passe-Muraille, No 19, Juillet 1995)