Fictionnaire autobiographique
Dans la foulée de Paul Nizon,
par René Zahnd
À la question «qu’avez-vous à dire ?», Nizon a répondu à sa manière, en 1963 déjà, dans Canto: «Rien, que je sache. Point d’opinion, point de programme, point d’engagement, point d’histoire, point d’affabulation, point de fil d’un récit. Rien, si ce n’est cette passion au bout des doigts: écrire, former des mots, des lignes, cette espèce de fanatisme de l’écriture qui est mon bâton de route et sans lequel, pris de vertige, je m’écroulerais purement et simplement.»
Trente ans plus tard, l’écrivain bernois installé à Paris avance toujours avec «son bâton de route». Et le public francophone découvre son périple, au rythme des traductions qui paraissent, avec régularité.
Alors le lecteur est à son tour invité à une promenade sur les traces de Nizon, dans l’univers qu’il compose au fil des phrases: une forêt de prose merveilleuse, une paysage d’écriture dans lequel on peut errer, grapiller, marauder.
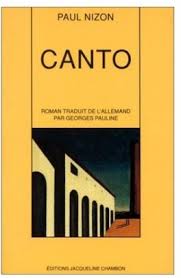
Pour commencer, le livre inaugural: Canto. C’est le chant d’un homme qui se trouve face à une liberté inouïe. Boursier à Rome, il a quitté sa famille et sa vie suisses. Le voilà ébloui par la lumière et par le pouvoir des mots. Nizon pratique alors l’action prose par analogie à l’action painting de Pollock. Il dira, bien plus tard: «Je considère Rome comme la ville où je suis né écrivain.» Il n’y a pas de récit, pas de personnages (juste quelques figures), mais un flux verbal, furieux et étincelant, qu’on sent né dans l’urgence: celle de rendre des états intérieurs, de capter un carousel de sensations et de sentiments. Canto est aussi le livre de la conquête du langage. Et ce n’est pas un hasard si liberté et langage sont associés.
A cette œuvre de lumière, à cette écriture mouvante s’oppose l’ombre et le statisme d’une entreprise d’exorcisme: Dans la maison les histoires se défont. L’écrivain dresse ici une forme d’inventaire, comme pour se dédouaner d’un passé trop pesant, dont le décor emblématique est la maison. Maison où sa mère tenait pension. Maison où son père s’affairait. Maison refermée sur elle-même, et qui sous son toit étouffait la vie, la liberté, le rêve.
Une lecture métaphorique de la «maison» est tentante. Elle peut symboliser père et mère, famille, société, Suisse. Matricielle, elle s’offre à bien des interprétations. Pour l’écrivain, l’important fut sans doute de formuler cet étouffement, de manière à s’en libérer, non pas physiquement, mais bien à l’intérieur.
Car Nizon est un homme de l’intériorité, du subjectivisme, qui se débat dans le monde, dans la pluie des fragments de réalité, dans les multitudes de signaux, d’événements qui le ballottent et l’envoient parfois rebondir ailleurs, contre d’invisibles murs. Et cette mise en mouvement forcée, dictée par l’extérieur, le condamne à écrire, tous les jours. Il prend des notes, et de ces notes peuvent naître des livres. Comme des accidents dans l’existence.
Dans un texte sur la relation entre la vie et l’écriture, Nizon montre que dans son cas vie et écriture sont enchaînés pour donner naissance à une troisième dimension: la recherche de la vie. Tout Nizon est là. Sa marche dont les livres sont des bornes. Son érotisation de la réalité. Sa quête inquiète d’une chose toujours fuyante.
Comme il aime à se définir lui même, il est «un écrivain en lutte pour le roman», ou un «fictionnaire autobiographique qui stationne en passant.» Le regard sur soi, sur le travail et la naissance des livres prend une force particulière dans Marcher à l’écriture, recueil des conférences prononcées à Francfort. On y trouve une analyse fouillée des conditions qui présidèrent à la naissance de L’Année de l’amour.
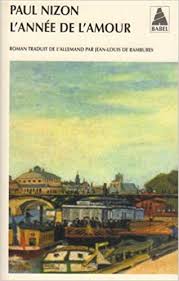
Et puis, ayant saisi ou non les éléments qui constituent l’oeuvre de Paul Nizon, il faut se plonger dans Immersion, au sous-titre parlant: «Procès-verbal d’un voyage aux enfers». Un critique d’art envoyé en «mission» à Barcelone par son journal vit un amour passionné avec une fille de cabaret. Il se perd dans cette histoire, dans cette ville. Son moi se dilue dans la réalité. Mais le récit, brusque-ment, va virer. Le héros s’extirpe du piège. Il rentre chez lui pour quitter femme, enfant, travail. Remis en question de fond en comble, le narrateur a subi une forme de catharsis, un lavage de l’être. Il prend une chambre (dans son propre cas, Nizon parlait de chambre-alvéole) et décide de se vouer à des travaux personnels.
Il y a peu de distance entre la vie de Paul Nizon et la vie telle qu’elle apparaît dans ses livres. Il y a juste le filtre, combien magnifique par moments, d’un style, d’une prose colorée, aux volutes magiques. Mais de là se dégage comme une représentation de l’homme en cette fin de millénaire: sans certitude, allant errant, sans patrie, dans une civilisation crépusculaire, se raccrochant en désespoir de cause à cet impalpable que peut être la littérature. Nizon, marcheur aux semelles de mots.

Pour finir, ces phrases, extraites d’un livre récent, Dans le ventre de la baleine: «Attraper les mots au vol, des mots pour toutes ces impressions, messages sensoriels, sentiments, pensées. Et les mots picorent les détails dans le breuvage de l’inconnu et édifient une éphémère demeure. Et dans l’espace inventé par les mots, je fais une brève halte. Ces tâtonnements, étonnements, dénominations, cet essai d’épeler la réalité est, bien sûr, voué en fin de compte à l’échec, c’est un coup de projecteur désespéré, un peu comme si l’on cherchait à allumer un der-nier bout de chandelle dans un caveau aussi vaste que l’univers et qu’à la seule lueur de ce bout de chandelle le monde se mît à exister.»
R.Z.

