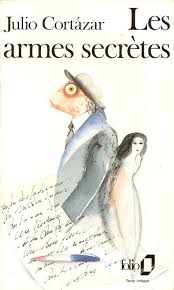Cortazar en son labyrinthe

À propos de l’Axolotl…
par Sylvie Blondel
Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J’allais les voir à l’aquarium du Jardin des Plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant je suis un axolot…
C’est à une étrange expérience métaphysique que Julio Cortàzar invite le lecteur de ce début d’histoire : passer de l’autre côté de la paroi d’un aquarium et vivre la vie d’une bestiole qui tient dans le creux de la main : l’axolotl. On trouvera le texte intégral dans son recueil de nouvelles, Les Armes secrètes, paru en 1958, disponible en Folio. La nouvelle Les Fils de la Vierge, figure également dans ce recueil. Elle a inspiré Antonioni pour son film le plus célèbre : Blow up.

Cet écrivain argentin, né en Belgique (1914) et mort à Paris (1984), est considéré comme l’un des maîtres de la littérature fantastique qu’il tient en haute estime. Axolotl, interpelle particulièrement aujourd’hui, car il pose la question de l’animalité. Une question aussi décisive qu’énigmatique. Quelle est l’humanité de l’homme à l’ère de l’élevage industriel entaché de violence envers les bêtes ? Depuis Descartes, les philosophes considérent les animaux comme des choses dont on peut disposer à sa guise sans conséquence morale. Cette vision utilitariste n’est plus tenable à notre époque.
Certes il existe de multiples structures animales différentes, mais alors pourquoi choisir l’axolotl ? Dans son récit, Cortàzar dit : Les lions étaient laids et tristes et ma panthère dormait. C’est donc fortuitement que le narrateur s’approche de l’aquarium, il est frappé d’une sorte de coup de foudre pour ces petites créatures roses, translucides, des larves de batraciens originaires du Mexique, comparables à des salamandres. Il leur trouve un visage aztèque. Il s’émerveille de la délicatesse des doigts, des ongles et des yeux d’or sans paupières de ses nouveaux amis. En effet, dès le premier instant, il sent quelque chose qui le lie à eux, quelque chose d’infiniment lointain qui donne le vertige. Il est fasciné par leur immobilité qui semble abolir l’espace-temps, leur indifférence, leur manière particulière de regarder, de nous regarder.
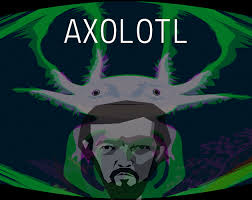
Dans les récits mythologiques et dans de nombreux contes populaires, on voit des hommes se transformer en bêtes et inversement. Les créatures qui composent le bestiaire en littérature sont légion. Dans Axolotl, le narrateur s’identifie à cet être mystérieux à plus d’un titre. Simultanément il expérimente la vie d’un autre dans un univers insoupçonné, dans un corps qui ressemble à un embryon humain. Il s’agit d’une régression in utero, vers un monde disparu.
Les interprétations sont multiples, en voici quelques-unes.
Dans la mythologie aztèque, certains dieux se sacrifièrent pour créer l’humanité. Un dieu nommé Xolotl, lui, voulut échapper à ce sort peu enviable en se cachant dans une rivière !
Ce qui intrigue aujourd’hui les observateurs de la faune exotique, c’est que les axolotls possèdent la capacité de régénérer la plupart de leurs organes endommagés ou amputés – pattes, doigts, cristallin de l’œil jusqu’au lobe olfactif de leur cerveau – grâce à un gène découvert depuis peu par des chercheurs canadiens. Cette découverte pourrait peut-être s’appliquer à l’homme pour l’aider à cicatriser ses plaies grâce à un bourgeon de cellules capables de se différencier. Les embryons de têtards, et de nombreux autres invertébrés possèdent cette faculté.
Plus étonnant encore, c’est la philosophie chinoise qui inspira Cortàzar, familier du Tao, la Voie. Il est basé sur la non-séparation du dedans et du dehors, la fluidité du Yin et du Yang, l’interaction entre rêve et réalité résumée avec légèreté et humour dans cette fameuse formule : « Tchouang-Tseu rêva qu’il était papillon, voletant, heureux de son sort, ne sachant pas qu’il était Tchouang-Tseu. Il se réveilla soudain et s’aperçut qu’il était Tchouang-Tseu. Il ne savait plus s’il était Tchouang-Tseu qui venait de rêver qu’il était papillon ou s’il était un papillon qui rêvait qu’il était Tchouang-Tseu. » Une formule qui s’applique parfaitement à la nouvelle de Cortàzar.
La dimension onirique, héritée du symbolisme et du surréalisme, est partout présente dans ce recueil. À noter, Axolotl n’est pas un récit amusant et gratuit ; cette petite créature est confinée dans ses parois de verre. Le narrateur croit déceler une immense souffrance dans son regard.
L’étrangeté est affaire de tonalité, de sensation, de mise en doute du réel, de perméabilité entre diverses perceptions. Pour l’auteur, le fantastique est loin d’être un phénomène marginal, mais habite l’imaginaire de l’humanité depuis des siècles, d’Homère à Dante, en passant par Poe et Maupassant. Habile à semer le trouble, l’écrivain est capable de s’identifier à n’importe qui, même à une larve d’amphibien !
Pour découvrir d’autres aspects de l’œuvre de Cortàzar, son roman Marelle, 1963, est le labyrinthe par excellence : il invite à expérimenter des combinaisons narratives dans le sillage de l’Oulipo. La thématique de l’enfermement et de l’angoisse parcourt son œuvre. Le lecteur est invité à arpenter sa propre prison intérieure ou à s’en évader.
S.B.