Dans la lumière des mots

À propos du nouveau livre de Fabrice Pataut, Les beaux jours
par Francis Vladimir
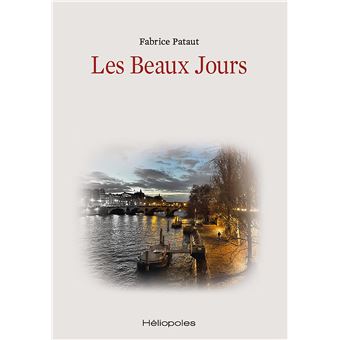
« Ce qui est resté jusqu’ici en friche l’est resté par faiblesse. Il s’agit tantôt de tentatives d’écriture pure sansl’expérience du dessin, mises en réserve plutôt qu’interrompues, tantôt de tentatives avec dessins pour lesquellesj’ai chaussé les cuissardes Guerlain»… Si l’on se réfère de plus à l’incipit tout à la contemplation des mots qui ouvre sur Les Beaux Jours, une telle phrase pose avec vigueur et cocasserie l’objet du texte de Fabrice Pataut. Pour être précis il convient de rajouter : et des dessins de l’auteur.
Si tout écrivain est sa propre doublure, Fabrice Pataut gratifie la sienne de cette manière-là qu’on lui envie : « Le dessin depuis le début, est destiné à l’écriture… Ce qui pourrait rester une illustration plus ou moins adroite incite aux corrections et même, souvent, à la refonte ».
Le doute est levé. Avec une ironie distante qui n’appartient qu’à l’auteur. Livre où les souvenirs affleurent par touches, où le passé vient à se redessiner par la réminiscence des lieux et des rues, les appartements à Neuilly et Paris, le couloir, la chambre et même, osons l’évocation, l’ineffable senteur de brioche qui s’amuse de la madeleinede Proust. Et puis les figures familiales, l’oncle et sa bicyclette, la grand-mère, Sidonie la bien nommée, ses mouchoirs à l’odeur de citron, la mère qui parfois aime les femmes, sa décapotable et ses chaussures à la pointe du hype, le beau-père colérique, les amis d’enfance Jean-Charles, Marc autant de pièces alignées sur l’échiquier du passé.
Ce que nous disent « Les Beaux jours », le plaisir caché de lecture – (pêle-mêle, Gide, Proust, Larbaud, Verlaine, Miller, Apollinaire, Artaud, Cocteau, Poe, Lovecraft, Baudelaire…Nabokov ) -, la jeunesse, les années de formation et fait écho, pour le quidam, simple lecteur, la réminiscence d’une époque qui, si elle est révolue, n’en résonne pas moins d’une entêtante présence. Le choix et la force des mots, avec ou sans contemplation préalable, la suggestion et le frisson charnels que des chaussures, fruit d’une activité de contrebande, dégagent, les scénettes dignes d’un opéra-bouffe, sous-tendent s’il en était besoin ce que l’écrivain avoue sans fard : « Je suis attaché aux volumes, aux couleurs, aux matières, aux arrangements ». Tel un arrangement à la Kazan, nous mesurons la difficulté d’être écrivain. Ou peut-être faudrait-il dire de devenir écrivain car Fabrice Pataut, trahi ou dépité, du point de vue de la forme et du fond, est particulièrement inspiré. On le devine membre de la confrérie des tortilloneurs de phrases pour lesquels la justesse est la première qualité d’un texte. Et pour s’être amusé, avoir fait ses gammes en langue macaronique, il sait que pour toucher au cœur et à l’intelligence il faut frapper juste sur le clavier des mots. « J’ai toujours lu et écrit en faisant comme s’il n’y avait rien d’autre que la lecture ou l’écriture en cours. J’ai toujours travaillé derrière les remparts. » Pourtant, c’est à leur assaut que le narrateur part, mots au fusil, pour arpenter tout au long de ses Beaux Jours, le chemin trouble de sa mémoire qui, par le miracle de l’écriture, approche des fleurs écloses, loin des flétrissures du temps qui a passé. « Les beaux jours » est un texte, étonnamment court, dont il importe peu de savoir s’il est autobiographie ou errance, divagation impertinente et nostalgique. Un fait demeure, l’esquisse des êtres évoqués, les ombres et lumières font naître l’irréalité d’un tableau de Marie Laurencin. Cette sensation picturale rend justice à ce que l’écrivain Fabrice Pataud s’est essayé d’approcher : le délicat du souvenir.
Sans surligner, avec l’apparente désinvolture d’une grande maîtrise, – son style sans fioritures, vif, acéré -, celle aussi de «sa jumelle incestueuse et inflexible qui lui tient tête », la lecture, le narrateur opère une mise à nu, sans forfanterie ou cachotterie, sans autre exposition qu’une vérité qui, pour être intime, n’en est pas moins révélatrice d’une catharsis partagée, du bout des mots, avec ses lecteurs, leur livrant, en creux, une belle réflexion sur le métier d’écrivain.
Sept nouvelles accompagnent Les beaux Jours. Après la remontée dans le temps et le tissu du vécu, elles témoignent de la métamorphose jamais achevée, du sillon toujours ouvert. En écho à ses « conversations avec la cruauté », déroutantes en diable, dont les chutes, si chute il y a, attestent d’un sens aigu du mal, du dérisoire et de l’absurde de l’existence. Ma préférée, « je m’appelle reviens », pour son fétichisme du chapeau incliné à plume de paon et son escalier à colimaçon, clin d’œil à la chambre de Marc, et sa tendresse retenue.
Beckett et Ô les beaux jours tendent le miroir de Winnie à l’écrivain des Beaux Jours. À quoi je rajoute le mot de la fin de Jean-Louis Kuffer : « Dans le sillage de Nabokov, Fabrice Pataut est sans pareil »…
Fabrice Pataut, Les beaux jours. Editions Héliopoles, 2022.
@Francis Vladimir – le 15 septembre 2022 –
