London boys
À propos des Lettres à un jeune Londonien de W.A. Thackeray
par Fabrice Pataut
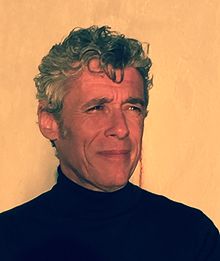
Et donc une vieille baderne (de son propre aveu) s’adresse à son jeune neveu fraîchement installé dans ses pénates londoniennes pour lui signifier tout le mal qu’il pense des barbichettes inconvenantes, des bracelets jarretières, des fermoirs impertinents et des frisottis de mauvais goût. Ce n’est pas tant le caractère efféminé qui gêne que l’ostentation ratée. Tout étalage de soi est indiscret par définition. Le paon, le caméléon et même la tulipe, à l’instar du fop, s’en contentent avec naturel. C’est la version factice ou de pacotille qu’il faut éviter. Rien de pire que d’avouer par manque de moyens qu’on fait tout pour se montrer tel qu’on n’est pas profondément. À force d’imiter sans discernement, on fini par se trahir, et, comme les snobs, mériter le sort des baudruches.
Nous sommes prévenus : « Le pudding […] possède deux aspects — à savoir l’interne et l’externe [.] » C’est dire si rien n’est simple, au point qu’il ne suffit pas d’afficher politesse et propreté, qualités de l’honnête homme, pour être cru. On pourrait après tout, sans fanfreluche, faire semblant d’être posé, économe et ravi de l’être, et cacher une tendance à la dissipation derrière une discrète couche de poudre.
On expose donc le jeune neveu à rien de moins qu’un paradoxe : il y a, dissimulée derrière des recommandations utilitaristes d’allure victorienne (au sens de la droiture et même de la rigidité), une apologie de l’apparence et parfois du paraître, voire du dandysme, qui, comme le remarquait Baudelaire, a peu à voir, sinon en surface, avec un goût immodéré pour la toilette.
Quel est donc le lien entre l’aspect extérieur de l’individu et son moi profond, non pas sub specie aeternitatis, mais du point de vue d’autrui réuni en société, notamment quand ladite société, très consciente des avantages du raffinement, veut avant toute chose qu’on la sache policée ? Aucun, voudrait-on croire. Cela fait belle lurette que la laideur n’est plus un stigmate du mal, etc. Pourtant, ni la science, ni les vertus ne comptent vraiment. Pire : elles ennuient. Les manières occupent le devant de la scène. Il faut donc faire croire qu’on respecte l’ordre et la bienséance sans révéler qu’on cherche cet effet en particulier, en affichant une certaine forme de bon goût dont la mission doit rester discrète, voire secrète. Il y a là une difficulté considérable. Le rôle de l’oncle dans ces Lettres délicieusement traduites par Sean Rose, est de guider en quelque sorte à travers le paradoxe plutôt qu’autour. Il s’agit d’affronter et non pas d’éluder.
Si la difficulté est remarquable, c’est parce que la société corrompt. Il est conforme à cette corruption que les bourgeois singent (fort mal) les (vrais) gentilhommes. Comme le note justement Marc Porée dans sa préface enlevée et érudite, Thackeray leur règle leur compte assez vertement et rappelle sur ce point La Bruyère et La Rochefoucauld. Il y a pourtant à la fois de la candeur et de l’ironie à insister sur l’importance de la bonne adresse et du bon costume, à rappeler qu’il faut être charmant et dans l’habit et le comportement. Mais bon, puisque la vertu est casanière et qu’on ne saurait vivre en ermite à moins de tuer en soi le gentihomme, il faut bien l’habiller pour sortir. L’apologie de la baignoire, du rasage et de l’eau de toilette, faite non sans un certain esprit de sérieux, trouve là sa justification. Laquelle est renforcée par des considérations sur la compagnie des femmes, jugée supérieure en finesse à celle des hommes réunis au club où la vulgarité et l’égoïsme refont facilement surface. Pour elles, plus encore peut-être que pour soi-même, les habits doivent être bien coupés quoiqu’« avec un certain air de vacances » (une merveilleuse trouvaille), sans exagération dans l’élégance de la coupe. Pourquoi ? Parce que l’habit doit honorer par osmose ce qui nous fait honneur. Le bénéfice de la compagnie des femmes tient dans l’aprentissage de l’hommage qu’on leur doit. C’est là une vraie vertu, une qualité morale authentique. La feinte de l’habit porté avec élégance et souplesse n’est ici que superficielle. Quant à l’ennui mondain, jamais trop loin, Thackerey donne ce conseil charmant pour le tuer sur place dans les salons : « Cause à la douairière. »

Thackeray grossit donc volontiers le trait, mais c’est plus pour obtenir un effet de loupe que pour le plaisir gratuit de la moquerie ou de la satire. Il avoue observer les jeunes londoniens oisifs, prétentieux et gâtés par l’argent « sous l’angle de la philosophie naturelle » et non pas en moraliste. C’est dit bien sûr par ironie, à moins que la nature ne délivre avec impartialité des conseils de bonnes mœurs et ne soit aussi neutre en la matière qu’avec les orages et les inondations. Thackeray est un redoutable observateur et dans la mesure où, comme le remarque très justement Rose, le traducteur est l’auteur d’une œuvre dérivée, un « faussaire synesthésique », toute la difficulté est de rendre le sérieux des conseils pratiques sans rien perdre de l’humour et même parfois de la farce qui, lorsqu’elle est inflexible et même un rien impitoyable, nous rappelle l’esprit très noir de Swift.
L’honnête homme, le gentleman, est un homme moral, non point au sens de Kant, parce qu’il aurait trouvé la loi morale en lui-même, mais au sens où il est un passant avisé, prudent, sans cesse conscient du fait que les dieux nous ont joué un mauvais tour et qu’il faut faire bonne figure. La conscience de l’imminence de la mort, de la fragilité des sentiments, de la contingence des rencontres en société (et, voudrait-on ajouter, des intermittences du cœur incisées au scalpel proustien) reste partout présente, renforcée plutôt qu’affaiblie par le ton léger et même badin volontiers adopté par Thackeray. Rose réussit parfaitement l’exercice d’équilibrisite qui consiste à ne renier dans sa traduction française ni ce qui exprime le tragique de la condition humaine décrite par l’oncle imaginaire pour le bénéfice de son neveu fictif, ni ce qui en exprime le ridicule et même parfois la bouffonnerie.
Nous voilà donc dans la position du roi amusé, mais également critiqué et par là-même instruit par les cabotins pour peu que le roi fasse preuve d’intelligence. Respecter son prochain, c’est ce qu’il faut apprendre et mettre en pratique, mais quelle difficulté, n’est-ce pas ? dans cette « Babylone vide » qu’est Londres à la morte-saison.
Au terme de ces Lettres, l’essai de Rose qui clôt le volume, « Du gentilhomme au gentleman » est instructif sur le paradoxe de l’apparence : les manières, la politesse, autrement dit la tenue extérieure du gentleman est un reflet de son âme, laquelle considère autrui non pas de haut, comme un mondain, mais en quelque sorte horizontalement, comme un démocrate (au sens du respect de la liberté et de la valeur de chaque individu). Nous restons donc ici dans la sphère relativement étroite des relations privées, sans visée plus élevée ou plus noble, autrement dit dans la sphère de la société civile bourgeoise opposée par Hegel dans les Principes de la philosophie du droit à la sphère politique de l’État où apparaît à proprement parler le citoyen. On y reconnaît volontiers que l’être humain est un animal social : chaque individu recherche la satisfaction de ses besoins et de ses désirs privés (par opposition à ceux de l’État) avec le concours d’autrui, selon un calcul qui respecte tant bien que mal l’équilibre des libertés individuelles.
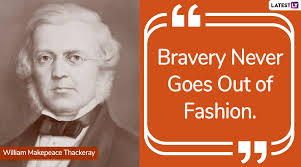
Mais c’est aussi dans cette sphère qu’émergent finalement les intérêts communs objectifs, les buts qui font du gentleman un citoyen authentique et non pas un simple bourgeois satisfait. On aurait pu croire, en passant du gentilhomme au gentleman « tomber en roture ». C’est tout le contraire : la descente supposée « a provoqué une montée » puisque la vraie noblesse est maintenant contenue dans la conscience du devoir.
C’est dans ce cadre social et politique que la politesse s’exerce et se raffine, que l’habitude de converser en société, d’argumenter et de convaincre avec adresse et urbanité devient une seconde nature. Le gentleman s’efface et s’attache « à percevoir la singularité de son interlocuteur ». Il est gracieux plutôt que superficiellement à l’aise ou brillant en société. La distinction est essentielle, d’autant plus que la vanité mondaine peut facilement adopter les habits de l’amabalité et de l’obligeance. Rose retrace pour nous l’évolution de l’art de la conversation, en rappelant fort à propos le rôle de Mademoiselle de Scudéry et de Madame de Staël. Le gentleman est bien sûr le produit historique d’éléments disparates et contradictoires qui vont des manières du courtisan à celles de l’honnête homme, de pratiques et d’habitudes qui relèvent du salon littéraire, du club fermé et des débats publics menés selon l’idéal des Lumières. Un nouveau type d’homme ressort finalement vainqueur de ces oppositions puisqu’on sera passé du vivre ensemble entre soi au vivre ensemble tout court. Comme l’exprime Rose dans une formule concise aux airs d’avis aux intéressés : « Quand on est gentleman, on l’est partout ».
Et l’extérieur, en fin de compte, que devient-il ? Il faut quand même continuer d’y penser…

Sous des dehors gracieux qui n’excluent pas entièrement l’excès, le gentleman est l’homme poli par excellence, élégant, flegmatique et, prends soin de noter Rose, « un brin excentrique ». Oui, mais jusqu’où exactement ? Thackeray avait bien relevé la difficulté. Elle n’a pas beaucoup changé. Les chemises éclatantes, les chapeaux à plumes et le taffetas moiré entrevus par le faux oncle dans Londres à la morte-saison évoquent tout autant la capitale de l’Empire du début du dix-neuvième que le Chelsea de Wilde, le Carnaby Street des années soixante, et, bien sûr, le glam, cette invention divinement anglaise de Marc Bolan et David Bowie où l’affectation et le plaisir mélancolique du paraître doit s’exprimer par l’excès vestimentaire, l’outrance des poses, l’adoption étudiée d’un maniérisme vocal et corporel.
À Paris, c’est bien connu, les Britanniques s’encanaillent et même assidûment. Faisons de même, nous dit-t-on ici, pour conjurer l’antique vanité de l’Ecclésiaste. Faisons-le avec légèreté, assis dans sa bergère jambes croisées, la canne posée sur le guéridon, un porto à la main, et pourquoi pas dans un costume tartan trois pièces comme l’élégant rondement saisi de profil par le graphiste Marc Poitvin.
William Makepeace Thackeray. Lettres à un jeune Londonien. Édition de Sean Rose. Préface de Marc Porée, Illustrations de Marc Poitvin. Éditions rue d’Ulm, 2021, 132 p. 20€.

