Manganelli en son Labyrinthe
Premiers pas dans le dédale d’un grand écrivain,
par Fabio Ciaralli
Dès la première lecture de celui qu’Italo Calvino considérait comme «le plus italien des écrivains et en même temps l’écrivain le plus isolé de la littérature ita-lienne», je fus frappé par le raffinement et la perfection tranchante du lexique, l’élégance et la clarté syntaxique de la phrase qui fustigeait les us et coutumes de la bête humaine ou éreintait l’œuvre d’un malheureux auteur.
«Je ne suis pas sûr que les mots aient un sens, écrit Manganelli, mais ils ont certainement un son.» Sa voix à lui était, paraît-il, envoûtante, et son ami Pietro Citati raconte qu’il n’avait jamais entendu quelqu’un converser de cette manière: «à la façon d’un grand Père prédicateur, d’un pape de la Renaissance ou d’un di-plomate du XVIIIesiècle, il exhibait gérondifs, participes présents, termes rares, propositions subordonnées à l’intérieur d’autres propositions subordonnées, plus-que-parfaits du subjonctif avec une maîtrise parfaite de la concordance des temps, en se nourrissant goulûment de mots, rôtis sanglants de substantifs, plats d’accompagnement colorés à base d’adjectifs, sauces folles de verbes et d’adverbes. […]

Chez lui la pensée la plus subtile et la plus complexe devenait aussitôt, sans un instant d’hésitation ou de doute, forme verbale». Vous imaginez-vous ce dégustateur de mots devant la dégradation actuelle du langage de la télévision? Où les paroles-sons n’existent pas, mais seulement des paroles bougonées, balbutiées, hurlées, avec ostentation d’obscénité et de vulgarité, considérées comme la norme et acceptées sans broncher?
Infinis sont les destins pires que la mort…La beauté ayant toujours mille dimensions, souvent inquiétantes, éclaircissons tout de suite un point im-portant.
Le formalisme de Manganelli – les labyrinthes baroques qu’on lui a reprochés, les fastes rhétoriques, le maniérisme parfois halluciné – n’est pas seulement cap-tivant, il possède un noyau solide et opulent d’intuitions foudroyantes, d’intelligence, de liberté souveraine, en lut-te constante avec sa propre souffrance, avec Dieu et le néant.
«Manga» – comme l’appelaient affectueusement ses amis – a été défini comme un magnifique chantre du rien, dont la virtuosité dialectique, a-t-on dit, croît avec la manie qui l’habite. Il semble en effet que fureurs et obsessions le contraignent à broder, à jouer au bouffon pendant qu’il transcrit, tout en le fuyant, un monde intérieur toujours au bord de l’autodestruction.

Souvent, entre les lignes, nous rions d’un rire amer, l’angoisse nous saisit. Nous sommes sensibles au paradoxe d’une forme parfaite qui devrait nous rasséréner mais qui au contraire nous opprime, nous contraignant à em-prunter des sentiers périlleux conduisant unique-ment au néant: «Je ne vois rien devant moi et quant à mon passé, il me fait horreur», «Mon désespoir a assumé une forme vitale ou pseudo telle […]. J’écris, je lis, je pense. Mais mes contradictions restent san-glantes, plaies ouvertes et insupportables».
Notrepassion pour la littérature nous incite souvent à fouiller dans la biographie, dans l’illusion de trouver des réponses. Dans le cas de Manganelli, il semble que la fin d’une histoire d’amour importante (avec la grande poétesse Alda Merini, tout récemment disparue), à la fin des années quarante ait entraîné l’écrivain au bord de l’effondrement psychique. Après son départ de Milan pour Rome en 1953 et la rencontre avec le célèbre psychanalyste Ernst Bernhard, il commence à écrire Hilarotragœdia, le chef-d’œuvre de ses débuts, publié en 1964, à 42 ans. C’est un traité autobiographique sur l’obsession de la mort. Un voyage aux enfers dans la conviction que la nature de l’homme le porte à descendre et que la tâche de la littérature est chamanique. La vocation-condamnation humaine à la descente trouve son accomplissement dans le suicide: «De la cime infinie penche-toi, abandonne-toi au précipice. Sois fidèle à ta descente, Homo. Ami».
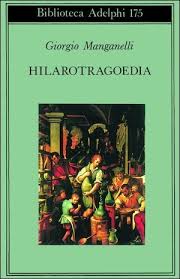
La mort que l’homme peut s’infliger traverse toute l’œuvre. Dans un texte intitulé La mort libératrice***,l’auteur raconte une «mors voluntaria» à la saveur «dé-licate, tactile, quotidienne, domestique […]. Nous savons de source sûre que per-sonne ne peut nous barrer ce chemin: ni le terrorisme de la police, ni aucun piège. […] C’est pourquoi, lorsque nous touchons le fond du désespoir, nous retrouvons le sourire. Nous avions peur d’être réduits à néant et de conserver notre conscience. Nous nous souvenons qu’il y a une manière d’abolir aussi cette conscience marginale. Le sourire qui refait surface à ce moment est la mesure de notre dignité».
Manganelli se rattache à l’idée classique du suicide: «un geste complètement étranger à la passion mauvaise, un geste calme qui restitue ordre et dignité à notre image enchevêtrée». Pour lui, l’ordre moral […] et sa cohérence résident précisément dans la possibilité de se donner la mort. Non sans une cruelle lucidité, l’auteur se demande pourquoi l’homme ne passe pas plus souvent à l’acte: manque de force, même devant la dégradation qui nous at-tend, «couardise sans limi-tes, transformation de l’être en sexe de putain, en voix rauque de fasciste, en men-diant […], en tout ce que les vers mangent comme si c’étaient des cadavres finis; l’homme reconnaîtra dans le crottin un visage qui autrefois avait été à ses yeux quo-tidien et tolérable. Mais nous vivrons. […] Il ne reste plus que la mort naturelle. Nous nous opposerons même à elle. Nous aurons peur de l’enfer. La seule honnêteté qui nous reste, c’est la haine de nous-mêmes».

Manganelli raconte que Bernhard l’a aidé à traverser les ombres de l’inconscient. L’analyse a réveillé en lui l’écrivain caché. La littérature l’a sauvé du désespoir. Ainsi sont nés, en un curieux mélange d’inconscient et de rhétorique de l’Antiquité tardive, de la Renaissance et d’un Baroque à la manière de Poe (dont il fut un excel-lent traducteur), les stupéfiants monuments-cimetiè-res et les villes du rien de la première saison.
Puis l’écriture se dilata pour englober l’univers tout entier. Tout pouvait devenir littérature et subir une transfiguration: du football à l’église, de la circulation au tourisme, de la Démocratie chrétienne à l’avortement, à la cuisine, aux travers des gens et aux problèmes liés aux déménagements.

La tâche de l’écriture, comme l’affirma l’auteur dans Littérature et mensonge de 1967, demeure celle de transformer la réalité en mystification et en scandale; il faut rendre honneur à «la littérature de la main gauche, de l’apostasie, de l’hérésie». C’est précisément pour cela qu’on a pu parler d’un nouveau genre: l’odeporicamanganellienne. Lorsque nous lisons un de ses nombreux récits de voyage, comme le Voyage en Afrique récemment traduit en français, nous découvrons, purement désorientés, d’autres mondes à la fois fascinants et impossibles: Manganelli nous ouvre sans cesse un univers qui n’a pas de fin.
F. C.
*** Inséré dans Un livre 1953-55, publié dans la revue Riga, n° 25, 2006.Article traduit de l’italien par Anne-Marie Jaton.
(Le Passe-Muraille, No 82, Juin 2010)

