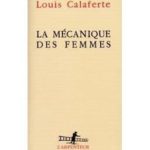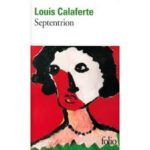Calaferte ou le vertige du sexe
À propos de La Mécanique des femmes et de Septentrion,
par Antonin Moeri
En lisant La Mécanique des femmes, j’apprends à me souvenir. Je partais d’un coin de la ville pour d’interminables errances. Au bord de la nuit, les rues du quartier chaud se remplissaient d’hommes solitaires, à l’affût, sans voix.
Des ombres inquiétantes frôlaient les murs sales des vieux immeubles.Quelques voitures ralentissaient devant une série d’am-poules qui s’allumeraient bientôt. Une «immense fatigue se répand dans les nerfs comme une coulée froide». Une main se lève imperceptiblement, entraînant le quidam dans un couloir sombre. Un escalier en bois conduit aux chambres. Le pied sur une chaise, elle dit: «Pourquoi tu trembles?» Pas de doute, elle domine. Elle n’a rien d’une salope. Déhanchement crâne. Le client est paralysé. Elle le prend pour un simplet. La lueur métallique du réverbère, qui vient de s’allumer dans la rue, lui fait une auréole. Ce fut comme une illumination. J’ai cru voir le Christ.
Dans La Mécanique des femmes, il y a un personnage masculin qui perçoit les paroles et les tressaillements du désir féminin. Les dents qui prennent la peau et mordent… Si tu pouvais me toucher, tu verrais, je suis au bord… Elle sait que je la regarde enlever ses bas… Je voudrais ton sexe comme un couteau planté dans mon ventre. Ce personnage est fasciné par les femmes, il les repère de loin, les dévore du regard, les suit, les interroge, les baise à n’en plus finir, les écoute. Ce qu’il entend le stupéfie.
Il y a celle qui, à douze ans, offrait son corps sans complexe. Il y a celle qui, ayant appris que son mari couchait avec des messieurs, ne veut plus le toucher, imagine tous ces poils ensemble qui la font vomir. Il y a celle qui a rêvé de devenir pianiste virtuose, qui vit seule dans un appartement très moderne et qui, au lieu de se produire sur des scènes illustres, se contente de séjourner à l’étranger, au milieu des touristes. Il y a celle qui aboie au moment de l’extase érotique.
Les scènes se déroulent dans une rue froide, sur une banquette de restaurant, dans un train, une cour désaffectée, la chambre d’un hôtel minable, une cimenterie abandonnée, une cuisine, une sortie de ci-néma, un taxi, les toilettes d’un bar, une entrée d’immeuble.

Comme le fit Joyce avec Molly Bloom, ou Cohen avec Ariane, Calaferte laisse la parole à ces dames. Il se fond dans leur chair, si j’ose dire, pour avaler le monde et raconter cet avalement avec les mots de l’Autre, pour dire le vertige des étreintes, l’excès de la violence amoureuse, le dépassement de l’angoisse, les frissons que procure la profération des blasphèmes, les expressions effrayantes de la joie monstrueuse, les noces célébrées dans le sang menstruel, les exquises senteurs de l’éternité retrouvée, le scandale à jamais renouvelé du désir humain quand celui-ci n’est pas ravalé au rang de besoin pressant que la marchandise devrait aussitôt satisfaire.
Mais contrairement à Molly et, surtout, à Ariane, qui doit étouffer un rire quand il bouge sur moi tellement rouge affairé les sourcils froncés, contrairement à ces petites bourgeoises délirantes, les personnages féminins de Calaferte vouent une adoration presque mystique à ce qui éveille leur trouble: un couteau planté dans mon ventre.
L’idée de mettre en scène le désir et la mécanique sexuels peut engendrer un texte où le lyrisme s’allie à une précision d’entomologiste. Il n’est que de relire les interminables pa-ges de Sade, à la fois monotones et somptueuses, pour s’en convaincre.
Le personnage que Calaferte met en scène, dans Septentrion, est une Hollandaise allumée. Elle a des bibelots, des boucles d’oreilles exotiques, un appartement de luxe, une domestique, des «taches de rousseur jusque dans le bleu des yeux» et la peau qui pendouille sous le menton. Elle s’appelle Nora Van Hoeck. Elle aime les originaux, Cimarosa et Rubens. Un dimanche après-midi, le narrateur se laisse entraîner chez cette «plantureuse insoumise» à qui il veut soutirer de quoi payer la note de son misérable hôtel. Il passe un contrat avec la Fille de Rembrandt: elle paiera régulièrement son chevalier qui devra, en contrepartie, lui offrir un fleuve de plaisir. Cette subite opulence confère au petit maquereau une audace, une confiance et une autorité qu’il n’avait jamais connues auparavant. Son imagination, désormais, est libre.Il s’acquittera de la dette qu’il contracte en créant une langue.
Si l’étalage de la possession peut, un instant, réjouir notre aède des catacombes, celui-ci ne saurait accepter l’éternelle supercherie, cette «médiocrité ravie». Il fera l’amour à ses propres désirs, «à l’homme que je suis dans ma solitude et qui n’a que les mots pour s’exprimer […] Mlle Nora entre les jambes, je reprends le livre où je l’avais laissé». Il la regarde se tordre de plaisir. Il l’examine de sang-froid. Il prend des notes sur le vif, comme s’il voyait cela «des coulisses d’un grand théâtre […] Contours des sensations. Perception furtive. Devraient être calquées instantanément afin de conserver leur saveur».
Des passages entiers de livres qu’il aime lui reviennent en mémoire. Strindberg, Tchekhov, Dostoïevski, Rousseau «l’hypocrite, le fabuleux faussaire de soi-même!»
Il entend la Sonate à Kreutzer pendant que Nora «gambade, caracole dans le lit, suspendue par le ventre». Leurs yeux sortent des orbites, «glis-sant chacun au bout d’un fila-ment bleuâtre que j’avais recon-nu pour être le nerf optique». Le mécréant se rattrape à l’astre pro-videntiel, «à ses cheveux, à ses jambes, rencontrant par hasard sa mâchoire dénudée comme celle d’un squelette».
Et c’est le vide dans lequel ils seront précipités que Calaferte interroge, cette longue chute qui prendra fin lorsque «des lambeaux de cervelle irriguée de sang noir» joncheront le bitume.
Marchant, un jour, sur les planches d’un échafaudage, le vertige me prit. Me suis vu tomber. Je voyais distinctement mes gestes désordonnés dans le vide qui me happait. C’est un trouble de même nature que je ressentais en découvrant La Mécanique des femmes et Septentrion.Comment expliquer le vertige Calaferte?
Il y a certes, dans ce que j’ai lu, une combinaison d’érotisme et de mort, ce renversement qui chavire dont parle Georges Bataille. Mais j’eus surtout l’impression que, pour faire entendre le pouls de l’existence, Calaferte avait choisi de jouer sur un clavier d’écho où le cri de la femme qui jouit prolonge celui de l’accouchée, amplifie ce-lui du nouveau-né et résonne comme un râle d’agonisant. En réalisant ce projet dans les marges du monde, en nous faisant voir avec exactitude ce qu’il imagine, en cherchant son salut, si j’ose dire, dans la patiente élaboration d’un style magnifique, âpre et dépouillé, dans l’agencement de phrases courtes, nerveuses et sèches, l’auteur de Septentrionne ces-se de célébrer le verbe qui est, finalement, peut-être, notre seule défense contre la mort.
A.M.
Louis Calaferte, La Mécanique des femmes, Gallimard, coll. L’Arpenteur, reprise en Folio, 1994, 162p; Septentrion, Folio.