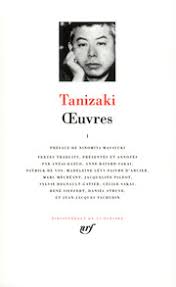L’ombre claire de Tanizaki
À propos du grand auteur japonais entré dans La Pléiade,
par Christophe Calame
Pour un bon lecteur, chaque littérature du monde devrait trouver son moment, son heure, sa semaine peut-être, où elle pourrait agir véritablement à la manière d’un médicament irremplaçable. Il faudrait alors se connaître assez bien pour pouvoir se prescrire à soi-même cet «air», ce timbre de voix, ce climat littéraire unique, que la traduction même la plus médiocre ne peut filtrer. La littérature japonaise aurait peut-être cet effet merveilleux de délasser du refoulement occidental. Les périodes de psychanalyse lui sont donc propices: un inconscient à ciel ouvert se sent plus clair que ses semblables, embarrassés de symptômes, de phobies, de lapsus. C’est qu’il me semble que la littérature japonaise, ou du moins ce que j’en connais, en dit toujours beaucoup plus que la nôtre sur l’incohérence apparente des hommes, si cohérente quand on perçoit les choix inconscients qui la dirige.

Faut-il parler d’un «degré zéro du moralisme», ou plutôt d’un moindre mécanisme de la psychologie littéraire (bien qu’il ne faille jamais sous-estimer la logique du bouddhisme) ? Il y a dans la civilisation japonaise mille ans de stylisation continue d’éléments tout à fait hétérogènes. Bouddha, Confucius bien sûr, mais aussi Flaubert, Maupassant, Huysmans, James, Wilde, se retrouvent par exemple dans l’œuvre de Junichirô Tanizaki (né en 1886). Comment s’y retrouver ?
D’abord cesser absolument de croire à la compacité des civilisations. L’étrangeté du signe n’est pas un obstacle, mais bien au contraire un appel.
Japon et Occident se parlent depuis longtemps, par estampes et impressionnistes bien sûr, mais aussi par romans et nouvelles. Ce dialogue n’est pas moins important que celui que l’Occident a tissé avec la Russie depuis un siècle. Mais cette grave conversation est surtout discrète. Elle ne concerne ni les affaires ni la politique, mais elle est l’œuvre de tous ceux qui se passionnent pour le plaisir et pour les formes, dédaignant généralement tout rôle dans la cité.
Ce dialogue suppose surtout la distance. Une nouvelle de Tanizaki publiée dans ce premier volume de la Pléiade, L’Espion du Kaiser (1915), nous montre l’Occidental au Japon. Toujours hâbleur, malappris, en faute sur tous les codes, grossièrement perceptible dans ses intentions intéressées, il ne peut retenir durablement le respect de ses interlocuteurs orientaux. Pourtant Tanizaki ne cesse de nous entretenir de sa douloureuse passion pour la trop lointaine littérature européenne. C’est que l’amitié littéraire est toujours indirecte et que la fascination des signes ne supporte pas bien les interlocuteurs. Le Japon peut bien essayer de jouer un rôle dans le monde à la mesure de sa puissance, sa littérature ne sera jamais un produit promotionnel, pas plus que la lecture n’est une affaire de Salon du Livre.
Bien sûr, Tanizaki est aussi un grand explorateur de sa propre culture: son préfacier le loue d’avoir illustré tous les styles de l’histoire littéraire du Japon: style savant compacifié d’idéogrammes chinois, style fluide et sensuel des femmes de cour de l’an Mil, lyrisme recherché sur le mode romantique, standard simplifié du japonais contemporain, il semble que Tanizaki très tôt excelle en tout. Mais ceci est perdu pour les lecteurs de la Pléiade, bibliothèque astreinte à l’exigence de l’universel. Et dans une certaine mesure, cela est bien: il ne s’agit pas pour nous de connaître le Japon, mais bien toutes ces choses étranges que l’on sent vivre en soi indiciblement, durant ces semaines de solitude, où l’on a tellement l’impression que tout ce qu’on pourrait dire serait immédiatement retenu contre nous par nos proches.
De l’Occident, Tanizaki ne retient aucunement du roman occidental sa part d’investigation sociologique, voire historique. Qu’il nous présente des empereurs ou des hommes déclassés, des riches ou des pauvres, Tanizaki ne s’intéresse qu’à leurs désirs. Or la passion dans la culture japonaise est toujours à l’écart, à l’abri de la marche du monde, dans les marges de l’écriture de l’Histoire. Une nouvelle emblématique nous le montre: un homme est reçu par une femme qui l’aime dans une maison d’un faubourg d’Edo, l’ancienne capitale avalée par les gratte-ciel de Tokyo. Cet homme est contraint par sa maîtresse à venir la trouver les yeux bandés. Au fil des visites, il se passionne pour l’itinéraire et les quartiers invisibles qu’il traverse. A la fin, il arrive devant la maison de ses rendez-vous sans bandeau sur les yeux, ayant retrouvé l’itinéraire. Mais son amante lui ferme sa porte pour toujours, comme si le plaisir supposait absolument la perte des repères.
La nouvelle qui ouvre le recueil de la Pléiade, Le Tatouage (1910), est une sorte de manifeste esthétique, digne d’Oscar Wilde, auquel on pense souvent en lisant Tanizaki. Dans cette nouvelle, une jeune courtisane est transformée en dévoreuse d’hommes par le tatouage d’une araignée dans son dos, tatouage dans lequel un peintre met tout son art et toute son âme. C’est que pour Tanizaki comme pour Wilde, c’est l’art qui confère la séduction, et non la nature. Au détachement bouddhique qui est dédain du phénomène («nom et forme»: identité et beauté sensible), Tanizaki répond par la suggestion de l’extrême attrait de ce qui est la fois beau et vide, impersonnel. Le romancier n’a pas la naïveté de penser que le plaisir puisse nous rendre heureux. Il a seulement la sagesse de montrer que la vacuité n’en est pas la moindre séduction.
Enfin la Pléiade se devait de contenir cet Eloge de l’ombre (1932), qui vaut comme la meilleure introduction possible à l’esthétique japonaise. Tanizaki s’interroge sur la modernisation des maisons japonaises (le chapitre sur les lieux d’aisance est d’une saisissante profondeur). A travers les aciers et les chromes, les carreaux, la porcelaine et toutes les surfaces brillantes, l’habitat occidental tue la douceur des formes japonaises. L’Eloge de l’ombre contient la clé de la beauté des laques: ces meubles et ces objets ne doivent pas être éclairés, ou à peine. Leurs dorures criardes ne peuvent luire à leur juste mesure que dans une lourde pénombre.
Comme les désirs de ses personnages romanesques, peut-être.
Ch. C.