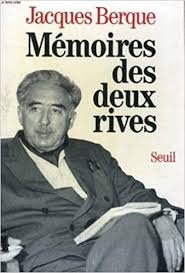Un chantre de la fraternité
Hommage à Jacques Berque,
par Rafik Ben Salah
Je puis témoignage que Jacques Berque est le seul homme non arabe que j’aie entendu parler un arabe si pur qu’il devient permis de souscrire, sans réserve, à ce que lui-même disait de cette pratique, à savoir qu’ il avait parlé l’arabe maghrébin à peu près comme sa langue maternelle… de façon peu discernable des Maghrébins. Cela, Berque le disait en 1978, dans son ouvrage Arabies (Stock). Mais l’ayant, ces derniers jours, entendu au téléphone, il convient de corriger le plus-que-parfait du verbe parler par le présent.
Cela s’explique par le fait que ce savant, à qui il faut attribuer de nombreuses connaissances et appétences (histoire, sociologie, linguistique, philosophie, islamologie, bref toutes les humanités au sens classique), est né voici 82 ans en Afrique coloniale. Il a été lui-même colon, fils de colon. Son père appartenait à l’ administration coloniale et faisait office de Hâkem (juge), charge transmise à son fils, Jacques-Augustin (dont l’œuvre nous occupe ici), qui l’exerça en Algérie, ensuite au Maroc. Puis, chargé de mission par l’UNESCO, il s’ embarque pour le Caire en 1953, après avoir écrit une étude ethnologique sur les sociétés de l’ A tlas, qui lui valut le doctorat ès-lettres et une élection au Collège de France.
Lorsque survient la Guerre d’ Algérie en 1954, Jacques Berque soutient la cause nationale algérienne parce que le pays avait «enfin osé revenir à lui-même, par une lutte ouverte.» C’ était pour lui un accomplissement inéluctable et même un exemple à suivre. Il prendra par la suite le parti de l’Indépendance marocaine et tunisienne, avant de s’ opposer à l’ agression de Bizerte en Tunisie déjà indépendante.
Berque ne s’ aligne pas ainsi seulement parce qu’ il aime les Arabes, comme il le dit volontiers, ni parce qu’il leur doit beaucoup, mais parce que la colonisation lui était apparue sous son vrai visage, celui de l’ hypocrisie et de l’ injustice, de l’ européocentrisme aveugle en regard duquel les cultures afroasiatiques étaient nommées «primitives» ou encore «réactionnaires».
Aux yeux de Jacques Berque, le soutien des pays colonisés se justifiait pleinement, afin que ces nations dites sous-développées, en réalité sous-analysées selon l’auteur, «prennent conscience de leurs potentialités, notamment humaines, et cessent d’ être méprisées par leurs propres fils.»
C’est à cette fin que travaille, nous semble-t-il, l’ œuvre de ce penseur. C’est donc par une parfaite connaissance de la langue de la sphère arabe que Berque entreprend d’ abord son investigation. Après quoi son champ de recherche s’ étend à l’ histoire, la sociologie, la littérature et les textes sacrés. C’ est enfin par une éblouissante traduction du Coran que l’homme parachève, il y a deux ans, une ample et pénétrante connaissance de la culture arabo-musulmane dont témoigne une œuvre d’un éclectisme illuminant qui, osons le dire, est salutaire guidance (pour employer un mot cher à l’auteur) pour le chercheur ou même le simple lecteur désireux d’ entrer en islamo-arabité.
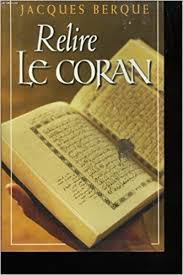
Mais nous ne parlons ici que des deux dernières publications de Berque parues cette année aux éditions Albin Michel pour Relire le Coran et chez Arléa pour Il reste un avenir.
Dans la relecture du Coran, fruit de la traduction citée plus haut, il est des études concises, claires et édifiantes sur la structure du texte sacré, ses thèmes, notamment ceux de la temporalité et de la norme, sans compter une analyse érudite et éclairante de la langue du livre des Musulmans.
Le lecteur apprend, par exemple, que l’ ordonnancement du Coran, si décrié comme chaotique, est celui de la construction en entrelacs et entrecroisements qui peut s’ observer sur un tapis maghrébin ! L ’ enchevêtrement des couleurs dans ces derniers est, dans le texte sacré, celui des thèmes. Car toute sourate est polythématique et tout segment de sourate est pluridimensionnel. De quoi il faut conclure que l’organisation formelle du Coran confirme, par sa complexité, que le livre sacré est un I’ JÂZ, c’ est-à-dire un «miracle» par le fait de son indiscutable «inimitabilité».
L’étude de la temporalité dans le Coran conduit par ailleurs l’auteur à s’inscrire en faux contre le préjugé courant concernant un prétendu immobilisme de l’islam et son fatalisme, idées incompatibles avec la notion de responsabilité. Ecoutons Berque à ce sujet: «L’homme mis sur la terre (…) aura à déployer une responsabilité qualifiante, et c’est par l’exercice de cette responsabilité qu’il accédera à la rétribution éternelle.»
L ’ étude de la forme conduit aussi à constater que le Coran ne contient qu’un seul verset en matière de droit civil. L’initiative en ce domaine étant laissée à l’effort personnel du croyant ou du savant-croyant (Fakîh). Cette latitude-là est observable en maints endroits dont le suivant, tiré de la seconde source de législation de l’ islam, le Hâdith ou parole du Prophète, où il est dit: «Lorsque tu (le croyant) n’ éprouves pas de sentiment de honte, agis à ta guise.»
Ajoutons que si l’islam fait la part belle à l’initiative de l’homme, ce dernier peut être enclin à abuser de son pouvoir à l’ instar du châtiment prétendument coranique de l’ apostase, et qui serait la mort selon Khomeiny.
Sur quoi repose donc un Fetwa (acte juridique) tel que celui requis contre Salman Rushdie ? La relecture du Coran par Berque et le retour au texte arabe nous apprennent très exactement ce qui suit: sur l’ apostasie, il est dit, sourate II, verset 217: «Qui d’ entre vous apostasierait et qu’il périsse en tant que dénégateur (sans avoir eu le temps de revenir à de meilleurs sentiments*), ceux-là leurs actions crèvent d’enflure dans le monde et dans la vie dernière.»
Voilà toute l’affaire ! On voit bien comment une interprétation outrageusement rigoriste peut conduire où l’ on sait.
Outre cela, le texte de Berque sur le Coran regorge de bien des trésors où, en ce temps d’ imbéciles et ignares intolérances beaucoup pourraient puiser à loisir.
Le second ouvrage de Berque est une sorte de credo actualisé, après celui de 1978, intitulé Arabies. Il y est fait de très nombreuses questions de société ou, simplement d’ humanité comme la définition de l’identité, de l’authenticité ou de la foi. Beaucoup de réflexions méritent qu’on s’y arrête et qu’on y revienne. Certaines nous appellent d’urgence comme l’ immigration à propos de laquelle Berque reconnaît que «la France est devenu un pays partiellement islamique» et que même, suivant en cela un de ses interlocuteurs, Berque ajoute qu’on pourrait parler, désormais, d’un islam gallican.
Signalons enfin la position de Berque sur la question palestinienne. Selon lui, la création de l’Etat d’Israël a été «un dédommagement consenti à un peuple (les Juifs) qui a souffert…». Cela eût satisfait notre sens de la logique «si l’ application de ce dédommagement ne s’ était opérée sur un peuple (les Palestiniens) lui-même créancier de l’Histoire», épargnant ainsi les vrais coupables !
En guise conclusion, qu’il nous soit permis de risquer un mot sur le regret que semble éprouver Jacques Berque quant à ce déficit de rayonnement personnel parmi les siens, auquel il fait parfois allusion. Qu’ attend- il de ceux (la France officielle) qui n’ auront peut être «jamais l’ idée d’ emprunter des analyses à un arabisant…?» Dans tous les cas leur attention serait négligeable, n’ayant reconnu ni la force de l’œuvre en tant que valeur esthétique, ni sa puissance de rayonnement dans le monde.
R. B. S.
* C’est nous qui ajoutons