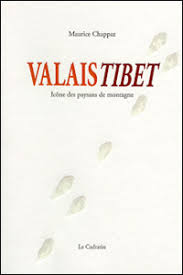Un chant de l’origine
À propos de Valais-Tibet, icône des paysans de montagne, de Maurice Chappaz,
par JLK
Plus Maurice Chappaz avance en âge et plus son écriture gagne en fluidité et en liberté, avec des ellipses et des fulgurances qu’on pourrait dire rimbaldiennes, ainsi que cela apparaissait notamment dans le fragment de son Evangile selon Judas en cours de composition que nous avons publié au début de l’année. Avant de découvrir l’entier de ce livre annoncé, nous avons reçu un nouvel ouvrage du très fécond octogénaire, superbement édité à l’enseigne du Cadratin et dont le sous-titre, Icône des paysans de montagne, annonce à la fois le propos et la substance.
Comme un Pierre Pascal se consacra naguère, en de plus grandes largeurs et plus «scientifiques », à rendre justice à la civilisation paysanne russe, Maurice Chappaz entreprend, dans ce récit à forte densité poétique, mais plein aussi de notations précises sur les composantes culturelles concrètes du monde dont il est issu (de la géniale invention des bisses, de laquelle il date sa propre origine, à la richesse des patois ou des savoirs culinaires, notamment), de rendre hommages aux paysans de montagne incarnant, selon lui, « l’origine des origines».
Si l’auteur des Maquereaux des cimes blanches rompt de nouvelles lances contre le progrès, il n’idéalise pas pour autant l’âpre vie des montagnards («il y a une sorte d’esclavage, de ghetto de la terre») dont il s’attache plutôt à évoquer le «grand rythme» lié à la fois à la terre et au ciel, dans une plénitude culturelle où la connaissance de la nature s’acquiert dès le bas âge et mot par mot, où les linguistes «relèvent dix mille termes patois pour recenser les détails de ce parcours sur le sol où se disputent plusieurs climats, les moindres ou les plus vastes éléments en réaction, en grignotements », où tout a un nom précis et un usage, une élégance acquise (de la courbure du pont à la texture des draps faits pour durer autant que les maisons) et un écho dans le temps (comme ces herses d’aubépines renvoyant aux paysans de Virgile), où « tout se transformait en vivres» et où «la clef de tout le réel était le travail », où la vie « se tisse avec de la misère (maîtrisée collecti-vement) mais qui brille par quelque chose d’intact et de vierge, une valeur en soi qui nous échappe».


Cette valeur n’est pas, bien entendu, le seul apanage du Valais catholique et apostolique : Chappaz en a retrouvé les signes visibles (visages ou gestes) en Turquie, et c’est tout naturellement qu’à un moment donné il cite cet autre «royaume-église» du Tibet qu’il a «juste frôlé aux premiers instants du meurtre», il y a trente ans, lors d’un voyage qui lui a permis de découvrir et d’aimer ce « dernier rucher» où retentissait l’« anabase des trompes » (« cela tenait du taureau et de la guêpe ») et qui se trouve aujourd’hui soumis à l’« empire laïc et totalitaire qui arrache, brise, rase ».
La question de la valeur de la vie, dans un sens communautaire, oriente enfin cette belle méditation lyrique, par opposition à tel constat : « La guerre aujourd’hui, je la vois dans le vide provoqué par l’abondance même. » Sans illusion «réactionnaire », Maurice Chappaz nous offre une belle et bonne image de ce qui compose cette valeur, avec une adresse ultime aux gens de partout et de tous âges, qui en élargit le partage.
JLK
Maurice Chappaz, Valais-Tibet, Icône des paysans de montagne, Le Cadratin, 62 pages.