Trois quidams
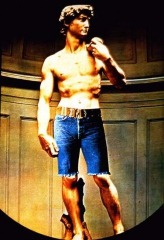
OVIDE
Pour Patricia
OVIDE était romain. Quand il était jeune, il habitait à Rome. Il aimait bien les belles filles qui passent le soir dans les rues, il les écoutait babiller avec un sourire en coin. D’ailleurs, il avait le plus souvent un sourire en coin.
Pour plaire aux filles, il écrivait des poèmes sur l’amour, et des fois il les récitait dans des clubs. ça avait l’air tout simple, mais en fait c’était très sophistiqué et les filles qui l’écoutaient avaient envie de rire, de pleurer, de l’embrasser et de lui tirer une baffe, tout ça en même temps, et elles se disaient « c’est bizarre qu’il me mette dans cet état avec son poème tout simple». Après, elles rentraient du club avec leur bon ami, et elles disaient «il est incroyable cet Ovide» et leur bon ami disait « moui, il n’est pas mal» et il se renfrognait un peu.
Quant il avait couché avec une belle fille, il passait à autre chose. Par exemple, il aimait bien regarder l’arc-en-ciel. Il y avait un truc qui l’épatait : il disait « là c’est vert, là c’est orange. Mais où est la frontière entre le vert et l’orange?» Et il avait beau la chercher des yeux, il devait se rendre à l’évidence, il ne la voyait pas, et il disait «ça m’épate».
Il a écrit un très très long poème qui s’appelle « Les Métamorphoses ». C’est un poème qui raconte toutes les histoires de la mythologie où des hommes, des dieux, des choses se transforment : Io changée en génisse, Daphné changée en laurier… Dans tout le poème, il y a comme des gouttelettes d’eau qui diffractent la lumière des mots; comme une rosée sur une toile d’araignée. Il y a plein de gens qui disent «Ovide est superficiel, il ne fait que des jeux d’élégance mondains ». Mais les métarmophoses, c’est un poème sur le monde qui change sans changer, comme les couleurs de l’arc-en-ciel.
A cette époque, la guerre civile était terminée depuis un moment et Auguste était empereur. Il s’y connaissait bien, en poésie, et il s’est dit : « je ne l’aime pas, cet Ovide. Il dit que le monde est subtil et qu’il change tout le temps. Moi, je suis empereur, je veux mettre de l’ordre dans le monde. Avec moi, tout est stable, clair, net, massif, solide.» et il a fait notifier à Ovide qu’il avait dix jours pour faire ses valises et aller déclamer ses poèmes au cul de la terre, au fin fond de l’Empire, sur les bords de la Mer Noire. Ovide n’avait pas le choix et il est parti. Il était très malheureux là-bas. Il a écrit une supplique à Auguste, qui a répondu «oublie». Ovide avait envie de faire des mots d’esprit dans les clubs et de lancer des oeillades aux belles filles qui babillent dans les cafés de Rome. Au fin fond de l’Empire, les filles sentaient l’oignon, elles avaient les mains calleuses et elles ne s’épilaient pas. Ovide se promenait des fois sur la plage et il chia-lait de rage.

RIMBAUD
J’ai fait la magique étude Du bonheur que nul n’élude (A. Rimbaud)
Rimbaud était trafiquant d’armes en Abyssinie.
Dans sa jeunesse, il avait été poète en France, mais tout ça était fini. C’était des poèmes d’enfant malheureux ou d’adolescent révolté, avec des lumières prodigieuses et des instruments de musique qui se mélangent aux vagues, des cadavres au milieu des fleurs et des blondes à gros seins qui vous servent du jambon. Tout ça en rimes. C’était avant.
Ce jour-là, Rimbaud était content, c’est-à-dire qu’il venait de gagner beaucoup d’argent. Accroupi, il regardait les dromadaires s’éloigner dans les dunes, et il s’amusait bien. Il n’avait pas été malhonnête, c’est-à-dire pas avec ses clients, mais ses clients, bien sûr, ils se posaient quand même la question. Les méharistes avaient l’air stressé. C’est surtout ça qui l’amusait.
Le char de Phébus, quant à lui, déclinait à l’Occident, et du coup l’éther s’empourprait. Rimbaud vida dans son petit verre ce qui restait de thé à la menthe à moitié froid dans la théière et s’alluma une cigarette anglaise piquée la veille à un gentleman qui bivouaquait dans la même oasis que lui.
Il avalait la fumée en fixant le dernier petit bout de Soleil qui se résorbait à l’horizon. Soudain, une joie sans mesure dilata sa poitrine. C’était jusque dans ses os, il en avait les larmes aux yeux. Il se laissa rouler en arrière, sa tête heurta doucement le sable, et devant lui il n’y avait plus rien que le ciel, et le sable déjà frais contre son occiput dégarni. Les yeux écarquillés, il cherchait en souvenir la sensation d’avoir tous ses cheveux. Tout paraissait si naturel à l’époque. Il cherchait en souvenir la sensation d’avoir les yeux bleus. La sensation de joie sans mesure s’était presque tout-à-fait dissipée.
Tandis qu’il cherchait, le ciel devenait comme plus transparent devant lui, profond et sombre.
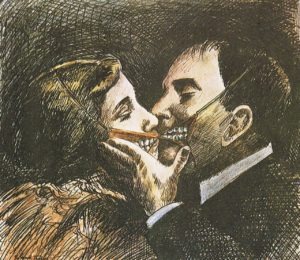
KEPLER
Pour Sophie
Kepler avait quatorze enfants. Son épouse était docile. Lui-même était mathématicien et astrologue. II avait la vue faible à cause d’une maladie qu’il avait attrapé quand il était petit. Il habitait à Würtemberg avec sa famille.
Kepler faisait toujours deux choses à la fois. Le matin, il mangeait un oeuf à la coque en se coiffant. Ensuite il faisait des cal-culs compliqués tout en réparant un bougeoir ou une casserole. Quand il avait des résultats, il allait les présenter à ses collègues. Il parcourait les ruelles soigneuse-ment pavées, longeait les murs des églises sobres et des maisons à colombages en jonglant avec des cailloux. Les enfants rigolaient. Les messieurs faisaient semblant de ne pas le voir. Les femmes se signaient ou collaient des gifles aux enfants pour leur apprendre à rigoler. Le pasteur, qui était très gentil, le regardait passer normalement. Quant à ses collègues astrologues ou mathématiciens, ils tremblaient d’excitation quand il venait les trouver avec son cartable en bandoulière, et sa réputation grandissait.
Un jour, un postillon lui remit une lettre de Bohème avec le sceau de Rodolphe II. Il la décacheta tout en trempant un morceau de galette au beurre dans de la confiture de framboises, puis il s’assit à son bureau et lut la lettre en tirant un solitaire aux cartes. C’était Tycho Brahe qui lui écrivait de Prague. Tycho Brahe était le plus grand astronome de l’époque. Il avait fait des observations qui prouvaient que les planètes parcouraient des routes qui ne correspondaient aux cal-culs de personne. Il avait besoin d’un géomètre d’exception pour interpréter ses observations. Tycho avait de bons yeux, mais il était moins bon mathématicien que Kepler. Les livres de Kepler l’avaient impressionné. Et puis sa santé déclinait; il n’avait pas le temps de tout faire.
Kepler fit part de cette lettre à son épouse tout en mettant en route le quinzième. Elle l’encouragea à accepter d’autant plus volontiers qu’il y avait à Würtemberg de plus en plus de catholiques qui jetaient des cailloux aux protestants, et elle n’était pas tranquille à cause des enfants.
A Prague, Tycho passait son temps à consigner dans des immenses registres toutes sortes d’observations sur les mouvements des astres. Il expliqua à Kepler comment lire ces registres et mourut en buvant du thé. Kepler remarqua vite que les résultats de Tycho allaient révolutionner la science. Que l’inefficacité de l’astrologie prédictive venait de ce qu’on n’avait pas su jusqu’alors calculer correctement la course des astres. De ce jour, il se consacra presqu’exclusivement à ce travail. Il faisait des modèles et des calculs du matin au soir. Il s’accordait seulement quelques pauses pour boire du thé et pour aller au culte. Le petit dernier nacquit. Quelques années s’écoulèrent. Kepler ne trouvait que des bribes de solution. Prague était une belle ville. Sa femme vieillissait. Le thé lui rappelait qu’il fallait faire vite.
Par un sec matin d’hiver, en allant au culte, Kepler eut comme une vision. Il se sentit tout vide, comme une membrane, et dedans comme dehors tout était froid. En lui, ses enfants étaient quinze astres dans la nuit de l’hiver. Cette pensée se mit à tourner sur une orbite elliptique. Dieu était un des foyers de l’ellipse. Un rayon de soleil glacial se répandit dans sa colonne vertébrale. Le parvis du temple pivota de trois-cent-soixante degrés autour de lui. Son âme accéléra. Ces impressions n’arrivaient qu’imparfaitement à sa conscience parce qu’il était en train de jouer un air sur son fifre.
F.B.
