Tout vocable est une moisissure
L’Italie profonde de l’oral à l’écrit, selon Carlo Emilio Gadda,
par Christophe Calame
Nous ne connaissons pas l’Italie. T out le monde peut aller s’y tremper les pieds, et s’asseoir au pied d’un palais pour manger une glace. Tout le monde peut prendre le train, passer muet devant les peintures, après avoir attendu son tour (les Japonais ont financé la restauration) et rentrer chez lui. Mais pour aller au-delà des quelques phrases utiles, il faut un guide, un cicerone, pour entrer quelque peu dans toute cette histoire de superbes et meurtrières cités, de monarchie tardive, de rodomontade fasciste, de république ratée. Bonheurs cachés et désastres collectifs sont déposés dans cette langue, qui n’est nulle part tout à fait la même. Pour ma part, j’entrerais en Italie profonde par les deux petits volumes robustes et denses des Romanzi et Racconti de Carlo Emilio Gadda.
L’ingegniere Gadda était un homme net et clair, capable de donner à ses jeunes collaborateurs de la radio les conseils les plus catégoriques: «Les idées s’enchaîneront l’une après l’autre selon un ordre clairement perceptible à l’écoute, comme des gens qui font la queue et montrent leur billet d’entrée les uns après les autres au gardien. Elles doivent être distillée au compte-gouttes, avoir un caractère d’écoulement». Mais ce sage Musil italien est aussi l’auteur des deux romans les plus alambiqués et baroques peut-être d’une littérature qui pourtant n’est pas en reste dans cet ordre de productions: L’affreux pastis de la rue des Merles (1957) et La connaissance de la douleur (1963). «Tout vocable est une moisissure… un prurit de plusieurs millénaires» dit aussi Gadda, qui n’a jamais voulu détourner son regard de ces démangeaisons nationales qui, avec le temps et les mauvais traitements, sont devenues des plaies ouvertes.
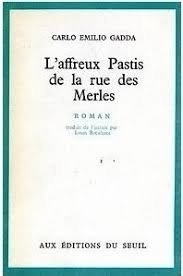
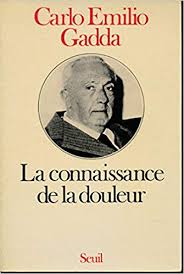
J’aime les auteurs dont il faut faire l’ascension. Notre siècle est laid, ses œuvres les plus fortes n’ont rien qui puissent «plaire immédiatement sans concept», hélas. Il faut donc savoir gravir lentement ses monuments littéraires les plus denses. La lecture des deux chefs-d’œuvre de Gadda doit se préparer. Pour certains auteurs, le commencement n’est rien; il n’en va pas de même pour Gadda. Commençons donc par le commencement: l’entrée en guerre, les combats des Alpins de 1917, la captivité. Les premiers textes publiés sont de 1934 (Le château d’Udine, Grasset), complétés maintenant par la récente traduction de l’important Journal de guerre et de captivité (Bourgois). On lira utilement ensuite les esquisses romanesques de La Mécanique, et de L’Adalgisa, puis les nouvelles comme La Madone des philosophes et Les colères du capitaine en congé libérable (ces derniers titres au Seuil), et, avant les deux grands romans, impérativement, l’extraordinaire essai sur la médiocrité et les mensonges du fascisme, Éros et Priape (Bourgois).
Jeune homme, Gadda est entré en guerre avec fierté, au service de cette jeune Italie dévoyée par les vieilles canailles littéraires comme d’Annunzio et les cinglés d’avant-garde comme Marinetti. En jeune officier des Alpins, il cherchait à échapper à la fois aux mensonges de la vie bourgeoise et à la névrose familiale, dans les jupes d’une mère veuve et abusive. Ce n’est pas trop dire que d’affirmer qu’il a cherché la vérité et la dignité dans le feu, bien conscient que «le feu tue» (comme Valéry félicitera le Maréchal Pétain de nous l’avoir appris, en le recevant à l’Académie française).
Gadda, en combattant les Autrichiens, a connu le froid, la boue, le danger et finalement l’humiliation de la captivité. Tout le Journal est fait d’interrogations anxieuses: pourrais-je dominer mes nerfs, mon humeur, mon corps ? ravitailler et abriter mes soldats, les soustraire aux ordres imbéciles ? bien placer mes mitrailleuses et les entretenir assez ? Le combat contre soi-même précède tous les autres. L’anxiété désabusée avec laquelle est tenu ce journal sans espérances n’a rien des jobardises futuristes, du ton des «automitrailleurs auto-décorés». Seul peut-être l’égale en dignité simple le début de L’Adieu aux armes.
Démobilisé, Gadda veut se guérir de ses doutes et de ses humiliations par la pratique des mathématiques et des sciences. Jusqu’à son entrée à la RAI, il gagnera sa vie comme ingénieur et pratiquera les philosophes dans ses loisirs (surtout Leibniz et Bergson). L’écriture vient lentement, comme une réconciliation difficile avec le désordre, le «pastis» comme on traduit la bien plus énergique expression de pasticciaccio…
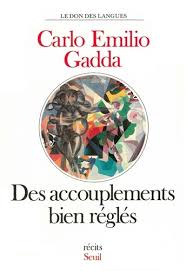
Pour décrire cet insondable indignité des choses sans ordre, Gadda cherchera un langage à sa mesure, surchargé et abâtardi, sensuel et ordurier, mais jamais glapissant ni geignard contrairement à Céline, le langage du Quel pasticciaccio brutto de via Merulana qui est une grande enquête policière hilarante sur les dessous de la bourgeoisie romaine. Restait alors à dire la souffrance des maisons trop grandes, des destinées fermées, des sociétés étriquées, par un langage plus dur et moins mimétique, celui de La Cognizione del dolore où Gadda rejoint en profondeur Leopardi et Svevo dans le tragique.
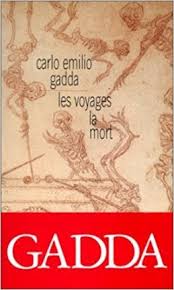
Dans un texte bref que l’on trouvera traduit dans l’un des deux indispensables numéros italiens (celui de 1987) de la précieuse et illuminante revue annuelle de Gérard-Georges Lemaire, L’Ennemi (Bourgois), Gadda parle longuement de la beauté et de la sobriété de l’architecture moderne. Il lui reproche cependant de ne pas remplir sa fonction, en refusant le repos à ses pauvres locataires. Trop sonore, la maison moderne propage la trivialité de l’existence familiale, idiosyncrasique, physiologique, la rend publique au lieu de la cacher. Des structures parfaitement économiques, même parfois admirablement conçues et réalisées, mais toujours sans proportions avec le pasticciaccio humain, lequel n’aura justement jamais aucun rapport avec rien. On peut en rire ou en pleurer… et puis en faire deux grands livres très différents. C’est là ce qui restera de ce que fut ici-bas l’expérience de Carlo Emilio Gadda, officier et ingénieur italien.
Ch. C.
Carlo Emilio Gadda, Romanzi e racconti I et II, Garzanti. Journal de guerre et de captivité, Bourgois, 1993. L’art d’écrire pour la radio, coll. «Le corps éloquent», Les Belles Lettres. V oir aussi : Gian Carlo Roscioni, La dysharmonie préétablie, Seuil.
(Le Passe-Muraille, No 9, octobre e 1993)


