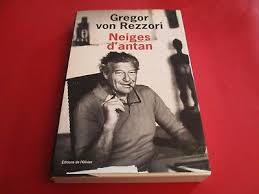Solitude du témoin
Un entretien avec Gregor von Rezzori,
par Christophe Calame
Le siècle tire à sa fin, et nous le comprenons de moins en moins subtilement, tout en le jugeant de plus en plus sévèrement, bien sûr. Mais cela n’est pas récent. Le siècle s’est ralenti en 1945, puis arrêté définitivement en 1989. Parce que nous n’imaginons encore rien du suivant, au fond, nous nous occupons encore un peu du présent. Mais les esprits sont ailleurs, on le sent. Ils s’évadent, manifestement ou subrepticement: Antiquité, Moyen Age, Lumières, tout fait rêver sauf le XXe siècle. Pourtant ce siècle n’est pas fini, et sans doute, à la manière des longs voyages, ne finira-t-il jamais: la mémoire des témoins et le désir œdipien de comprendre ce qui s’est passé aux origines de nos destinées, tout nous ramènera à l’énigme du siècle: ne fut-il vraiment qu’«une passion inutile», lui aussi ?
Dans l’Europe contemporaine, la littérature allemande plus qu’une autre est vouée à l’Histoire. L’intrusion traumatique de la vie publique dans la vie privée contraint le roman à s’expliquer avec le siècle. Gregor von Rezzori est le romancier des destins biaisés, détournés, brisés par les événements. Le paysage social qu’il rassemble offre une ampleur digne de Tolstoï. La complexité des personnages, leur névrose, leur férocité, tout nous renvoie à la nature des personnages russes. Pourtant leur comportement est lisse, policé, élégant: ils traversent les orages avec dandysme, avec détachement, resserrant en eux-mêmes les émotions violentes. Ils succombent avec dignité, aussi bien dans la vérité que dans l’erreur. Une œuvre qui reste à découvrir, pour les francophones.
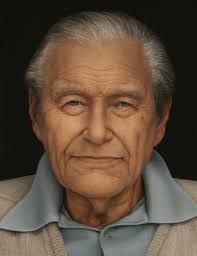
– Quelle est la part de l’autobiographie dans vos romans ?
– Neiges d’Antan est la biographie des cinq personnes qui m’ont fait, c’est donc dans une certaine mesure le seul livre autobiographique que j’aie jamais écrit, mais les autres livres contiennent quand même des éléments vécus. Je suis né dans un grand pays qui appartenait à la couronne des Habsbourg, la Bucovine, qui n’existe plus car elle a été partagée entre la Roumanie et l’Ukraine. Je suis donc né sujet des Habsbourg, avant de devenir Roumain par conquête. Il faut dire que nous n’étions pas autochtones. Mon père y était employé de la double monarchie. J’ai beaucoup aimé la Bucovine et surtout sa capitale Tchernowitz avec tous les divers peuples qui y cohabitaient. Une véritable macédoine !
» J’y suis resté jusqu’au moment où l’on m’a envoyé à l’école en Autriche. J’étais donc citoyen roumain jusqu’en 1940, où j’aurais dû devenir citoyen russe à cause du «don» de la Bucovine à l’Union soviétique, mais je suis devenu apatride, ce qui m’a sauvé la vie, car personne ne m’a réclamé sous ses drapeaux. Pour combattre, il aurait fallu que je rentre volontairement en Roumanie, et que j’en réclame la citoyenneté. Beaucoup d’héroïsme pour rien ! Contrairement au personnage de mon roman, je n’ai pas eu beaucoup de succès dans les scénarios pour le cinéma allemand de l’après-guerre. J’ai travaillé pour la radio de Hambourg, sous contrôle britannique, et c’est à ce titre qu’on m’a envoyé pour couvrir le procès de Nuremberg. Mais tant d’années en Allemagne, cela suffisait. Je suis donc parti pour Paris, puis pour Rome. Je me suis ensuite fixé en Italie, avec gratitude.
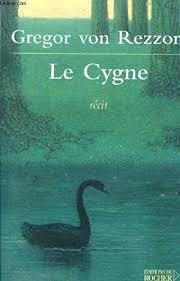
– Est-ce que vous vous sentez appartenir à une nation européenne ?
– Oui. Après la guerre, je suis resté apatride pendant presque quarante ans, même pas avec un passeport Nansen. C’est très agaçant, on passe son temps à la préfecture. Un jour, j’ai demandé au chancelier Kreisky un passeport, ce qui a été fait. Depuis lors, heureux de cette identité, je suis Autrichien. Civis romanus sum, même s’il n’y a plus d’Empire ! Un romancier comme Roth était, lui, un vieil Autrichien, mais moi j’étais trop petit pour me souvenir: je ne peux pas être nostalgique. Il est inutile de se demander si ce grand Empire aurait pu résister: il était peut-être magnifique, mais il n’a pas tenu, voilà tout.
– Et la littérature autrichienne ?
– Vous savez, on ne rencontre pas forcément ses ancêtres dans la littérature. Pour moi, je me sens bien plus proche de Nabokov que de Werfel, par exemple. Musil a entrepris de dire tout ce qu’il fallait dire sur l’Autriche, mais il n’a jamais fini son livre. J’ai lu le dernier livre de Handke, Mein Jahr in der Niemandsbucht, que je tiens pour le plus grand livre allemand de cette époque. Seul Handke peut faire tant de choses avec une langue si simple. Je ne vois pas dans ce livre la nostalgie dont on l’accuse. Je crois que tout lecteur de bonne foi et sans prévention ne peut que lui donner raison pour ce qu’il affirme vraiment.
» Le premier livre de moi qui a quelque peu attiré l’attention des Allemands, c’était les histoires du pays du Couchant, l’Occident. En allemand, cela s’appelait Maghrebinische Geschichte, parce que le Maghreb veut dire l’Occident en arabe. Ce livre devait être le miroir de l’Occident dans un pays imaginaire. C’est une collection de blagues, de fables, d’anecdotes dont certaines sont anciennes et appartiennent justement à ce monde perdu de mon enfance. Ce livre, paru chez Rowohlt en 1947, a été un vrai succès. Puis Œdipe à Stalingrad qui racontait Berlin avant-guerre. Puis je me suis mis pendant quinze ans à écrire cette brique, La Mort de mon Frère Abel, qui est paru en allemand, il y a vingt ans. J’en avais écrit des parties en anglais, puis je l’ai retraduit moi-même.
» En français, mon premier livre traduit fut Mémoires d’un Antisémite, à l’Age d’Homme. Dans ce livre également, deux chapitres avaient été écrits en anglais. Comme langue, l’allemand est un des grands miracles de l’humanité. Mais c’est une langue très dangereuse pour un écrivain, parce qu’elle est séduisante et qu’elle tente de vous perdre dans ses possibilités qui vont beaucoup plus loin que ce que vous aviez imaginé avant de commencer à écrire. L’anglais est précis, didactique, discipliné. L’anglais est aussi pour moi une langue d’enfant: je me suis imaginé avoir reçu une éducation à l’anglaise à cause de gouvernantes anglophones, qui venaient plutôt de Smyrne que d’Angleterre, d’ailleurs.
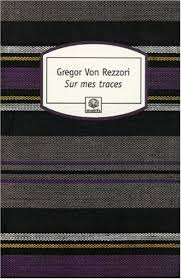
– Votre expérience du siècle peut-elle être comprise par les générations qui viennent ?
– Je suis en train d’écrire à nouveau une sorte d’autobiographie sur mon chemin dans ce siècle, et je suis confronté tous les jours à cette difficulté. Quand je me suis mis à décrire la journée de l’Anschluss de 1938 à Vienne, je me suis aperçu qu’il était très difficile d’en faire comprendre l’atmosphère à un jeune homme d’aujourd’hui. Comment expliquer que cette annexion était souhaitée par beaucoup de gens ? Pour les germanophones qui avaient grandi dans un pays balkanique, le nazisme vu de loin était malheureusement plein de promesses. Impossible d’accuser quelqu’un qui n’était ni un juif, ni communiste, ni royaliste, d’y avoir succombé à ce moment-là. Leni Riefenstahl, par exemple, avait mis en scène la «chorégraphie» de cette époque de manière irrésistible. Même les adversaires du nazisme et les communistes étaient obligés de s’inspirer d’elle.
» L’un des inconvénients d’avoir survécu à une période aussi dangereuse de l’Histoire, où l’on aurait pu être tué aussi bien par un camp que par l’autre, c’est qu’on risque de déplaire à tout le monde. Bien sûr, je pourrais raconter ce que je veux. Mais j’essaie d’être un témoin de mon temps, de mon époque, et rien d’autre. Il faut que je vous dise que je suis un admirateur de Jean-Jacques Rousseau. Je trouve que les Confessions, c’est la vraie forme de la littérature, de la prose. On ne peut plus inventer des choses. On peut mentir, on peut raconter des choses fictives. Mais sans se retirer, en se donnant soi-même. Alors pourquoi des personnages ? mais ce sont des marionnettes, pour le théâtre, pour le dialogue. C’est une condition technique de la littérature, rien de plus.
Propos recueillis par Christophe Calame
(Le Passe-Muraille, Nos 27-28, Décembre 1996)