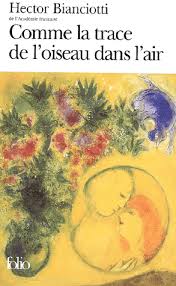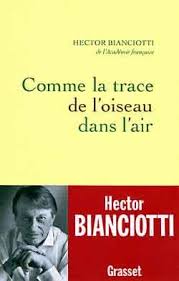Retour à la maison d’enfance
En lisant Comme la trace d’un oiseau dans l’air d’Hector Bianciotti,
par Claire Julier
C’est le soleil qui fait éclore la rose, puis la meurtrit.
Quel plaisir de retrouver des mots qui ne sont que rarement prononcés et qui prennent sous la plume d’Hector Bianciotti toute leur saveur. Et le plaisir se double de l’émotion de lire celui qui continue de découvrir et d’aimer une langue qui n’est pas sa langue maternelle, qui cherche le mot juste même s’il est tombé en désuétude ou s’il a un goût précieux.
On entre dans la petite musique d’Hector Bianciotti déjà avec le titre de chacun de ses livres et leur poésie en demi-teinte. Il attise notre sensibilité dans ce qu’elle avait d’assoupi par l’indigence du langage actuel.
Les retrouvailles en Argentine avec ses frères et sœurs après plus de vingt-cinq ans «d’un éloignement touchant déjà à l’absence» pourraient se faire à petits pas nostalgiques et par l’évocation de souvenirs au parfum de chrysanthèmes. Pour l’écrivain, «les retours en arrière n’ont pas partie liée avec la réalité, mais avec la fable». Ils deviennent méditation lente sur la mort, mort vue non comme une décrépitude mais comme une page tournée sur un destin que nos désirs a entre-tissé heure après heure, malgré la peur, «cette peut animale qui, comme l’amour ou la foi, ignore sa propre cause».
L’entrée dans le vrai monde prend la forme du récit de la naissance de deux jumeaux liés à son enfance, «sortis à la lumière sans difficulté, comme pressés d’accomplir une prouesse. Ils étaient délivrés, mais déjà capables de s’indigner de leur chute dans l’abandon, pour toujours loin de la tendresse absolue». La mort des autres nous renvoie toujours à nous-mêmes et à cette longue quête de soi.
Lors du voyage argentin, la mé-moire revit en désordre des épisodes réels et éphémères – comme la trace de l’oiseau dans l’air – pages de vie intime qui ont blessé au cœur et font toucher de la pointe du doigt le tangible de la vie. La vie ne se ressent vraiment, dénuée de toute illusion, qu’à l’écoute des mots cueillis sur les lèvres d’Hervé Guibert disant de sa maladie «qu’elle donnait le temps de mourir et qu’elle donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir enfin la vie» ou dans l’accompagnement des dernières heures de Borges, heures où l’accompagnant s’efface en laissant le mourant abîmé en lui-même, ravi au temps.
Hector Bianciotti retient parfois – au fil de sa rêverie – des images qui le poussent à s’interroger encore et encore sur l’importance de la vie. Ne sommes-nous pas des êtres imaginaires que seule la souffrance – la souffrance physique – renvoie à la réalité ? Une question qu’un enfant d’immigrés piémontais, poussé par la haine de la terre, de cette pampa qui n’est qu’horizon, se posait déjà et qui, alors qu’il est devenu homme, avec la distance et un brin de lassitude devant la vanité des mots, se prolonge en lui. L’enfant ne «craignait pas les ronces, ni les plaintes de cet animal douloureux, le corps» et proposait à l’adulte en devenir une destinée sans repos.
Cet enfant qu’il a été, Hector Bianciotti l’écoute aujourd’hui charmé par son appel. Tous deux réconciliés peuvent au moment «où la nuit prend le jour par la main écouter la plaine où le temps s’écoule».
C. J.
Hector Bianciotti, Comme la trace d’un oiseau dans l’air, Grasset, Paris, 1999, 233 p.