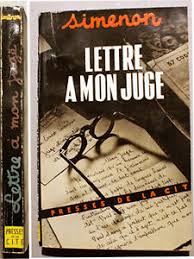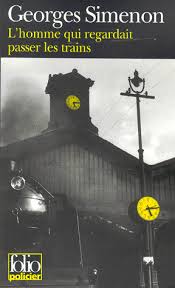Quelque chose d’infini
À propos des « romans durs » de Georges Simenon
par JLK
On revient à Simenon comme à un doux poison dans lequel se dilueraient autant le malaise et le bien-être que le mal et le bien, car c’est à la fois du physique et du métaphysique qui nous ramènent à ses livres assurément très inégaux de densité mais tous marqués par cette étrange vertu thérapeutique qui nous fait nous sentir bien sous la pluie qui mouille et dans les ténèbres du cœur humain, au fond desquelles luit la vague lueur de quelque chose d’infini.
Robert Brasillach ne voyait dans les personnages de Simenon que des « abouliques et des malades, aux savates traînantes, le long de trottoirs gras, un soir de pluie », et nombreux sont les lecteurs cravatés qui ne veulent pas même entendre, ni voir, la voix non plus que la chair nue de cette humanité pantelante qui ne se plaint ni ne s’extasie, comme si la peur de la peur la plus élémentaire relevait d’une misère indigne d’eux et d’une littérature « noble » dont les héros, selon le mot de James, pensent en majuscules et sentent en italiques. De la même façon, les personnages de Dostoïevski furent souvent tenus, par les mêmes littérateurs décents, pour des hystériques et ceux de Tchekhov pour des pâtes molles, et ne parlons pas des névrosés processionnant dans l’univers cafardeux d’une Patricia Highsmith, dont l’atmosphère dépressive me semble receler les mêmes vertus paradoxales, à caractère homéopathique, qui agissent à la lecture du Songe d’un homme ridicule de Dostoïevski ou de la Salle 6 de Tchekhov, de La neige était sale ou de Lettre à mon juge.
Plus que de Balzac dont on le rapproche pour de mauvaises raisons, alors qu’il en est de meilleures que le nombre de tasses de café et le nombre de pipes ou de femmes consommées, Simenon fait partie de la famille des enfants déçus qui se racontent, le soir, de terribles histoires pour s’encourager avant de somnambuler. On pourrait y voir quelque perversité, et sans doute y en a-t-il aussi, mais surtout il y a là je crois la conséquence de l’esprit de conséquence qui fait de l’enfant cet accusé perpétuel et ce juge implacable. Vous croyez l’enfant naïf, mais on ne la lui fait pas. L’encravaté en vous peut bien se dire que «c’est de son âge» et que « ça lui passera » : l’enfant en vous sait que ce n’est pas vrai.
Il faut lire et relire Lettre à mon juge pour mieux saisir la nature du noyau tendre des « romans durs » de Georges Simenon, dont une vingtaine de titres au moins devraient être cités « pour introduction», et dont je ne distinguerai par préférence personnelle que les récits de rupture existentielle et sociale de L’homme qui regardait passer les trains et La Fuite de M. Monde, les romans « africains» du Coup de lune et du Blanc à lunettes, le roman noir à fine lueur d’espoir de Feux rouges, le tableau balzaco-ber-nanosien du Bourgmestre de Furnes, la vertigineuse plongée dans le mal, sous l’Occupation, de La neige était sale ou, pour revenir da capo, Lettre à mon juge…

C’est l’histoire d’un médecin de famille qui pourrait sortir d’un récit de Tchekhov, qui a fini par étrangler la seule femme qu’il aimait vraiment comme le ferait un personnage de Dostoïevski, et qui s’attache patiemment à prouver, au juge d’instruction qu’il estime son frère humain le plus proche, qu’il n’est ni le monstre « à tête de crapaud» que décrivent les journaux, ni l’irresponsable que ses avocats et ses psychiatres voudraient justifier pour sauver surtout les apparences et les convenances d’une profession dite libérale.
La première femme de ce criminel intéressant était la Douceur incarnée, la seconde la Dignité même, et sa mère l’Humilité même. Son père buvait et courait les jupons du canton avant de se juger lui-même d’un coup de fusil. Or, avant de passer « de l’autre côté», comme tous les personnages de Simenon qui vont « jusqu’au bout» et rejoignent ainsi les criminels intéressants de Patricia Highsmith, Charles Alavoine a entrevu « quelque chose», au côté de son père, qu’il a cru retrouver dans les bras d’une première inconnue et qu’il ne retrouve ni auprès de la Douceur, de la Dignité, de l’Humilité, ni non plus dans les bras de la Passion qu’incarne celle qu’il étrangle finalement, passant alors « de l’autre côté».
Evoquant les vices de son père, Alavoine écrit à son «double» respectable ces mots décisifs : «Je ne vous dirai pas que ce sont les meilleurs qui boivent, mais que ce sont eux, à tout le moins, qui ont entrevu quelque chose, quelque chose qu’ils ne pouvaient pas atteindre, quelque chose dont le désir leur faisait mal jusqu’au ventre, quelque chose, peut-être, que nous fixions, mon père et moi, ce soir où nous étions assis tous les deux au pied de la meule, les prunelles reflétant le ciel sans couleur. »
Simenon disait, un jour, qu’il eût aimé écrire comme Jean-Sébastien Bach, pour reconnaître aussitôt qu’il était très, très loin de cet idéal. Du moins cet aveu en dit-il long sur ce « quelque chose» que, confusément, dans le brouillard et le bruit du monde, ses personnages cherchent à retrouver.
JLK