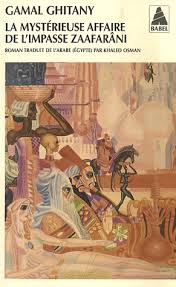Pour lire Gamal Ghitany
À propos de trois romans de l’ auteur égyptien – à découvrir impérativement,
par Jil Silberstein
Romancier, nouvelliste, chroniqueur, directeur de l’hebdomadaire égyptien Akhbâr aladab (Les Nouvelles littéraires), Gamal Ghitany n’a pas attendu que Mahfouz reçoive le Prix Nobel de littérature pour lui rendre hommage. En tête des entretiens qu’il consacre à son aîné, il confesse: «Il a contribué à ma formation intellectuelle, il incarne l’un des fondements de ma perception. Certaines de ses idées ont éveillé dans mon esprit un puissant écho. De lui, j’ai appris la persévérance, le dévouement sans limite de l’artiste à son art».
Pareil empressement laissera-t-il penser que Ghitany n’est qu’un des épigones gravitant autour du «père de la littérature égyptienne» ? Après Zayni Barakat et Epître des destinées – deux ouvrages précédemment traduits en français – La Mystérieuse Affaire de l’Impasse Zaafarâni donne au contraire la mesure d’un écrivain prodigieux n’ayant plus grand-chose à envier à l’auteur du Passage des Miracles. Trois livres et trois chefs-d’œuvre, en pesant bien ce mot… le phénomène vaut qu’on s’y arrête.

Qu’est-ce donc qui rend les récits de Ghitany inoubliables et exemplaires ? Une singulière alliance entre diverses qualités en elles-mêmes décisives et qui, conjuguées à un certain niveau d’incandescence, donnent au lecteur la sensation de participer à un événement inouï. Commençons par la forme. Ghitani est un conteur ensorcelant, capable d’épouser n’importe quel genre littéraire pour rendre plus efficace son intrigue. Ainsi, dans un même livre n’hésite-t-il pas à passer de la narration conventionnelle au mémorandum de police, au journal intime, au style fiche d’état-civil, au compte rendu journalistique, à la dépêche d’agence, au rapport griffonné par un mouchard… voire à la complainte populaire. Tout lui est bon pour faire insensiblement passer – comme dans La Mystérieuse Affaire… – du long sourire hilare (un record de durée !) à une sensation de catastrophe universelle, ou – comme dans Zayni Barakat – d’une féerie genre «Mille et Une Nuits» à l’angoisse la plus folle.
Ensuite, Ghitany n’hésite pas à s’attaquer, avec autant de réussite, à des univers aussi radicalement éloignés que le roman historique, la chronique contemporaine d’un quartier ou l’évocation d’«exilés économiques» se consumant loin de chez eux.
La force d’amour que l’auteur nourrit à l’endroit des petites gens – celle qui rayonne tandis qu’il décrit des ruelles trépidantes de vie, d’apostrophes, d’altercations publiques, de rires et de sensualité – contribue à renforcer la tension éprouvée en cours de lecture. Liée à un sens psychologique suraigu, à des plongées vertigineuses dans l’intimité de personnages disjonctant au terme de trop longues frustrations, cette qualité émotionnelle débouche parfois sur ce qui fait le génie d’un Dostoïevski. Pour couronner le tout et donner à cette œuvre sa dimension testamentaire: une conscience sociale et politique exacerbée, la rage civique de qui adore son pays, se bat pour son redressement, le voit basculer dans l’avilissement, dans l’asservissement à des pratiques totalitaires, et qui lui crie: réveille-toi ! reprenons-nous en main !
Zayni Barakat ? L’histoire, terrifiante, d’une concentration de pouvoirs au XVIe siècle, époque où les mamelouks sèment la terreur au Caire: celle qu’opère, à coups d’intrigues, de corruption et de démagogie, un Grand Censeur au diabolisme d’autant plus redoutable qu’il se pare des saintes paroles du Prophète. Epître des Destinées ? La dérive de tous ceux que la tyrannie de l’argent et des biens de consommation pousse à trahir l’esprit de leurs ancêtres… et parfois à courir leur chance dans certains «pays frères» où ils découvrent, à leurs dépens, jusqu’où peut pervertir le culte de la personnalité quand il conjugue – là encore – vénérables sourates et frénétiques ambitions.
Quant à La Mystérieuse Affaire de l’Impasse Zaafarâni, elle nous dévoile comment, frappant les hommes d’impuissance et forçant un quartier à bouleverser ses habitudes, un cheikh paralytique s’emploie, au nom du Très-Haut, à châtier les créatures de péché qui peuplent l’univers. Au total, autant d’avertissements constituant, sous une forme à peine transposée, une magistrale radiographie de la société égyptienne actuelle.

Gamal Ghitany appartient à cette génération qui voit surtout en Anouar el-Sadate, «héros» des Accords de Camp David et Prix Nobel de la paix assassiné, l’instrument d’une régression catastrophique pour son pays. La trahison de la fierté nationale incarnée par Gabal Abdel Nasser et par Saad Zaghloul – ce patriote qui, en 1922, après trois ans d’émeutes populaires réprimées dans le sang, offrit au pays de devenir autre chose qu’un champ de coton pour les filateurs de Manchester (S. Lacouture, Egypte, Seuil 1984). Non que le dirigisme autoritaire de Nasser, rompant avec l’esprit démocratique de Zaghloul, ni que sa manière d’entraîner la nation dans une guerre désastreuse contre Israël, aient été épargnés par les critiques ! Mais en rompant avec les bailleurs de fonds occidentaux (quitte à se rapprocher des Soviétiques) et en lançant une audacieuse réforme agraire assortie d’un colossal effort d’industrialisation, le Raïs a offert à la jeune république un exemple de détermination, d’indépendance et de courage. Dans un pays sortant de siècles d’asservissement, c’était beaucoup.
Voilà pourquoi, aux yeux de Ghitany, de Latifa Zayyat, de Sonallah Ibrahim et de tant d’autres intellectuels, le libéralisme de Sadate ne pouvait que trahir l’effort de tout un peuple. Car quelles auront été les conséquences du rapprochement avec les Etats-Unis et les pays arabes pétroliers, ou de l’allégement des contrôles économiques – manœuvres visant à attirer les capitaux étrangers ? Le triomphe des spéculateurs. L’explosion des prix. L’aggravation de la corruption. L’enrichissement des plus riches. L’obsession de la consommation. La suppression de subventions aux denrées de base. L’accroissement de la pauvreté dans des quartiers laissés à l’abandon parce que impropres à engraisser quiconque. L’agonie de la solidarité du peuple égyptien. L’exacerbation des frustrations et des ressentiments… autant de plaies qui favorisent ces temps la progression de l’intégrisme. De ses mots d’ordre simplistes et radicaux. De sa mainmise sur les consciences. De son retour à un illuminisme fanatique, totalitaire, ayant de quoi mobiliser la vigilance d’une intelligentsia traditionnellement accueillante, tolérante – celle qu’emblématise le lumineux et fraternel Naguib Mahfouz.
J. S.