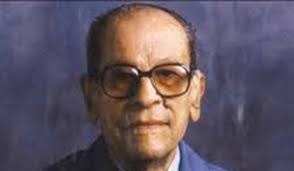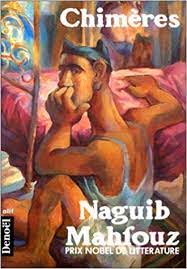Naguib Mahfouz le médium égyptien
À propos (notamment) de la tragique relation à la femme dans l’univers arabe-musulman,
par Rafik Ben Salah
Au début de ce siècle où se situe la naissance de Mahfouz, l’Egypte s’interroge sur son avenir. Elle se remet de l’agression britannique de 1882 après avoir souffert le joug ottoman et bien d’autres avant lui. La pensée y oscille entre le retour aux strictes lois islamiques, comme l’exigeaient les Frères Musulmans dès 1928, et une pensée libérale puisant aux sources de la richesse des civilisations que l’Egypte a su absorber.
Naguib Mahfouz est de cette dernière mouvance, puisqu’il adhère au parti Wafd, porteur des projets de la haute et moyenne bourgeoisie, à laquelle il appartient. L’affiliation à ce parti lui vaut d’ailleurs l’amputation volontaire de son nom à consonance copte, peuple ennemi du Sérail de l’époque — le vrai nom de Mahfouz étant Naguib Mahfouz Abdelaziz As-Soubailagy.
C’est après une licence en philosophie que Naguib Mahfouz assume diverses responsabilités dans l’administration égyptienne et collabore à nombre de publications, tout en rédigeant des scénarios pour le cinéma. Il est, à ce titre, le premier écrivain arabe à écrire pour le 7e art. La boulimie créatrice de Mahfouz n’a d’égal que son acharnement à la lecture, touchant des auteurs aussi divers que Proust, Kafka ou Dostoïevski. Mais la filiation littéraire de Mahfouz reste principalement arabe. On le sait grand lecteur des auteurs allant de l’époque ante-islamique, aux réalistes contemporains dont il est, à notre avis, le principal représentant. Les autres, tels Taka Hussein ou Al Hakim, se sont moins illustrés dans le roman.

Le réalisme de Mahfouz est méticuleux, obsessionnel, touchant aux plus secrètes banalités de la vie, de l’alcôve close à la ville éclatée. Ses thèmes ignorent le tabou, fût-il sexuel — le plus rigoureux en terre d’Islam. C’est aux personnes d’humble condition que Mahfouz voue son attention. Elles sont données à voir dans leurs intimes délibérations comme dans leurs parades artificielles, notamment dans Impasse du M’dak ou dans Fils de notre quartier, auxquels va notre préférence.
Mais c’est aussi dans le milieu de la bureaucratie, petite ou grande, que Mahfouz est entré sans effraction. Ses personnages hantant la fonction publique sont pléthore. Ils sont aisés et indignes, parfois petits et louables, très souvent doués d’une haute faculté d’introspection, héritée de l’auteur. Ils sont spéculateurs et arrogants, obscènes et ambitieux, irritants toujours, aimables rarement; on les trouve décrits admirablement dans Le Nouveau Caire, notamment.
L’administration donc, les rues et les impasses, mais surtout le coeur des hommes, ses turpitudes et ses élévations, ses luttes et ses défaites: cela surtout est l’objet de Chimères, paru en français cette année, mais dont l’édition originale remonte à 1948.
A cette époque-là, Mahfouz est âgé de trente-six ans et il est marié. La terrifiante histoire qu’il conte dans Chimères n’est donc apparemment pas la sienne. Mais qu’importe ? La littérature n’est-elle pas ce par quoi, selon certains réalistes égyptiens, l’être se transporte de son monde à celui de l’écrivain; ce par quoi l’écrit fait s’évanouir l’être conscient en nous, pour en éveiller un autre, inconscient ?
Chimères est une très longue confession sans confesseur, ni psychanalyste — le narrateur assumant les deux fonctions tour à tour.
Si le narrateur Kamal n’est pas l’auteur, il lui ressemble par bien des traits, déformés: le teint clair, l’oeil vert ou l’extrême lenteur dans l’acquisition de ses diplômes. Peut-être la «très sincère aversion pour l’école» est-elle le lot des deux, narrateur et auteur…
Kamal narre donc l’histoire, fort simple, mais tragique de bout en bout, d’un jeune garçon séparé de son père alcoolique (responsable de la séquestration légale de ses deux premiers enfants) et vivant avec sa divorcée de mère chez son grand-père maternel, officier à la retraite et joueur invétéré, visible à l’aube de chaque jour seulement.
Kamal est, auprès de sa mère, le substitut adulé des enfants séquestrés et du mari rêvé. Il est si choyé que, lâché parmi d’autres enfants, il se montre incapable de communiquer, provoquant railleries cruelles, violences verbales ou physiques.
Le narrateur va ainsi son chemin, cahin-caha, jusqu’à décrocher son baccalauréat à 25 ans. Au cours de rhétorique abhorré, il refuse d’obtempérer aux injonctions du professeur le sommant d’improviser un discours. Ce jour-là s’achève la carrière universitaire de ce timoré exemplaire, qui s’en va gratter le papier dans quelque ministère, au plus bas niveau de l’échelle.
Dès lors Kamal a tout loisir de contempler une jeune voisine, posté à la station du tramway, en face de la maison de la jeune fille. Le guet dure deux ans, malgré une rencontre quotidienne dans le tram où, il est vrai, hommes et femmes occupent des compartiments séparés.
Le père de Kamal meurt et, à la tête d’une rente confortable, le jeune homme peut enfin demander la main de sa dulcinée. Elle lui est accordée. La nuit de noces est un désastre ajouté aux calamités des formalités du mariage. Le marié se découvre impuissant, tant il avait idéalisé la femme, lui-même étant vierge à vingt-huit ans et se demandant comment sa «pure et vertueuse aimée» pouvait être la proie de cette «passion sauvage»… «Je ne pouvais imaginer chose plus odieuse», ajoute Kamal, qui s’étonne encore de son impuissance. A partir de là, le narrateur sombre dans le désespoir. Ni l’alcool, ni sa virilité retrouvée dans l’adultère ne lui rendent sa sérénité. Sa femme se détourne de l’amour physique, prenant à ses yeux une plus-value mystique, jusqu’au jour où il la surprend en train de lire une lettre qu’elle s’empresse de déchirer et de jeter par la fenêtre. La suite est une suc-cession de drames dignes des meilleurs polars dont Mahfouz est friand. Ces événements méritent le plaisir de la découverte.
Si les Chimères (nous préférerions le titre de Mirages) sont évocatrices de pensées morbides, spéculations troublantes, incertitudes maladives et désir perpétuel de fuir ses responsabilités, le livre de Mahfouz est tout cela. Toutefois, ce qu’il nous paraît urgent de faire connaître, à travers le livre, c’est l’extraordinaire complexité du rapport de l’homme à la femme en terre d’Islam.
Dans Chimères, la relation du narrateur à sa mère est vécue comme l’effusion castratrice d’un amour invalidant. De là, Kamal (la complétude en arabe) s’en remet à son seul imaginaire, idéalisant à l’excès sa future femme, à qui il met deux ans pour dire bonjour ! Comment dès lors peut-il reconnaître en sa compagne un être humain ordinaire ? L’abstinence forcée et la trop stricte séparation des sexes en pays arabo-musulmans sont, selon nous, responsables de l’incapacité des hommes à voir que la femme n’est ange ni démon, fée ni catin.
Cette thématique donne lieu à une interminable succession de phases extensives des sentiments, joies factices, suivies de phases récessives, remords et regrets, défaites imputables souvent au narrateur, en perpétuel délire.
Quant au style, il est itératif et scandé à la manière d’une psalmodie elliptique et tranchée, mais aussi très lyrique et imagé. Ainsi, parlant de la demeure de son grand-père, le narrateur dit-il: «Une tour intemporelle où se réfugient les colombes du souvenir en roucoulant leur nostalgie du temps passé».
Signalons enfin l’excellente traduction de France Douvier Meyer, avec une seule réserve sur les dialogues un peu surfaits, hésitant entre le vous et le tu, ainsi que cette difficulté à traduire le fameux Sidi que Corneille a traduit par Cid et auquel beaucoup continuent de lui préférer Monsieur ou Seigneur…
R. B. S.
Naguib Mahfouz, Chimères, roman, traduction France Douvier Meyer, Denoël, 1992.

(Le Passe-Muraille, No 1, Avril 1992)