Louis Guilloux l’insoumis

Un romancier de l’empathie profonde.
Par René Zahnd
Il existe au moins un avantage à sortir d’un siècle, c’est d’acquérir du recul sur lui. Le XX eaura été celui de tous les excès: génocides et libérations. La littérature garde l’empreinte profonde de ses tempêtes et de ses fêtes, de ses utopies et de ses désespoirs, de ses avancées et de ses noirceurs. Ce recul permet de plonger ou de replonger dans certains univers et de procéder à des retouches dans notre modeste panthéon personnel: aussi bien recaler de façon vacharde certains auteurs qui nous paraissent soudain surévalués qu’en faire remonter d’autres dont la puissance nous avait peut-être échappé.
La publication d’un volume Louis Guilloux dans la riche collection Quarto, fort de 6 de ses 14 romans, fournit une magnifique occasion de décou-vrir l’œuvre de cet insoumis. L’essayiste Henri Godard, qui sait de quoi il parle, précise à son sujet: «Sans lui, il man-querait au roman français du XXesiècle une voix discrète mais irremplaçable.»
Au début du livre figure un portrait de l’auteur âgé de 26 ans. On y découvre un visage farouche sous un chapeau cabossé. Les vêtements sont am-ples, les mains fourrées dans les poches du manteau, la cravate est un peu de traviole, le regard à la fois triste et déterminé. Rien de l’homme de lettres. Un gars qui vient de la rue, posé là sur une chaise le temps d’une prise de vue, et qui attend de retourner d’où il vient.L’image correspond bien à l’étiquette d’«écrivain du peuple», de chantre de la pauvreté qu’on a souvent collée à cet homme.
Louis Guilloux est effectivement d’extraction modeste. Plusieurs de ses livres évoquent des milieux po-pulaires et lui-même semble dans son travail comme un artisan qui mettrait sans cesse la langue sur son établi, privilé-giant l’usage de mots courants pour exprimer la réalité qu’il observe, se faisant le scribe des «vies sans importance». Ses amitiés avec Eugène Dabit ou Jean Guéhenno ont grande-ment favorisé son assimilation à cette «caste» d’écrivains. Mais que cela est réducteur!Le titre et le sujet de son premier roman, publié en 192(l’année de la photographie), ont évidemment favorisé cette «classification»: La Maison du peuple raconte le projet d’un groupe d’hommes de gauche, laissés sur le bord de la route suite à des manœu-vres électorales et qui décident de bâtir, de leur mains, un endroit où se réunir, où s’ins-truire, où discuter. La déclara-tion de la guerre de 14 vient fracasser leur rêve.Dans ce livre pourtant, au-delà de l’histoire et de sa portée politique, on perçoit ce qui fait la force de l’œuvre de Guilloux: l’attention aux personnages (quelle fi-gure émouvante que celle de la grand-mère, qui gagne ses petits sous en raccommodant des parapluies), la façon de ne pas juger mais de témoigner, l’aptitude à saisir les forces et les tensions qui animent une société. Un laboratoire des comportementsné à Saint-Brieuc en 1899, Louis Guilloux y est mort en 1980. Cette ville, il n’a cessé de la scruter, d’en détailler les mœurs, d’en étudier les ha-bitants, non pas à la manière d’un sociologue ou d’un an-thropologue, mais bien à la façon d’un écrivain capable de malaxer la matière première pour la transformer. Dans La Maison du peupledéjà, il s’ins-pirait de sa propre famille et de son cercle de «camarades». nul doute aussi que Saint-Brieuc a servi de modèle pour ce livre que certains considè-rent, à juste titre, comme l’un des chefs-d’œuvre du XXe siè-cle: Le Sang noir,où se déploie une puissance romanesque rare.L’action se déroule un jour de 1917, dans une ville à l’ar-rière du front. Il y a toute une société qui vit, qui s’agite, avec pour personnage cen-tral le fameux Merlin, que tout le monde surnomme Cripure (référence ironique à la Critique de la raison purede Kant), professeur de philoso-phie de son état, ivrogne fort en soliloque, contempteur de la haine et de la médiocrité ambiantes, qui claudique dans «Cloportgorod» aux rues grises, envisage de «brûler la politesse à cette soi-disant ci-vilisation» et verrait d’un as-sez bon œil qu’on plante un bouquet de persil dans la na-rine des conscrits qui partent au Front.
Grouillante de personnages, comme par exemple l’infatué nabucet ou la touchante domestique Maïa, c’est une fresque où se multiplient les petitesses et les combines, mais où tout finit par basculer dans la grandeur tragique. Dans Le Sang noir,comme dans d’autres livres de Guilloux, il y a cette faculté qui est sans doute la marque du pur romancier de faire vivre des personnages, mais aussi de s’intéresser au destin individuel et de le placer en résonance avec un contexte beaucoup plus large, social, politique et historique. Albert Camus l’exprime d’une autre façon, en disant que Guilloux «n’utilise la misère de tous les jours que pour mieux éclairer la douleur du monde». Il l’a fait en variant les tons et les approches, s’affranchis-sant peu à peu des contextes purement «populaires». Le ciment qui lie tous ses textes, c’est cette empathie profonde pour l’humanité et le désir, qu’on pourrait dire ontologi-que, que cette humanité cesse de se meurtrir elle-même. Guilloux, jusqu’au bout, a refusé d’être embrigadé sous quelque étendard que ce soit. Il s’est engagé à la façon d’un artiste, loin de toute doctrine, pour un monde un peu moins moche, où tout être humain aurait le droit de s’épanouir.R.Z.
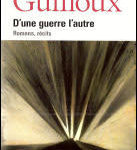
Louis Guilloux, D’une guerre l’autre, édition excellemment préfacée et présentée par Philippe Roger, contenant La Maison du peuple, Compagnons, Le Sang noir, Douze balles montées en breloque, O.K. Joe!, Labyrinthe et L’Herbe d’
Gallimard, collection Quarto.
(Le Passe-Muraille, No 81. Avril 2010.)
