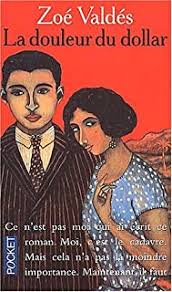L’irrévérence absolue de Zoé Valdès
À propos de La Douleur du dollar,
par Claire Julier
«Ceci est une histoire d’amour et de douleur comme dans la chanson de Maria Teresa Véra. C’est comme l’une de ces roses qui piquent, un roman-fleuve avec des épines.»
Sous les airs langoureux du boléro, une voix grimpe jusqu’aux étoiles avec une intensité incomparable et susurre des mots d’amour éternel, illumine la nuit de baisers; la voix d’ébène plane dans l’irréalité, dans «cet amour paisible que les êtres humains se sont inventé dans le ciel». En l’écoutant, les rêves, les odeurs, les douleurs se répandent.
Dans La Havane du souvenir, la vie est fête. Le corps, la tête, le cœur tentent de se mêler «à cette vie excitante faite de rythme et de désir, qui est véritable raison d’être». La Havane, un cosmos éblouissant, une explosion sensuelle, avec son odeur de sueur sucrée, de coït ininterrompu, de fièvre absolue de plaisir. Une ville autrefois magique et où depuis 1959 la recherche effrénée de volupté s’est muée en envie d’échapper à la misère et à l’oppression. Castro, alias grosse pointure, alias XXL, le fiancé de la patrie, s’est transformé en père, puis en momie, orateur captateur et videur d’intelligence. Pour beaucoup d’intellectuels confrontés à la Révolution, empêchés de parole, rendus muets par les contraintes de la bureaucratie au pouvoir, l’exil est devenu une nécessité absolue. Ne restent que ceux qui n’ont pu faire autrement, les cœurs simples et les autres, la cohorte de cancrelats.
Le trop-plein idéologique a scindé la société cubaine en cinq groupes: les dirigeants, les diplogens ou collaborateurs, les dissidents, les indigents, sans oublier les survivants, «lisez au passage les artistes, les écrivains, les philosophes… quand ils ne dérapent pas, car parmi ces derniers, certains passent dans l’un des camps précédents».
Et tout autour de l’île, la mer est la comme une invitation à la contemplation, mais également métaphore des limites. Un monde ouvert pour le regard, déjà refroidi par «le phare contrôleur de frontières». Un océan liquide qui souligne l’isolement forcé et les possibilités restreintes d’évasion. S’asseoir sur le Malécom, c’est le retour à la possibilité de l’espoir, mais c’est également fixer les murs de sa prison.
Ecrire, raconter une histoire d’amour genre mélo de quatre sous – Cuca, venue de la campagne et placée comme bonne à tout faire taillable et corvéable à merci dans la capitale, séduite et abandonnée, fille mère et mère d’une fille sans père, avec en arrière-plan un lamento lancinant de musique à danser cheek to cheek cuisse contre cuisse, sur fond de paroles guimauve avec trémolos, promesses enchanteresses (version Piaf habanera) et trépidations exquises de tout le corps – lancer des mots avec une exubérance débridée, une luxuriance tropicale, est une forme de transgression, la désobéissance extrême dans une société révolutionnaire car c’est créer un produit qui n’engendre rien d’utile du point de vue de cette société; c’est échapper au silence forcé et à l’autocensure.

Dans La Douleur du Dollar, Zoé Valdés révèle son imaginaire foisonnant. Tout est prétexte à personnage. Les objets, les insectes, les rongeurs, les chansons populaires, les noms des protagonistes, les sentiments, deviennent des éléments actifs de la narration, mais également les parcelles d’un monde constamment revivifié par l’auteur. Avec sa gaieté poivrée et ses excès les plus crus, elle résiste à la définition de la politique culturelle castriste: «Au sein de la Révolution tout; hors de la Révolution, rien.»
C. J.
Zoé Valdés, La Douleur du Dollar (Te di la vida entera), roman traduit de l’espagnol (Cuba) par Liliane Hasson, Editions Actes Sud, 344 pages.
(Le Passe-Muraille, No 32, Octobre 1997)