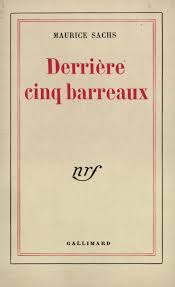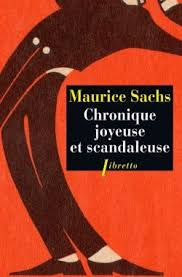L’infréquentable Maurice Sachs
Quelques raisons de lire Derrière cinq barreaux,
par Antonin Moeri
On ne parle pas de Maurice Sachs. Cela ne se fait pas. Ni dans un salon, ni à l’école, ni dans le familles, encore moins dans une rédaction. Voyons ! Un pédé juif qui s’est mis au service de la Gestapo, ce n’est pas reluisant. Ce qu’un tel monstre pouvait bien écrire, avant d’être assassiné par un SS en avril 1945, ne peut que rebuter un lecteur bien-pensant. Voyons ! Or Sachs n’est pas le seul écrivain de langue française à devoir endurer pareil opprobre.
Sachs avait horreur des tièdes, des mous, des tricheurs et des pleutres. Il vomissait l’humanitarisme sentimental (qui n’est qu’un égoïsme sublimé), la fausse amabilité des gens dits civilisés et leurs idéaux de bazar. L’idée d’une quelconque amélioration de l’homme lui semblait un plaisant enfantillage, car aucun progrès n’est possible dans le domaine de l’instinct, disait-il. Sa pensée rejoint celle de Sade lorsqu’il dit: «L’homme n’est pas fait de bonté, ni pour la bonté. La pitié ne lui est pas naturelle. On a appelé vertus tout ce dont l’homme manquait par sa nature».
L’homme est fou et cruel. Il n’est que d’ouvrir l’Ancien Testament, que Sachs connaissait bien et qu’il cite abondamment, pour s’en convaincre. «Tout le récit des guerres de Josué est intolérable de cruauté gratuite. Toutes ces villes passées au fil de l’épée, les innocents accablés, ces rois pendus font horreur», écrivait-il dans la solitude d’une prison de Hambourg, où il fut mis au secret ente 1943 et 1945. Et où il décida de jeter pêle-mêle dans un cahier ses pensées, ses projets, ses rêveries.
Avec un bonheur d’écrire sans égal, avec une éloquence sublime et dans un style adamantin qui rappelle celui de certains moralistes français, l’auteur du Sabbat et des Chroniques d’une jeunesse scandaleuse nous parle du hasard, de l’adultère, du suicide, de Dieu, du Christ, du Bouddha, des snobs, de la niaiserie des Suisses, de la haine de la société mercantile de type américain, de la honte d’exister que sa mère a développée chez lui, de l’aventure que représentait à ses yeux la littérature qui ne fut pour lui «ni un gagne-pain, ni un amusement, ni une vaine recherche de la gloriole, mais une épreuve».
Ecrivain de forte race, Sachs possédait cette divine méchanceté sans laquelle nulle écriture ne peut exister. Il laisse à des abîmes au-dessous de lui la plupart des «penseurs» français de l’époque. Ce qui fait dire à Marc-Edouard Nabe, cet autre styliste insolemment allègre, qu’il donnerait sans hésiter deux lignes de Sachs pour toute l’oeuvre de Sartre.
A. M.