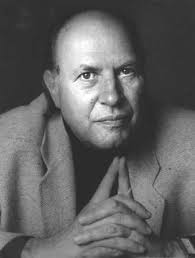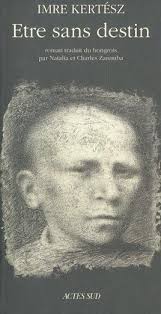L’espoir au tréfonds
Pour lire Imre Kertesz (1926-2013)
Le nom de l’écrivain juif hongrois Imre Kertesz était encore peu connu du public francophone, à l’automne 2002, lorsque le Prix Nobel de littérature consacra soudain cet auteur. Paradoxe qui en dit long sur les pouvoir vivifiants et « résurrectionnels » de la littérature, par opposition aux ombres mortifères de l’Histoire : que c’est en Allemagne, où fut massacrée son enfance, bien plus qu’en Hongrie, que l’oeuvre de Kertesz fut le mieux accueillie et reconnue, célébrée et récompensée, alors même que l’écrivain s’est fait le passeur-traducteur de nombreux auteurs de langue allemande, de Nietzsche à Wittgenstein en passant par Hofmannstahl, Freud et Canetti. Martina Wachendorff, pour les Editions Actes Sud, fut l’éditrice en français des quatre ouvrages qui nous ont révélé cette oeuvre à (re) découvrir absolument aujourd’hui et qu’elle caractérise elle-même en ces termes : «Souffrance, lucidité, ironie, refus de tout totalitarisme : tels sont les éléments […] qui confèrent une portée universelle à son art. »
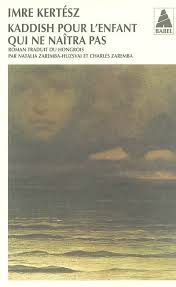
Si le premier titre paru fut Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, petit livre tendu, d’une écriture « bernhardienne », qui dit le refus du protagoniste de faire souche, c’est plutôt par la lecture d’Être sans destin que nous proposons au lecteur d’aborder l’univers de Kertesz.
Être sans destin n’est pas un livre antifasciste ni un réquisitoire sur l’univers concentrationnaire: c’est un roman de formation, ou plus exactement de déformation, le récit très candide de tournure d’un enfant qui devient un vieillard en quelques mois. Agé de quinze ans, le protagoniste (double de l’auteur mais que celui-ci a voulu plus naïf de son propre aveu, par manière de « ruse » littéraire) se trouve entraîné, un jour de 1944 qu’il se rend sur un chantier de travail obligatoire, dans un groupe de jeunes gens interceptés par un policier assez débonnaire, puis dans une foule de juifs parqués sous la garde de gendarmes moins avenants, puis embarqués à bord de wagons pour un voyage qui n’a l’air d’inquiéter personne.

Arrivé à Auschwitz, le garçon se demande quel délit ont pu commettre les détenus qu’il y rencontre, se montre attiré par le joli terrain de football jouxant les fours crématoires non sans apprendre en trois jours ce qui se passe réellement en ces lieux, dont il réchappe pour être dirigé sur le camp de travail de Buchenwald où il mourra presque et ressuscitera plus ou moins.
Sans une inflexion relevant de la révolte ou de la haine apparentes, ce récit nous fait vivre la destruction d’un être humain dans un environnement qu’il refusera toujours d’appeler un «enfer», comme il déjouera toute tentative de normalisation ultérieure et toute incitation à l’oubli. Sa formulation, tellement limpide au premier regard, et tellement dérangeante au fond, Kertesz l’a mûrie durant de longues années, au cours desquelles il subit les effets du stalinisme à la hongroise, à l’enseigne du « socialisme goulasch ». La médiocrité kafkaïenne de celui-ci constitue l’arrière-fond du roman intitulé Le Refus, où Kertesz détaille, au fil d’une narration mimant elle-même les empêchements de la parole par un ubuesque usage de parenthèses, l’opposition suscitée par son premier manuscrit dont l’« expression artistique » était jugée insuffisante « bien que le sujet soit terrible et bouleversant»…
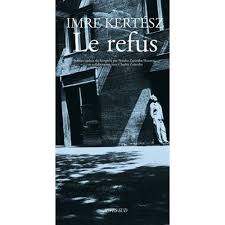
Au lendemain de l’effondrement du communisme, et jusqu’en 1995, Imre Kertesz tint un journal dans lequel il évoque d’abord les retournements de vestes de ceux qui, pendant des décennies, ont pratiqué la langue de bois, et qui se réadaptent à la société «libérale» sans la moindre difficulté. Avec une lucidité qu’aiguise la lecture des Remarques mêlées de Ludwig Wittgenstein, qu’il est en train de traduire, Kertesz relève que «la leçon qu’on peut en tirer est que ces hommes ont consacré leur vie à un mauvais usage du langage». Plus grave, ajoute-t-il ensuite, «ils ont promu ce mauvais usage au rang de consensus». Dans ce petit livre dont l’extrême intimité semble accueillir l’humanité entière, intitulé Un Autre et sous-titré Chronique d’une métamorphose, Imre Kertesz, qui se dit «l’enfant incorrigible des dictatures», écrit: «Être marqué est ma maladie, mais c’est aussi l’aiguillon de ma vitalité, son dopant, c’est là que je puise mon inspiration quand, en hurlant comme si j’avais une attaque, je passe soudain de mon existence à l’expression».

Ce passage, qui fait de l’oeuvre de Kertesz beaucoup plus qu’un témoignage : la transmutation du chaos en forme, le lecteur le « vit » lui-même comme une expérience marquante qui l’arrache à l’accablement de ces pages d’une si désespérante lucidité, « quand sur les images de la vie parait pour un bref instant le fait stupéfiant d’exister et que la vraie couleur transfigure les couleurs »…
JLK
Imre Kertesz.
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Actes Sud, 1995, 158 pages.
Être sans destin. Actes Sud, 1998, 366 pages.
Un autre. Chronique d’une métamorphose. Actes Sud, 1999, 150 pages.
Le Refus. Actes Sud, 2001, 348 pages.
Traductions du hongrois par Natalia et Charles Zaremba.
(Le Passe-Muraille, No 54, Octobre 2002)