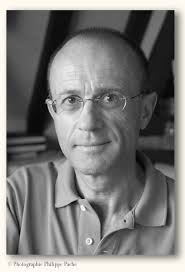L’errance d’un prince perdu
À propos d’un roman de Jean-François Sonnay,
par Pierre-Yves Lador
Les lecteurs de romans auront du plaisir à lire les allées et venues, la vie aventureuse, la longue marche du petit prince arraché aux flammes qui détruisent son palais et sa famille, emmené par des nomades auprès du sage Raja qui l’élèvera à l’écart, dans la vallée de Karaba haut perchée aux confins d’un royaume imaginaire entre Afghanistan et Pakistan. Son éducation d’enfant trouvé, étranger parmi les siens, dans un hameau d’une extrême pauvreté où il fait bon vivre dans une tradition austère, une société immobile en autarcie. Et son Chiron qui lui enseigne sa destinée, qui lui raconte la grande politique, l’histoire, la géographie et lui qui lit une encyclopédie quand il ne garde pas les chèvres, ne coupe pas du bois, ne piste pas l’indispensable gibier… Et qui, à quinze ans, à la mort de son sauveur, se met en route pour sortir son pays de quinze ans de guerre civile, des seigneurs de guerre, des ruines, de la corruption… Roman d’apprentissage où le héros va découvrir le monde en quelques rencontres. Après les paysages grandioses de montagnes, les plaines du chaos, un récit limpide, une langue imagée, des personnages attachants, une vie fourmillante et colorée entre les tanks et les no man’s land…
Mais le lecteur est tôt ou tard arraché à ce romanesque par ce doute instillé dès l’origine et qui l’envahit progressivement. Le mal gagne. La quête se dissout. Le langage et le récit sont minés.
Et le road novel n’est plus un roman picaresque, est-ce un conte, une fable ? Sommes-nous tous des princes perdus ? Le héros est-il un nouveau Candide, un jeune Don Quichotte, un Petit prince inversé ? le jeune homme est-il de sang royal, enfant trouvé, est-il seulement un bâtard ou même un mythomane. Une victime ? Cette naïveté est-elle rouerie ? Toute l’histoire est-elle un prétexte à peindre une société occidentale dont les prétentions et la décadence se reflètent dans ce petit pays du tiers monde. Le héros serait-il une espèce de Persan en Perse ? Sa naïveté fonctionne comme ironie. On se demande si la Suisse jouit d’un «climat sain» et si les Suisses sont «aimables avec les étrangers» ! Chaque rencontre, chaque scène, chaque pas est l’occasion d’une mise en question du monde, de la vérité, de l’essence même du héros. La préoccupation morale et la dérision de Pinocchio. Jahan ou Faroz, de sang royal enseigne un évangile tellement modeste, une sagesse si infime, il est un prophète qui n’est pas sûr de croire à sa mission, n’ose pas s’affirmer, qui finit sa confession, dont il n’est pas sûr lui-même qu’elle soit vraie, par ces mots: «Un jour, il faudra agir. J’attends ce jour-là». C’est Le Désert des Tartares plu-tôt que L’Espoir, car comment agir quand on a besoin de croire, d’être cru et qu’on s’appuie sur son passé ? «J’ai découvert que ce sont les souvenirs qui nous maintiennent en vie, pas les espoirs…». Une comète invisible, surgie du néant qui retourne au néant, qui laisse ce livre brillant, témoignage qui dit des témoignages: «Avant de croire ce que les gens racontent, on devrait se demander quel intérêt ils ont à dire une chose plutôt qu’une autre».
Le récit miné mine à son tour tous les systèmes: la guerre, les chiens de guerre et ceux qui voudraient les arrêter, la communication toujours difficile: «je me demande si le malentendu n’est pas fatal entre les hommes», l’impossibilité de contrôler ce que les autres font de son image alors qu’il souhaite être reconnu, la diplomatie: «Quand il est question de choses graves, certaines personnes ne disent ni je, ni oui, ni non», la politique: «aujourd’hui je crois qu’il n’y a plus de place pour la politique», les organisations internationales, les ONG, etc.
Un ruissellement d’observations, de remarques, de sagesse, de morale pourraient sembler issues du Café du Commerce (devenu cybercafé) mais viennent de l’écrivain, homme de terrain qui les fait découvrir par un jeune villageois oriental excisé de son propre monde, comme un idiot qui découvre des vérités universelles qui résonnent ainsi singulièrement au milieu de cette déconstruction des conventions sociales, de la langue de bois.
La distanciation n’empêche pas l’émotion et le prince a son animal totem: la tortue, fragile, courageuse et tenace, qui sait attendre et se réfugier dans sa carapace, mais qui un jour sera cuite au napalm, peut-être… Le livre lui-même, que le narrateur écrit parce que «noir sur blanc», «expliqué clairement», «pour rétablir la vérité il valait mieux écrire», «Je sais qu’on ne croira pas mon histoire parce qu’elle est bien racontée, mais parce qu’elle est authentique…», est remis en question. «Saphir avait du respect pour les gens qui savent lire et écrire, mais il ne trouvait pas bon que la vie d’un homme dépende d’un bout de papier» et davantage encore, le journaliste: «Franchement je ne vois pas la nécessité d’aller au bout du monde interroger les gens sur ce qu’on sait déjà» ou bien: «Il me semble qu’il s’est servi de tous les mots de la langue et qu’il les a tous gâchés».
Quel chemin parcouru dans la maîtrise du récit et dans l’évolution de la vision du monde depuis les deux déjà remarquables romans L’Age d’Or et Le Tigre en papier jusqu’à ce joyau vertigineux où l’apprentissage de la méfiance et de la défiance n’empêche jamais la confiance chaque jour renée jusqu’à la mort. A la défiance des politiques répond la nécessité des autres; «Ma vie engage celle de tous ceux qui d’une manière ou d’une autre en ont partagé un bout», et naïf ne signifie pas crédule. Si ce livre engendre un vertige, c’est celui de ces va et vient entre doute, croyance et besoin de croire, méfiance et confiance, naïveté et finesse, franchise et rouerie. Et surnagera dans l’esprit du lecteur «les cheveux couleur de miel, un sourire captivant, une voix d’oiseau chanteur et des yeux turquoise capables de lancer des étincelles», image lumineuse de Jodie (Foster ?), la première personne depuis que Raja était mort «qui me parlait en confiance et avec respect». Anglaise, elle eût pu être Bernoise ! Une parole authentique qui émerge d’un discours miné: avec ce livre, Sonnay confirme son statut de romancier, l’un des plus importants de ce pays.
P.-Y. L.
Jean-François Sonnay, Un Prince perdu, Editions Bernard Campiche, 1999.