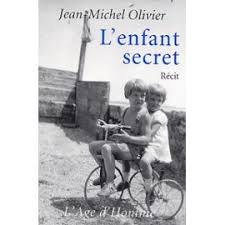L’enfance de l’art
À propos de L’Enfant secret de Jean-Michel Olivier
par JLK
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, écrivait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est précisé-ment cette mise en relation du proche et du lointain, du détail et de l’ensemble, qui donne son équilibre, sa teneur et son charme au dernier livre de Jean-Michel Olivier, L’Enfant secret, sans doute aussi son meilleur à ce jour. Tenant à la fois de la chronique familiale et du roman d’origine, c’est également une collection d’images précieuses à l’auteur et de méditation sur la nature de l’image, précisément, dont les lettres déplacées du mot deviennent celles du mot magie.
«C’est l’histoire de ma vie que je cherche », écrit Jean-Michel Olivier : « deux rivières (deux courants, deux désirs) qui un jour, en un point précis de l’espace et du temps, pour une raison secrète, ont mélangé leurs eaux : moi. » Or ce «moi» qui parle est l’enfant secret du titre mais plus encore : c’est l’enfance de l’art et le secret des gens. Plus qu’une séquence autobiographique égotiste, c’est une tranche de notre histoire à tous que reconstitue l’écrivain en déléguant, à son enfant secret, les pouvoirs magiques de la vision et la pratique plus terre à terre du détective et de l’archiviste ou, pour reprendre ses métaphores photographiques, du (re)cadreur et du tireur.
Les deux courants indiqués plus haut remontent, d’une part, au XIIIe siècle avec la souche Olivier établie depuis ce temps-là sur la Côte vaudoise, et voici Julien le descendant des littérateurs Urbain et Juste, lui aussi poète sur les bords, dont le chemin croisera tôt celui d’Emilie, avec laquelle il concevra Pierre. D’autre part, comme souvent en Suisse multiculturelle, l’affluent « étranger » proviendra des marches de la Mitteleuropa, puisque Livia, la future belle-fille du couple vaudois, est l’aînée d’un Anton devenu Antonio au lendemain de la Grande Guerre, après le changement de nationalité de Trieste. Une Nora slovène, partageant le nom de la femme de Joyce (qui apparaît au coin d’une image, comme on y verra Italo Svevo), sera l’autre grand-mère de l’enfant. Le lecteur redoute-t-il un imbroglio ? Qu’il se rassure : la narration de L’enfant secret est d’une parfaite limpidité, qui ménage parfaitement en outre la double part de l’histoire privée et des événements du xxe siècle.
Antonio Campo, le grand-père italien, sera le témoin privilégié de ceux-ci, au titre de photographe personnel de Benito Mussolini. Ses images vont contribuer notablement à l’obsessionnel souci de visibilité du Duce, que nous voyons ici de tout près. Plus romancier alors que banal mémorialiste d’une famille, Jean-Michel Olivier sait cependant où s’arrêter dans ce récit « épique » évidemment plus corsé que celui de la famille vaudoise. De celle-ci, les personnages — Julien surtout, et Pierre ensuite — se détachent cependant avec un relief fortement marqué sur l’arrière-plan provincial, auquel les drames ne sont pas épargnés. L’année 1932 des fusillades de Genève, où Julien perd deux de ses compères, est également marquée par la mort de la petite Jacqueline, soeur adorée de Pierre.
« Certains enfants sont des fantômes », lit-on d’ailleurs à propos de la petite fille semblant marquée par un destin funeste. «Ils portent en eux le souvenir d’un autre monde au-delà des forêts, par-delà les ruisseaux. Ils ont baigné leur corps et leurs cheveux dans la source enchantée. Ils ont gardé dans leurs yeux cette extase. »
Le monde « vu d’enfant » par le narrateur n’a rien, pour autant, d’édulcoré par les sempiternels clichés liés au «vert paradis », mais s’ordonne bien plutôt en fonction de cette composante non sentimentale de la psychologie enfantine qu’on pourrait dire l’esprit de conséquence. Dans la chambre noire de la mémoire, l’enfant secret travaille en artiste et en poète. « Tout ce que j’écris est authentique, note encore Jean-Michel Olivier. On me l’a raconté: ce sont des fables, des légendes vécues, des anecdotes récoltées au fil des ans et des rencontres. Comme tous les souvenirs, ce que j’écris est donc authentiquement faux. »
JLK
Jean-Michel Olivier. L’Enfant secret. L’Age d’Homme, 2003. 186 pages.